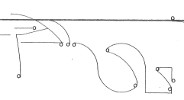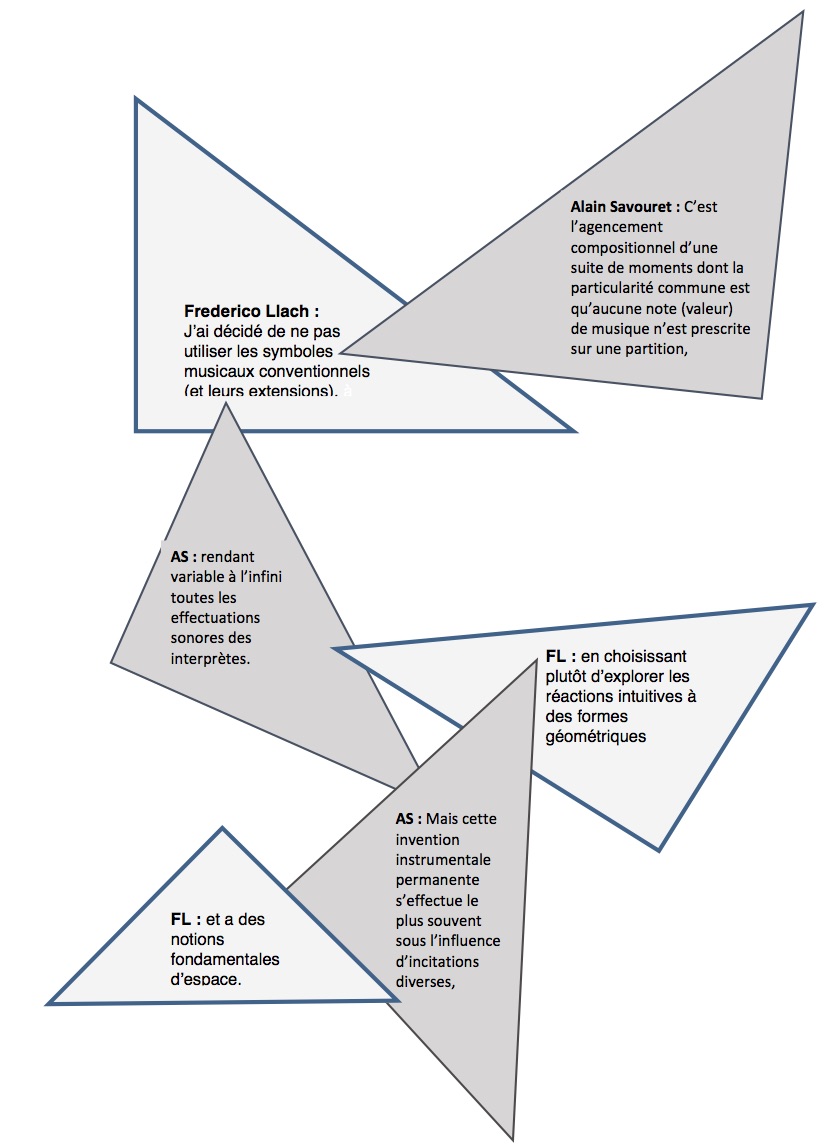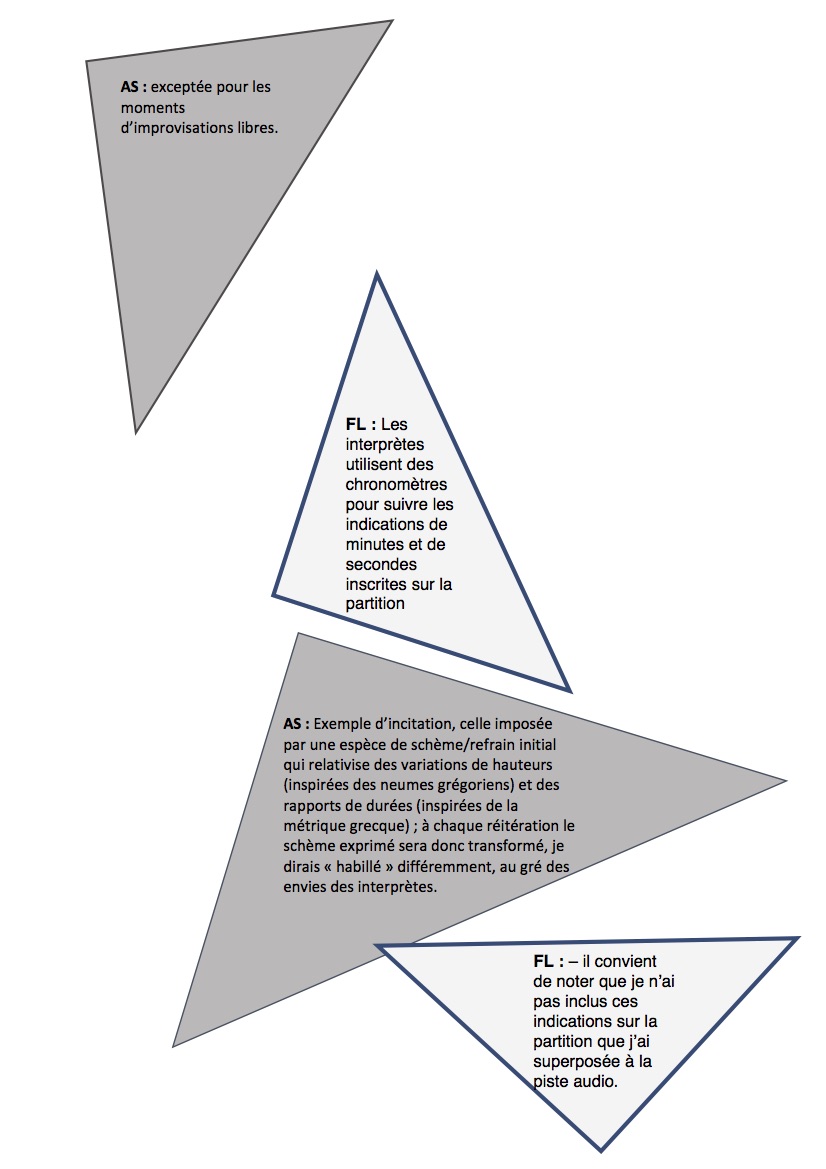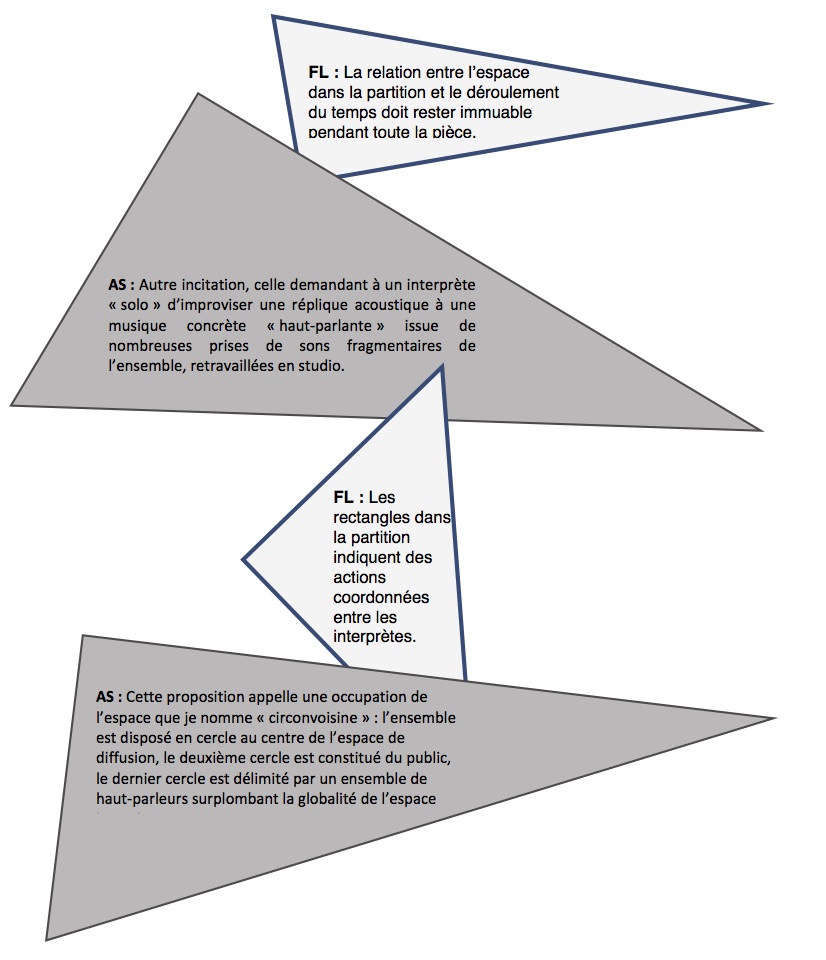Plan PaaLabRes (2016)
Pratiques Artistiques en Actes, LABoratoire de REchercheS
Sommaire
|
Guide 2016 Ligne « Cartographie PaaLabRes » Ligne « Politique » Ligne « Improvisation » Ligne « Recherche artistique » Ligne « Compte-rendu de pratiques » |
 |
L’Édition 2016 se présente comme un plan de métro, composé de cinq lignes. Chaque ligne représente un aspect important des préoccupations du collectif PaaLabRes : Cartographie PaaLabRes , Politique , Improvisation , Recherche artistique et Compte-rendu de pratiques .
En voici le mode d’emploi…
Guide 2016
L’Édition 2016 comporte 18 textes (parfois des voix parlées enregistrées, parfois des textes animés sous forme de vidéos). On peut y accéder en cliquant sur chacune des 18 stations du métro.
Et l’édition 2016 comporte 72 extraits d’objets artistiques (enregistrements audio, vidéos, images, textes animés) réalisés par 36 artistes. Ces objets artistiques, que nous appelons « Itinéraires-chants », se trouvent placés entre les stations de la ligne centrale Cartographie PaaLabRes . Pour y accéder il faut cliquer sur une des stations de cette ligne centrale et lire (ou ne pas lire) le texte. Sur la droite du texte (ou en dessous du texte) se trouve un plan de la ligne centrale bleue. On peut cliquer sur n’importe quelle station sur ce plan et un Itinéraire-chant apparaîtra qui vous mènera agréablement vers la station sélectionnée. Un générique décrivant l’itinéraire-chant apparaît à la fin de l’extrait avec le titre et le nom (ou les noms) des artistes. Il y a 9 stations sur cette ligne, ce qui donne 72 possibilités de parcours entre deux stations.
Voir la liste des itinéraires-chants et la liste des contributeur·ices 2016.
Ligne de métro « Cartographie PaaLabRes »
Au centre de ce plan de métro se trouve une ligne circulaire, qui est là en quelque sorte pour fonder notre démarche PaaLabRes. Les stations de cette ligne représentent les neuf concepts qui nous paraissent importants : « Nomade », « Transversal », « Expérimental », « Discipline », « Praxis », « Musique à faire », « Opérations culturelles », « Oralité », « Écologie des pratiques ». Chaque station de cette ligne est reliée à toutes les autres par des « Itinéraires-Chants ». Le lecteur choisit une des stations-concepts, peut en lire le texte, le parcourir ou l’ignorer, puis, choisissant n’importe quelle autre station-concept est mis en présence d’un « Itinéraire-Chant » (texte, enregistrement sonore, vidéo, graphisme, etc.) qui va l’emmener de manière artistique à cette nouvelle station. Cette procédure peut se répéter autant de fois que le lecteur/auditeur le souhaite. Il y a 72 « Itinéraires-Chants » reliant les 9 stations-concepts. Ces Itinéraires-Chants ont été élaborés par les membres du collectif PaaLabRes, et diverses personnalités appartenant au second cercle du collectif en France et dans le monde. Cela correspond à notre volonté de créer un véritable réseau d’artistes et de chercheurs partageant nos objectifs.
Cette idée de ligne circulaire centrale s’inspire de la pratique des aborigènes d’Australie. Le philosophe Daniel Charles ouvre son chapitre sur les « Musiques nomades » (en citant Bruce Chatwin), par une description des pratiques traditionnelles de ces aborigènes qui consistent à ne pas séparer leurs chants ou poésies d’itinéraires allant d’un endroit identifié à un autre :
L’Australie est ainsi couverte d’un réseau de pistes qui en font virtuellement […] une partition musicale. Ces pistes ne sont pas tracées sur le sol comme des sentiers ou des chemins, et elles restent invisibles à l’étranger. Il y a des points de repères – un rocher, une colline, un point d’eau, un banc de sable… – qui sont des sites sacrés, liés à d’autant d’épisodes mythologiques, et le chant ou poème conduit de site en site, en mesurant la distance qui les sépare. Le chant est itinéraire et l’itinéraire le chant.
Daniel Charles, Musiques nomades, Paris : éd. Kimé, 1998, p. 218. Bruce Chatwin, The Songlines, Londres : Cape, 1987 ; Le Chant des pistes, trad. par J. Chabert, Paris : Grasset et Fasquelle, 1988.
Ainsi de manière similaire et nomadique, la ligne centrale s’organise en « sites » conceptuels – les notions importantes qui définissent le groupe PaaLabRes – et en itinéraires-chants qui assurent la traversée d’un site à l’autre.
Accès aux stations :
Ligne de métro « Politique »
Une des préoccupations principales du collectif concerne la position de l’artiste aujourd’hui dans la société mondialisée (ou éminemment localisée) et du caractère forcément politique de ce positionnement. En mettant l’accent sur les pratiques plutôt que sur ce qui en résulte (les œuvres), le caractère politique des interactions entre participants ne peut pas être évité : questions relatives à l’accès aux pratiques, aux hiérarchies, à la participation à un contexte démocratique, au degré d’autodétermination des groupes en présence, etc. Il s’agit moins de développer la communication de postures politiques, ou de penser bousculer les structures existantes, que de prendre conscience du caractère politique et social des actes artistiques, dans leurs manières particulières d’interagir avec les autres. Une ligne de métro « Politique » a donc été créée.
Dans la station « Musique, recherche et politique », un texte à vignettes de Karine Hahn et Nicolas Sidoroff mixe principalement les recherches de Karine sur les pratiques musicales d’un village de la Drôme, et d’autre part celles de Nicolas sur l’éducation populaire et ses possibles déclinaisons dans le domaine de la musique. Des vignettes plus ou moins longues, plus ou moins anecdotiques viennent résonner-raisonner…
Une autre station de cette ligne « IO+IOU » contient aussi deux textes parallèles : un texte du compositeur et chercheur américain Ben Boretz, I / O, datant de 2001, portant sur une comparaison des pratiques musicales entre « poésie » et « politique », auquel répond un texte de Jean-Charles François, IOU, écrit en 2015 pour les 80 ans de Boretz reprenant les éléments textuels de l’original en transformant « poésie » par « poïesis » et « politique » par « praxis ». Un enregistrement de la version française a été réalisé avec les voix de Monica Jordan, Nancy François, Dan Haffner et Jean-Charles François. Cet enregistrement est accompagné d’un diaporama qui anime les deux textes pendant qu’ils sont parlés. Une version pdf est aussi proposée présentant les deux textes sur deux colonnes séparées et juxtaposant sur la même page les éléments correspondants de chaque texte. Ben Boretz est l’éditeur fondateur de la revue Perspectives of New Music depuis 1963, publication de recherche aux Etats-Unis centré sur la musique contemporaine. Il a aussi développé une publication Open Space Magazine (espace ouvert) dans laquelle se trouve mêlé des articles de recherche avec des textes poétiques ou expérimentaux, des récits d’expérience, des textes critiques, des partitions et des enregistrements sur CD. Il a paru important dans cette première version de notre publication électronique de faire référence à une démarche éditoriale très proche de ce que nous voulons promouvoir.
La ligne « politique » inclut aussi une station « La culture au pluriel » : il s’agit d’un texte slamé de Jean-Charles François portant sur un extrait du livre de Michel de Certeau, La culture au pluriel (Paris : Christian Bourgois Éditeur, 1980 (1974, 1993), pp. 233, 234, 235, 241). Michel de Certeau considérait que la culture au pluriel était « sans cesse un combat » à mener. La diversité des styles, des cultures et des catégories artistiques est un des aspects importants des positions du collectif PaaLabRes, qui regroupe en son sein des représentants de plusieurs expressions musicales et artistiques (classique, musique contemporaine, instruments anciens, jazz, musiques actuelles amplifiées, improvisation, littérature, musique traditionnelle,…).
Accès aux stations :
| IO + IOU | PRAXIS | GEORGE LEWIS « AFTERWORDS » |
| OPÉRATIONS CULTURELLES | LA CULTURE AU PLURIEL | MUSIQUE, RECHERCHE ET POLITIQUE |
Ligne de métro « Improvisation »
Depuis la création de l’espace numérique (juin 2016), cette ligne comporte une station qui croise la ligne « Politique » : une traduction française d’un article du compositeur et improvisateur américain George Lewis, « Afterwords », Postface à « La musique improvisée après 1950 » : Le pareil qui change.
George Lewis est professeur à l’Université Columbia à New York et il est une figure très importante de la recherche sur l’improvisation et l’informatique musicale. Il est issu de l’AACM ou L’Association for the Advancement of Creative Musicians (Association pour la promotion des musiciens créatifs). L’AACM a été fondée à Chicago en 1965 autour du pianiste Muhal Richard Abrams. L’AACM a été un lieu de rencontre, de formation et de promotion des musiciens afro-américains. L’AACM a encouragé et soutenu beaucoup de musiciens de jazz : citons Anthony Braxton, Jack DeJohnette, Chico Freeman, Wadada Leo Smith, Leroy Jenkins, et le Art Ensemble of Chicago (Lester Bowie, Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, Famoudou Don Moy et Malachi Favors). Voir l’article en français de Pierre Carsalade et Alexandre Pierrepont, « Georges Lewis, A Power Stronger than Itself : the AACM and American Experimental Music », Volume / 8 : 2, 8 février 2011, p. 280-293 (en ligne). C’est autour de l’histoire de l’ AACM que George Lewis vient d’écrire un opéra Afterword qui a été produit au festival de musique contemporaine de Huddersfield (Angleterre) en novembre 2015. George Lewis est aussi connu en France pour avoir été en résidence à l’IRCAM pendant les années 1980. L’article que nous publions porte sur une revendication des musiciens issus de l’AACM d’être reconnus au même titre que John Cage et les musiciens qui lui sont associés comme faisant partie de la musique expérimentale, tout en soulignant combien les pratiques effectives de ces deux groupes ont été différentes : d’un côté une approche directe de production sonore (improvisation entre autres choses) sur des instruments ou sources sonores, de l’autre des processus conceptuels basés sur l’écriture de partitions et sur l’interprétation de celes-ci.
En mars 2017, une nouvelle station voit le jour : « The Bridge ». Il s’agit d’une rencontre organisée à l’initiative d’Alexandre Pierrepont, à l’occasion du concert de l’ensemble The Bridge #4 au Périscope à Lyon, le jeudi 6 octobre 2016, entre des musiciens de ce groupe (Julien Desprez, Rob Mazurek) et des musiciens de PaaLabRes (Jean-Charles François, Gilles Laval et Nicolas Sidoroff). Les membres de Shore to shore (The Bridge #4) qui ont joué dans le concert du Périscope sont : Mwata Bowden, Julien Desprez, Matt Lux, Rob Mazurek et Mathieu Sourisseau. Suite à ses recherches sur l’AACM, l’anthropologue Alexandre Pierrepont a organisé, dans le projet du Bridge, plusieurs ensembles mélangeant des musiciens originaires de Chicago et des musiciens français, avec des tournées aux Etats-Unis et en France et la production d’enregistrements. La rencontre a porté sur la pratique de l’improvisation, sur les questions de la création sonore dans le cadre du jeu instrumental ou vocal, de création collective, des sessions d’enregistrement comme outil réflexif, d’écoute mutuelle, de communication entre improvisateurs, de la rencontre entre les cultures et d’éducation musicale.
En octobre 2019, une nouvelle station voit le jour : « Timbre ». Il s’agit de la version française d’un article de Jean-Charles François publié en anglais en 2015 sous le titre « Improvisation, Orality, and Writing Revisited » par Perspectives of New Music (Vol. 53 N°2). Cette version apparaît ici sous le titre de « Revisiter la question du timbre ». Pour l’auteur, la question de la production immédiate de la sonorité est au cœur aujourd’hui des pratiques de l’improvisation. Le contrôle du timbre dans ses moindres détails appartient d’une manière tout à fait essentielle à l’instrumentiste ou le vocaliste créateur. La description ou la représentation graphique (ou même l’échantillonnage numérique) des réalités de telles pratiques de production sonore reste très problématique.
Accès aux stations :
| TIMBRE | NOMADE | GEORGE LEWIS « AFTERWORDS » | THE BRIDGE | ORALITÉ |
Ligne de métro « Recherche artistique »
La pratique réflexive, l’expérimentation, le bricolage, souvent considérés comme non-formels, sont ici regroupés sous la rubrique ambitieuse de « recherche artistique ». À la jonction de la ligne « recherche artistique » et de la ligne « compte-rendu de pratiques » se trouve la station « The artistic turn ». Il s’agit d’un résumé du livre de Kathleen Coessens, Darla Crispin et Anne Douglas, The Artistic Turn, A Manifesto. Ces trois artistes ont en commun d’occuper des postes universitaires et de mener de front leurs pratiques artistiques et les recherches formelles qui y sont associées. Le résumé est en français à partir du texte original en anglais. Cet ouvrage a été publié par le Orpheus Institute de Gand en Belgique. L’Orpheus Institute est un centre international dont l’objectif principal est la recherche artistique associée à la pratique musicale et principalement déterminée par des objectifs artistiques. Les trois auteures sont associées au sein de cet institut à l’Orpheus Reserach Centre in Music (ORCIM) qui regroupe en son sein une quinzaine d’artistes-chercheurs menant des recherches à un haut niveau. L’ouvrage est accompagné d’une préface de Jeremy Cox, directeur général de l’Association Européenne des Conservatoires et ancien doyen du Royal College of Music de Londres.
La station « Débat » consiste en un compte-rendu d’une rencontre-débat sur la recherche artistique, organisée conjointement par le Cefedem Rhône-Alpes (aujourd’hui Auvergne Rhône-Alpes) et le collectif PaaLabRes. Cette séance de travail a eu lieu le 2 novembre 2015 en présence de musiciens, artistes et chercheurs en sciences humaines, proches ou membres des deux groupes organisateurs. Il s’agissait, à partir de plusieurs textes, dont le résumé de l’Artistic Turn, de faire un premier tour de table pour définir les questions qui se posent dans l tous les domaines artistiques aujourd’hui face à cette idée de la recherche non seulement dans le contexte des institutions universitaires ou des laboratoires légitimement reconnus, mais aussi de manière très souvent silencieuse dans les lieux de production ou d’enseignement artistique. La fonction de la station débat est de créer un forum de discussion PaaLabRes avec un appel très large à des contributions d’utilisateurs du site.
Accès aux stations :
| EXPÉRIMENTAL | ORALITÉ | THE ARTISTIC TURN | DEBAT |
Ligne de métro « Compte-rendu de pratiques »
Cette ligne devrait jouer un rôle important dans le futur de la publication PaaLabRes, pour constituer une base de données riches en expériences et capable de susciter des comparaisons de dispositifs ou de procédures.
À la station « Gunkanjima », vous trouverez un texte de Noémi Lefebvre sur un projet mené depuis quelques années par Gilles Laval à partir d’une collaboration entre des musiciens japonais et français. Pour Gilles Laval l’histoire de Gunkajima, un îlot au large de Nagasaki, liée à l’énergie et à l’écologie, est « une métaphore d’un monde de profit à court terme, où l’absurdité côtoie le travail forcé et aussi la gaité certainement, l’insouciance sûrement, la résignation en tout cas ou quelque chose de cet ordre là » (cf. Enquête “Meanwhile, in Fukushima”). Gilles Laval est un guitariste électrique qui développe à Lyon une multitude de projets expérimentaux, il est responsable du département Rock de l’ENM de Villeurbanne. Noémi Lefebvre a publié récemment son troisième roman, elle mène des recherches liées à la musique dans le cadre des Sciences Politiques et elle est responsable du Centre de recherche au Cefedem Rhône-Alpes (aujourd’hui Auvergne Rhône-Alpes). Tous les deux sont membres du collectif PaaLabRes.
Accès aux stations :
| THE ARTISTIC TURN | ÉCOLOGIE DES PRATIQUES | TRANSVERSAL | GUNKANJIMA |
Le collectif PaaLabRes — 2016 — 2017
Samuel Chagnard, Jean-Charles François, Laurent Grappe, Karine Hahn,
Gilles Laval, Noémi Lefebvre, Pascal Pariaud, Nicolas Sidoroff, Gérald Venturi.
Liste des contributeur·ices 2016 | des itinéraires-chants
Aller à l’ÉDITORIAL général | l’ÉDITORIAL Carte « Partitions graphiques » (2017)

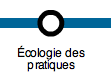
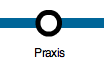






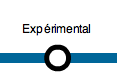
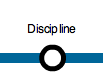
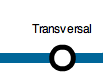

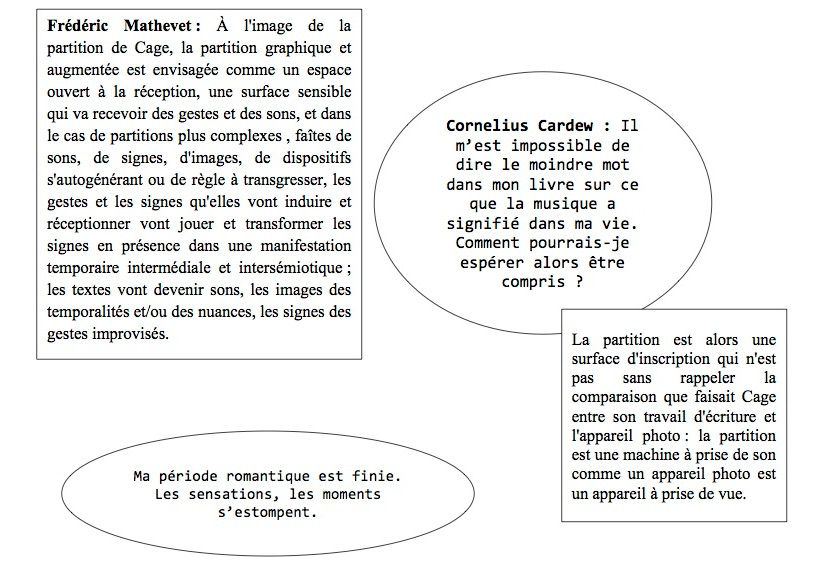
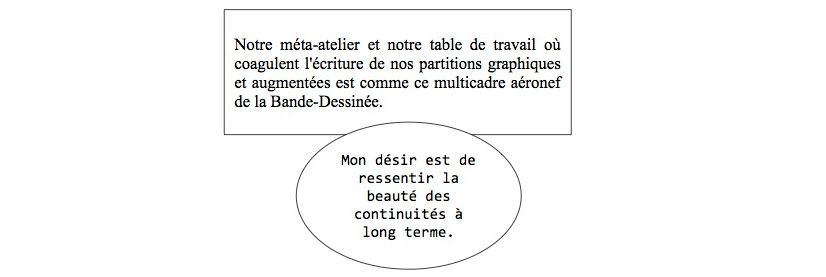
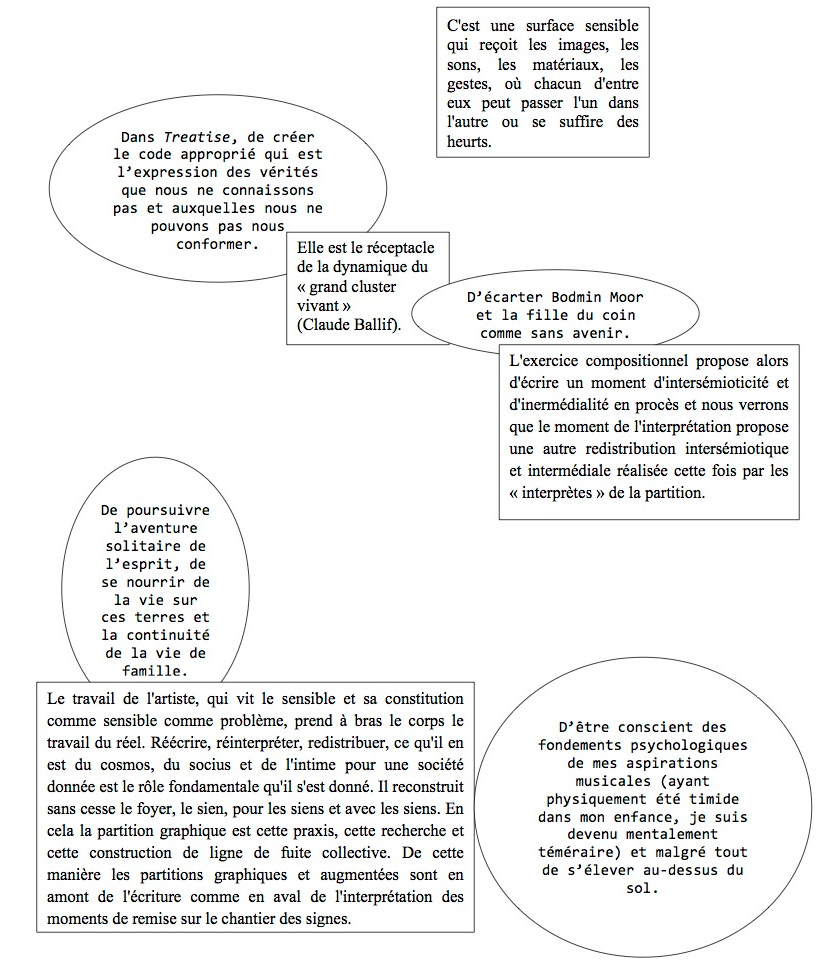
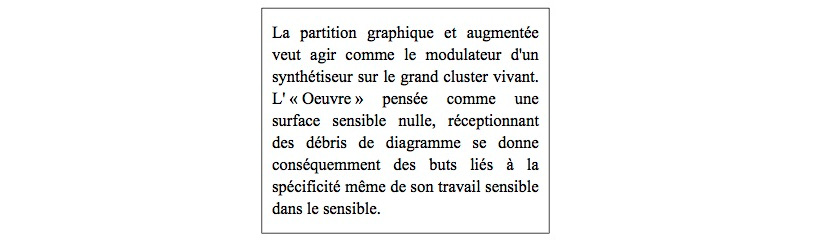
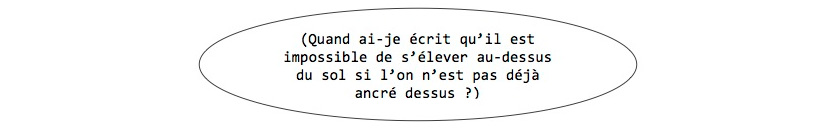

 sono ba
sono ba