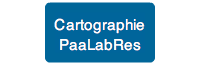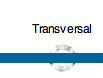« La langue écrite peut servir à exhorter et, en ce sens, elle est performative. Plus généralement, cependant, elle a pour but la représentation. Les sciences « écrites » représentent comme ne sauraient le faire les sciences d’une culture orale. Elles sont davantage éloignées de l’ »action ». C’est cette distance même qui rend l’écrit « bon à penser » d’une manière bien particulière. »
(Jack Goody, La peur des représentations)
Introduction
Dans ce texte, un certain nombre de notions concernant le timbre par rapport à divers supports (notation, enregistrement, synthèse électronique, éducation des instrumentistes) sont reprises de travaux que j’avais publié dans les années 1980-90 et qui ont fait partie de ma thèse de doctorat sur « l’Instrumentiste créateur » en 1994 (François 1982, 1987-88, 1991, 1992).
Il m’a paru intéressant de confronter les notions que j’avais développées à l’enquête menée par Bruno Latour sur les modes d’existence (Enquête sur les modes d’existence, une anthropologie des Modernes) par rapport à la question de la modernité face aux incertitudes écologiques du monde (2012). Bruno Latour prend soin de placer les arts dans un mode d’existence différent ayant ses propres procédures d’accès à une conception particulière de la vérité. Mais la question de la modernité reste pour moi l’énigme majeure de notre temps, face au monde électronique et à la mondialisation des médias.
Dans des textes récents (François 2008, 2009a, 2013), j’ai surtout traité de la question de l’improvisation musicale, contexte dans lequel l’instrumentiste ou le vocaliste devient producteur de timbre à part entière. Il me semble essentiel aujourd’hui de réaffirmer le rôle important que jouent et ont joué les processus pratiques dans la fabrication qu’on peut qualifier d’« artisanale » des sonorités. La recherche en musicologie commence à s’intéresser aux aspects pratiques, ça et là des praticiens font entendre leurs voix, mais il y a un grand chemin encore à parcourir pour se décentrer des logiques d’œuvres achevées au profit de ce qui se passe dans les médiations qui les précèdent, sans parler des nombreuses prestations sonores qui ne revendiquent pas le statut d’œuvre dans le sens moderne du terme.
Première partie – Le timbre et sa représentation
1.1 Tentative de définition du timbre
Comment convient-il de traiter de la question du timbre ? De quoi s’agit-il ? Dans les conclusions d’un chapitre sur Ionisation de Edgard Varèse, dans mon livre Percussion et musique contemporaine (1991), j’ai tenté de répondre à Milton Babbitt qui identifiait la notion de timbre (chez Varèse), plus précisément l’aspect invariant d’un instrument, avec l’idée de « formant », c’est-à-dire la région de la résonance qui amplifie les éléments du spectre, renforçant certains partiels et en atténuant d’autres. Pour Babbitt « les instruments de percussion eux-mêmes constituent des régions de résonance de timbre découpées dans le continuum des fréquences » (Babbitt 1971, p. 20). Le système de notation encourage fortement une pensée paramétrique : les deux dimensions de la page déterminant l’axe vertical des hauteurs et l’axe horizontal des durées orientent une certaine rationalité de l’espace sonore. Le paramètre de l’intensité, beaucoup moins précis à mesurer par l’oreille que les deux premiers paramètres se contente d’une représentation avec peu d’éléments dans son échelle et fonctionnant plutôt par comparaison entre un élément et un autre (plus ou moins fort, plus ou moins piano). Tout ce qui reste encore à définir se traduit dans le paramètre du timbre dans une définition négative : si deux sons ayant la même hauteur, la même intensité et la même durée, sont malgré tout différents à l’oreille, alors c’est qu’ils n’ont pas le même timbre. Le Petit Robert nous dit : « Qualité spécifique des sons produits par un instrument, indépendante de leur hauteur, de leur intensité et de leur durée ». Cette définition fonctionne surtout au niveau de la différenciation des instruments. Plusieurs éléments notationnels peuvent être pris en compte à travers cette définition négative : les signes d’accentuation, d’articulations, les liaisons, les indications subjectives, les effets spécifiques, etc. Chacun de ces signes peut être pensé comme un autre paramètre particulier, mais il y a tendance à préférer de ne pas trop entrer dans des définitions complexes. Ainsi, le timbre est surtout représenté sur la partition par des portées correspondant à des instruments différents. Il est clair que le paramètre du timbre n’est pas précis, le plus souvent il n’entre pas comme un élément important de la spécification des sons par la notation et est donc laissé principalement aux actions pratiques des interprètes.
Lorsqu’on tente de mesurer ce paramètre de timbre, on n’obtient que des résultats dans le domaine des hauteurs (fréquences, partiels, spectres, registres), des intensités (enveloppes, attaques) ou des durées (la durée affecte la perception des différences de timbre). Toutes ces manières de mesurer les sonorités n’ont aucun sens si elles ne s’inscrivent pas dans l’évolution dynamique de chaque son dans le temps. En fait tous ces paramètres sont en interaction constante en vue de produire chez l’auditeur la sensation de timbre.
Dans la tradition de l’art occidental, le système de notation musicale fonctionne en favorisant fortement les hauteurs inscrites dans une temporalité structurée, en prenant en compte de manière plus libre les intensités, et en laissant de côté le timbre dans un arrière plan moins important. Pour que le système de notation puisse fonctionner, le déroulement des hauteurs doit se manifester dans un environnement stabilisé de manière à être clair. Il convient de maîtriser, le plus souvent indépendamment de l’écriture, les éléments complexes du timbre pour les rendre raisonnables. Au moment où la notation devient presque exclusivement prescriptive (vers la fin du XVIIIe siècle), se crée parallèlement un phénomène de standardisation des instruments, alors que la lutherie était auparavant très diversifiée, précisément pour produire une grande variété de situations de timbre. Aucun clavecin ne sonnait comme un autre. Le piano, qui va assumer un rôle de plus en plus important dans la pratique musicale, depuis sa création jusqu’à nos jours, tend au contraire à produire la même sonorité à l’échelle mondiale. Cette standardisation va dans le sens d’une plus grande efficacité de projection dans les grandes salles de concert, et d’une égalisation des niveaux d’intensité dans la composition de l’orchestre symphonique. L’art du timbre devient essentiellement l’art de l’orchestration dans la combinaison des instruments, plutôt que dans le chatoiement des individualités instrumentales. Les oreilles du public étant placées assez loin des sources sonores dans les salles de concert ne sont capables que de percevoir une conception générale des instruments, et la nécessité de projeter les sons à un certain niveau va jouer contre l’expression de qualités sonores très subtiles. Cela ne veut pas dire que des différenciations dans les sons n’étaient pas présentes lors de l’exécution des pièces pour permettre l’expressivité des narrations musicales, mais seulement que les mixtures subtiles d’instruments étaient le moyen principal de coloration de la masse sonore (orchestration et instrumentation). L’amplification par le biais de l’électricité a complètement changé cette situation en permettant aux détails de la production instrumentale ou vocale d’apparaître au premier plan : les instruments et les voix se projetant de manière naturelle dans le grand espace de la salle de concert moderne sont perçus par les oreilles des auditeurs (éloignés de la source sonore) comme des objets sonores singuliers et distincts les uns des autres, dont les caractéristiques jouent en faveur de la perception des hauteurs. Les subtilités de chaque événement sonore, les petites différenciations et les éléments de bruit, ne peuvent être perçus que si l’oreille est placée à proximité de la source sonore. L’amplification diffusée par des haut-parleurs permet aux sonorités d’être projetées dans l’espace comme si l’oreille était placée très près de cette source, ayant ainsi accès à ces différenciations subtiles. Si les instruments ou les voix sont amplifiés, ils n’ont plus besoin de produire les techniques standardisées d’émission des sons permettant leur projection naturelle dans les grands espaces et ils peuvent maintenant se concentrer sur d’autres aspects de la production sonore. Néanmoins, l’amplification crée d’autres types de problème car elle tend à égaliser les sources sonores et à effacer l’identification de l’emplacement des sources sonores dans l’espace.
Concernant la manière avec laquelle la production sonore est encore aujourd’hui principalement considérée, il est important de noter la création à partir du XVIIIe siècle de conservatoires efficaces pour développer la discipline des instrumentistes en vue d’une homogénéité sonore dans tous les registres et de l’établissement de sonorités instrumentales extrêmement bien définies pour servir à l’unité de l’orchestre. Dernier point important concernant la rationalisation du timbre, la gamme tempérée à intervalles égaux est adoptée et dicte sa loi dans la construction de nombreux instruments, y compris plus récemment ceux de la lutherie électronique accessible dans le commerce. Cette égalisation a formé nos oreilles d’une telle manière qu’il devient très difficile de s’en détacher.
Le compositeur américain Robert Erickson (né en 1917, mort en 1997) a traité de la question du timbre dans un livre tout à fait remarquable pour l’époque, Sound Structures in Music (1975). Il est un des premiers à s’intéresser au timbre en tant que chercheur autant que musicien. Erickson a été un constructeur d’instruments, un érudit musical et très au fait des avancées de la psycho-acoustique de son époque. Il a aussi beaucoup collaboré avec des instrumentistes pour mener sa réflexion et déterminer des œuvres spécifiques (notamment avec le trompettiste Edwin Harkins pour Kryl et le percussionniste Ron George pour Percussion Loops). Tentant de définir la notion de timbre, Robert Erickson met en garde vis-à-vis de toute simplification des phénomènes sonores par des méthodes scientifiques, notamment celles liées à l’époque (années 1970) aux synthèses du sons par ordinateur. Pour lui « il est clair que le timbre est un stimulus multidimensionnel : il ne peut pas être mis en corrélation avec une seule dimension particulière » (p. 4, ma traduction). Les têtes de chapitre de ce livre peuvent donner une idée de la complexité des définitions du timbre, en vue d’envisager leur usage dans le contexte de la production musicale : « Hauteur » (notamment la question de savoir pourquoi l’oreille résiste à la fusion des hauteurs et est capable de suivre des mélodies indépendantes, p. 18-57) ; « Timbre et temps » (attaques, enveloppes, balayage du spectre, grain, réverbération, p. 58-93) ; « Drones » (c’est-à-dire « bourdons » ou musiques planantes ou bien répétitives, p. 94-105) ; « Klangfarben et organisation linéaire » (p/ 106-138) ; « Timbre au sein de textures » (p. 139-193).
Dans les faits, la notion de timbre n’appartient pas au domaine des paramètres, comme celui permettant de distinguer une clarinette d’une flûte, Le timbre est plutôt ce qui caractérise la sonorité dans sa globalité, dans sa très grande complexité. Le timbre est affecté dès que les paramètres de la hauteur, de l’intensité et de la durée sont modifiés. Le timbre est affecté par le dynamisme constant des paramètres, l’évolution du spectre, de l’intensité de l’enveloppe dans le temps. Le timbre est affecté par la mollesse ou la dureté relative des attaques. Le timbre est affecté par des modulations (vibrato par exemple) et par des instabilités mêmes minimes dans le maintien des sons. Il est affecté par la présence indispensable de bruits (souffle, archet sur la corde, bruits d’impact), sans lesquels il semble désincarné. Le timbre est ainsi en quelque sorte par rapport à la notation sur partition une existence irréductible, indépendamment de sa représentation. Il reste ce matériau impossible à maîtriser complètement, cette entité énigmatique impossible à saisir hors d’une temporalité qui passe sans laisser de traces définitives.
Pour prendre un exemple d’une pensée paramétrique de l’organisation sonore dans laquelle la dimension du timbre pose énormément de problèmes, il est intéressant d’analyser les Variations II de John Cage. Dans cette œuvre l’interprète doit jeter des feuilles transparentes (sur lesquelles est inscrit soit un point, soit une ligne) sur une surface plane (une feuille de papier par exemple) afin de déterminer par cette méthode de hasard six lignes et un point. Les lignes représentent six paramètres : « (1) la fréquence, (2) l’amplitude (intensité), (3) le timbre, (4) la durée, (5) le point d’occurrence s’inscrivant dans une période de temps déterminée (6) la structure de l’événement (le nombre de sons constituant un agrégat ou une constellation) » (Cage 1961, p. 2, ma traduction). Le point représente un événement sonore dont les paramètres sont mesurés par l’interprète, après ce tirage basé sur le hasard, de manière exacte par rapport aux six lignes. Concernant les cinq paramètres autres que le « timbre », la tâche de l’interprète ne pose que peu de problèmes, la mesure de la hauteur s’inscrira dans la tessiture de son instrument, l’intensité variera du plus piano possible au fortississimo, etc. L’instrumentiste est là dans une situation où le hasard lui dicte l’impossibilité d’interpréter, ou bien lui indique que toute interprétation (tricherie sur les prises de mesure du point par rapport aux lignes ?) n’a aucune importance, puisque personne ne pourra vérifier la véracité de l’interprétation. L’instrumentiste ou le vocaliste est là réduit soit à une marionnette encore plus servile que dans le cas des partitions « normales », soit à assumer le rôle de criminel cynique. Dans la réalisation des Variations II, si l’on s’en tient aux cinq paramètres autres que le timbre, l’interprète n’apprendra rien qu’il ne sait déjà. Le tirage et les mesures réalisées par l’interprète lui donneront l’impression d’être plus actif dans l’interprétation que lorsqu’il s’agit de réaliser en lecture à vue une partition écrite de manière traditionnelle, alors qu’il n’en est rien et qu’au contraire l’extrême passivité est la condition nécessaire à une bonne réalisation du processus proposé.
Seul le paramètre du timbre pose ici un problème très différent, car il ne peut être réduit à une linéarité. Que vont signifier les mesures prises des points successifs par rapport à la ligne déterminant le timbre ? Là, tout à coup, tout doit être inventé par rapport au contexte de celui ou celle qui réalise la pièce et à sa volonté relative d’aller visiter des contrées encore inconnues. S’agit-il de mesurer une échelle entre sombre et clair ? S’agit-il de déterminer une collection non linéaire d’effets sonores et de les classer d’une façon ou d’une autre le long d’un axe correspondant à la distance entre la ligne déterminant le timbre et la limite maximum donnée par l’espace de la surface plane choisie ? S’agit-il de classifier les timbres sur une échelle allant de la sonorité la plus normale de l’instrument à des sonorités se situant hors de l’instrument en passant par une pratique de production sonore de moins en moins acceptable dans les écoles ? S’agit-il de déterminer une échelle d’attaques du mou au dur ? S’agit-il de déterminer la durée déterminant le timbre (la durée comme paramètre N°4 étant alors appliquée à la totalité de l’événement sonore regroupant un nombre de sons déterminés par le paramètre N°6) ? S’agit-il de déterminer une échelle entre sons droits (sans éléments venant perturber la continuité du son) et sons de plus en plus modulés (vibrato, trilles, trémolos, glissando, etc.) ? S’agit-il de déterminer une échelle allant du son le plus pur (un spectre faisant ressortir fortement la fondamentale au détriment des autres partiels) au plus complexe (faire ressortir des partiels inharmoniques) ? S’agit-il de déterminer pour un événement particulier le regroupement de hauteurs faisant timbre (un seul son, deux sons consonants ou dissonants, trois sons en harmonie ou non, etc.) ? C’est dans ce cadre là que la pièce a un intérêt majeur pour celui qui la réalise, c’est la nécessité de se tourner vers l’invention du timbre. Mais pas seulement : il s’agit pour elle ou lui de trouver surtout le moyen, pour chaque événement sonore déterminé par les mesures prises par rapport aux six lignes, de résoudre les contradictions qui ne manqueront pas de se manifester entre le timbre et les autres paramètres. Comment rendre « sombre » un son suraigu, comment rendre « complexe » un son ayant une intensité à peine entendue, comment prendre en compte la hauteur, s’il s’agit d’objets de la vie quotidienne, comment prendre en compte la durée si la durée fait partie de la détermination du timbre ? Ce n’est que dans la détermination du timbre que l’interprète des Variations devient inventeur, acteur de sa production, parce que précisément le timbre n’est pas un paramètre, mais bien la totalité du son.
Makis Solomos, dans son livre De la musique au son, nous donne un très bon historique du terme de « timbre » et de ses applications dans le domaine de la musique savante européenne. Ayant noté l’impossibilité d’une cartographie des timbres, il questionne la notion de timbre de la manière suivante :
En ce début du XXIe siècle, c’est la notion même de timbre qui semble être devenue questionnable : on s’achemine vers la dissolution du concept. En effet, si, selon la définition classique, il désigne la qualité du son – la hauteur, la durée, l’intensité, la position spatiale, etc. concernant, elles, des quantités –, on peut se demander s’il est nécessaire d’avoir un mot spécifique et s’il ne serait pas préférable de parler simplement de « son ». D’ailleurs, dans le langage courant, ne parle-t-on pas du « son » de Xenakis, de Miles Davis, ou de Harnoncourt pour désigner cette fameuse qualité sonore ? (Solomos 2013, p. 39)
Un peu plus loin dans son exposé, il définit trois critères pour que la définition classique paramétrique du timbre puisse jouer pleinement sa fonction :
- la hauteur inscrite dans une durée, avec une intensité donnée doit être non seulement présente mais primordiale pour que le timbre soit identifié comme une différence supplémentaire ;
- les sons doivent se présenter dans une stabilité relative, la différence de timbre n’affectant que la comparaison entre des évènements sonores discrets ;
- les sonorités doivent être déjà assimilées par les oreilles des auditeurs.
Il poursuit sa démonstration :
Or, la musique travaille de plus en plus avec des sons qui ne répondent à aucun de ces trois critères : les nouveaux sons peuvent être bruiteux (sans hauteur déterminée), ils peuvent évoluer considérablement dans le temps et, surtout, ils ne sont pas prédéterminés. Dans la musique électroacoustique, dans les musiques populaires, une grande partie des sons sont à découvrir par l’auditeur. On n’a plus affaire à des objets clairement circonscrits, dont la causalité est claire – des « timbres » – mais à ce processus dynamique qu’est le son en général, un processus non seulement complexe, mais également hétérogène, irréductible à un certain nombre de caractéristiques physiques (ou perceptives) précises (…) En fin de compte, le mot timbre s’avère moins pertinent que le terme général de « son ». (idem)
Dans cette idée de globalité du timbre dans le « son » qui implique une diversification des modes de perception, il rejoint Daniel Charles qui notait dans Le temps de la voix, en suivant Bateson, que les dauphins ont une voix, mais pas de visage (Charles 1978, p. 273). Les dauphins, dont la pratique est de se déplacer dans les océans, n’ont pas recours à des structures paralinguistiques telles que l’attitude générale ou l’expression corporelle, qui chez les humains viennent fortement colorer la communication pour lui donner du sens. Pour Daniel Charles, la notion de Klangfarbenmelodie inaugurée par Schoenberg, est une « réhabilitation du son lui-même » (p. 275), par rapport à l’assomption fortement établie dans l’univers de la musique occidentale que le sens dépend strictement de la constance des timbres dans une structuration de relations sonores. Toute la pratique de cette musique est tournée vers la manifestation de ce sens, notamment au niveau de l’interprète qui joue son rôle de faire-valoir. Daniel Charles propose alors d’aller du son vers le timbre : on peut envisager une diversité de pratiques de sa production. Le timbre n’est plus le support secondaire des changements de hauteur et fait basculer « la modalité même de la perception ». La perception devient alors « plurale et pluraliste » (p. 276).
Pour Solomos, le son est la matière globale, mais dans ce processus, si le son ne se matérialise pas dans les caractéristiques de la notation moderne (organisée en paramètres), il est « irréductible », il flotte grâce à la présence des ondes se déplaçant dans les airs. On objectera qu’il faut bien matérialiser cette présence par des médiations qui font que ce que veut dire « son » chez Xenakis n’a absolument rien à voir avec le matériau (instruments, technologies) utilisé par Miles Davis ou Harnoncourt, et encore moins à voir avec les manières d’utiliser ce matériau, avec les conditions sociales de son élaboration, les conditions acoustiques de diffusion de son utilisation, et celles de son rapport à un public. Encore faudrait-il savoir de quel Xenakis il s’agit, parmi la diversité des supports qu’il a lui-même utilisés (ou de quel Miles Davis, ou Harnoncourt) en termes de processus pratique pour parvenir au « son ».
1.2 Notation et modernité
Avant d’aborder les problèmes spécifiques aux pratiques contemporaines de production de timbres, il me paraît important d’évoquer, à partir de références précises, l’histoire de la notation musicale dans le monde de l’art occidental. Le phénomène de l’écriture en général est très lié à l’essor de la modernité. Michel de Certeau parle, au sujet de l’acte d’écrire, « d’une pratique mythique « moderne » ». Par mythe, il entend ce qui regroupe symboliquement les pratiques hétérogènes d’une société. Pour lui, ce mythe moderne est basé sur la conception que le « « progrès » est de type scripturaire », et l’opposé de l’écriture, l’oralité est « ce qui ne travaille pas au progrès » (Certeau 1980, p. 234-35). Ce n’est donc pas par hasard si la notation musicale a pu jouer un rôle majeur dans le développement historique de la modernité artistique, notamment dans sa capacité à canaliser des pratiques et à contrôler la production sonore d’une manière tout à fait particulière. Le flottement qui persiste selon moi sur la question du timbre paraît lié aux problèmes de sa représentation sur d’autres supports qui se substituent à sa production directe.
Le système de notation de la musique que nous utilisons aujourd’hui a été développé au cours d’une très longue maturation en suivant l’histoire des représentations de l’art occidental, et qui correspond dans sa phase de stabilisation (XVIIIe siècle ?) à l’émergence du compositeur autonome vis–à-vis de l’exécution pratique des sons. L’activité du compositeur s’est de plus en plus spécialisée dans l’écriture de partitions s’adressant à un public non spécifique à travers des interprètes qui respectent ce qui est noté. La partition ou son équivalence, l’œuvre musicale, a besoin de se conformer à l’institution du concert, qui implique la présence d’interprètes spécifiquement formés et d’un public prêt à écouter dans le silence dans des espaces acoustiques appropriés. Le concept d’autonomie de l’art par rapport à tout aspect mondain ou social est directement le résultat de la canonisation de la partition comme l’objet qui incarne un opus et un auteur.
Bien que la datation du début de la modernité occidentale soit difficile à établir, on peut dire que ce système de notation convient bien aux prémices de la pensée moderne. Max Weber considère que le développement du système de notation joue un rôle très important dans l’évolution de la pensée occidentale :
Si l’on s’interroge sur les conditions spécifiques de l’évolution musicale de l’Occident, on doit y inclure avant tout autre l’invention de notre notation musicale moderne. (…) Une œuvre musicale moderne quelque peu compliquée ne saurait, sans les ressources de notre notation musicale, ni être produite ni être transmise ni être reproduite : sans cette notation, elle ne peut absolument pas exister en quelque lieu et de quelque manière que ce soit, pas même comme possession interne de son créateur. (Weber 1998, p. 117-118)
Pour Weber, une des étapes décisives du développement du système de notation musicale se situe au XIIe siècle avec la notation mesurée, l’indication précise des durées. Ce développement est lié à l’apparition de pratiques polyphoniques dans lesquelles plusieurs voix chantent en même temps des lignes mélodiques indépendantes, créant ainsi la nécessité d’un contrôle harmonique à tous les points de rencontre durant le déroulement de la musique. Ce qui dicte cette nécessité de spécifier la temporalité des actions avec une grande précision, ce sont les hauteurs, puisque différentes mélodies ont a être synchronisées par rapport à l’articulation de points de rencontre sur des consonances et éventuellement l’application de règles particulières concernant le traitement des dissonances. Comme l’a noté Christopher Page dans un chapitre intitulé « Polyphony before 1400 », les pratiques d’exécution concernant ce type de musique se sont beaucoup préoccupées de la justesse des productions vocales simultanées, en créant une hiérarchie entre des consonances parfaites et imparfaites. Cela a créé les conditions d’une très grande stabilité dans la production vocale de chaque note, un contrôle absolu sur les inflexions sonores des chanteurs. La production du timbre dépendait alors en grande partie de l’intonation juste des consonances parfaites, et de la production moins précise des imparfaites :
Pendant toute cette période qui concerne ce chapitre, les compositeurs ont exploré les contrastes entre les consonances parfaites et imparfaites avec un enthousiasme infatigable ; le calme des quintes, des octaves et des douzièmes, et la beauté presque furieuse des consonances imparfaites qui pouvaient être augmentées (…) au point de devenir des dissonances dérangeantes – c’était ce qui constituait les matériaux bruts de la composition pour les musiciens de l’Ars Antiqua et de l’Ars Nova. Pour les interprètes, la fidélité à l’équilibre des intervalles constituait leur tâche primordiale, et depuis l’enfance leurs oreilles étaient formées pour identifier la subtilité des différences dans la production des hauteurs. (Page 1989, p. 80)
Pour le même auteur, l’utilisation d’un seul chanteur par partie d’une polyphonie permettait une extrême précision dans la focalisation de la hauteur, et tout écart à cette manière extrêmement précise de produire un son vocal était traité comme un simple ornement :
La même chose peut être dite du vibrato, une plus ou moins rapide fluctuation de la hauteur ; bien que le vibrato apparaît comme ayant été employé comme un ornement dans l’organum à deux voix de la tradition parisienne, il s’agit d’une imprécision voulue dans la justesse, et il est inconcevable de penser que les interprètes de l’époque médiévale aient pu envisager cela autrement que comme ornementation. (p. 84)
Déjà, à ce moment de l’histoire déterminé par Max Weber comme crucial pour le développement de la notation moderne, le domaine du compositeur est déterminé comme une préoccupation de l’organisation des hauteurs et de leurs inscriptions dans le temps. Le timbre est laissé au soin des pratiques des exécutants, eux-mêmes ayant mission de se concentrer sur une production claire, uniforme et précise des hauteurs appropriée à un contexte religieux. Pourtant, comme le note Weber, il n’y avait pas de séparation stricte entre la composition écrite et son interprétation, car l’improvisation sur un cantus firmus a été une pratique courante pendant une très longue période.
L’œuvre notée, identifiée à un auteur particulier, n’acquiert son statut définitif que lorsqu’il existe une stricte séparation entre la production créative et l’exécution, entre le compositeur et l’interprète. Cela ne semble pas être le cas avant la deuxième partie du XVIIIe siècle. Même alors, les interprètes avaient encore une connaissance de la signification des partitions contemporaines en termes de style, de phrasé et de qualité sonore. Ils avaient la capacité de déduire dans une pratique effective ce que la partition ne précisait pas. Ce n’est qu’à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que cette séparation entre le compositeur et l’interprète a pris une tournure plus significative, lorsque les concerts ont commencé à mélanger des œuvres de compositeurs morts avec ceux encore vivants, créant ainsi des écarts entre les pratiques courantes et les conditions historiques et technologiques de production, entre les traditions des interprètes et les innovations des compositeurs. Et ce n’est vraiment que vers la moitié du XXe siècle que cette séparation a pris une tournure définitive, au moment où la signification d’une partition donnée s’incarnait complètement dans celle-ci, chaque compositeur revendiquant sa propre technique ou même son propre langage, chaque partition se revendiquant par sa structure propre, comme séparée de toute autre.
Dans ces conditions l’œuvre musicale accède à un statut d’indépendance vis-à-vis de son auteur, elle existe dans le temps au-delà de la mort de celui-ci, elle est continuellement réinterprétée, à chaque fois qu’elle est jouée. En cela, l’œuvre-partition interpelle les compositeurs qui suivent à ne pas écrire la même chose, elle porte en soi l’interdiction du plagiat et la nécessité d’une évolution continuelle. Elle fonde aussi la logique de l’avant-garde, de l’innovation musicale en rupture avec la tradition, avec les inventions d’hier et les formes transmises des maîtres anciens.
Avec cette économie de moyens, ce système de notation ayant été élaboré selon un principe très proche de l’écriture alphabétique, a cette capacité admirable de permettre la possibilité de déchiffrer à vue les signes écrits et de les transformer de manière immédiate en sonorités appropriées par des musiciens ayant développé les automatismes nécessaires à cette traduction, tout en laissant ouverte au lecteur, comme le texte, la possibilité de l’interprétation. La distance qui existe entre la notation en relation avec les sonorités réelles permet l’expression d’une diversité de styles à travers l’utilisation d’un médium unique, universellement utilisé. Cette distance permet aux compositeurs et aux musicologues de réfléchir sur les pratiques, et ce faisant, de gagner une certaine indépendance vis-à-vis de la tradition.
D’une part, la notation occidentale se refuse à être une simple tablature, c’est-à-dire une série de signes déterminant des actions à faire sur l’instrument, car elle doit avoir la possibilité « structurelle » de représenter des éléments de syntaxes basés sur une combinatoire de hauteurs (basée sur des collections de hauteurs discrètes formant des gammes) et sur une découpe régulière du temps s’inscrivant dans des durées très précises. La notation par tablature ne permettrait pas de développer un système lisible unifié, commun à tous les musiciens quelles que soient les actions à faire sur un instrument ou avec la voix, ou avec n’importe quel outil qui pourrait être éventuellement développé à l’avenir pour produire des sons. C’est donc un système qui a l’ambition d’être universel et, comme l’écriture alphabétique, de rester neutre vis-à-vis des usages infinis qu’on peut en faire. Pourtant, comme dans le cas de la tablature, l’injonction à l’action dans un temps déterminé lorsque le signe apparaît à l’œil du musicien reste un élément essentiel du système : un signe correspond bien à une action.
D’autre part, on peut remarquer la correspondance exacte entre la manière avec laquelle les instruments à claviers de la musique occidentale sont agencés et l’organisation de l’espace sur la portée : touches blanches – notes naturelles ; touches noires – notes diésées ou bémolisées ; transposition de la disposition horizontale du clavier dans l’espace vertical de la partition, permettant l’automatisme de lecture-action du grave (vers la gauche du clavier – vers le bas de la portée) à l’aigu (vers la droite du clavier – vers le haut de la portée).
Ce système de notation ne représente pas, loin s’en faut, la réalité complexe des sonorités. Contrairement aux supports développés au XXe siècle d’enregistrement des sons qui les restituent dans leur globalité, servant ainsi de références indiscutables aux oreilles, la notation de la musique occidentale laisse une grande part à l’interprétation dans sa traduction en sonorités. Elle implique ainsi la présence parallèle de musiciens capables non seulement de déchiffrer les signes mais surtout de les traduire avec compétence en sonorités appropriées sur des instruments construits de façon à les produire correctement. Pourtant, cette notation est centrée sur la représentation des paramètres sonores qu’on est capable de mesurer de manière assez précises à la fois par des appareils de mesures (diapason, métronome par exemple) et par les oreilles exercées des participants : notamment les hauteurs et les durées. Dès qu’il s’agit de représenter de manière visuelle la totalité d’une sonorité donnée, on atteint rapidement les limites de lisibilité par l’accumulation de signes pour décrire un seul et même événement, l’accumulation de signes d’action pour produire une palette de sonorités, l’accumulation de textes explicatifs, ou l’adoption d’une écriture globalisante impossible à déchiffrer par des humains (la représentation de la trace de l’onde sonore par exemple).
Malgré la très grande précision de la notation musicale sur certains points essentiels, c’est bien cette manière imprécise qu’elle a de représenter les sons (et les actions) qui fait la force du système et assure sa pérennité malgré toutes les tentatives pour la faire évoluer ou pour la changer. Les aspects précis garantissent l’identification de l’œuvre chaque fois qu’elle est jouée, et l’imprécision laisse un espace de liberté d’interprétation qui détache l’œuvre de son auteur et permet sa survivance dans le temps historique grâce au renouvellement de son interprétation au fil des changements technologiques ou culturels.
1.3 Cartographie
Bruno Latour, dans son projet d’anthropologie des Modernes (Enquête sur les modes d’existence) a utilisé l’exemple pratique de la randonnée pédestre en montagne, précisément autour du mont Aiguille dans le Vercors, afin de poser la question de la Science dans son rapport à la raison, à l’irrationalité et à la matérialité des objets et des pratiques. Sa démonstration est centrée sur le jeu de deux éléments : la carte topographique représentant le mont Aiguille et le mont Aiguille lui-même. Entre ces deux éléments se place le randonneur et la réalisation de la randonnée. La stabilisation de la pratique du randonneur dépend de toute une série de médiations qui concernent le travail immense qui a mené à la confection de la carte topographique dans une temporalité historique spécifique et les nombreux repères sur le terrain (tracé des chemins, balises, cairns) issus d’une temporalité historique différente. Une autre médiation qui permet la randonnée concerne les objets utilisés pour la réaliser (chaussures, sac à dos, boussole, GPS…) et autres documents (guides touristiques, récits historiques…). Le mont Aiguille lui-même propose dans la persistance de son existence une durée d’une toute autre échelle et affirme par là son autonomie. Enfin, les circonstances atmosphériques dans lesquelles la randonnée se déroule viennent de manière dynamique rendre encore plus complexe les conditions de l’orientation du promeneur, dans une temporalité immédiate et changeante. Pour Latour, et c’est là le point essentiel de sa démonstration, le problème des « Modernes » concerne le fait qu’ils considèrent ces éléments épars comme formant une forme unique, notamment en pensant que l’équivalence de la carte et du mont se conforme à la structuration de la carte pour oublier les réalités du mont :
Mais voilà qui n’explique pas l’efficacité de ma carte, car le mont Aiguille, quant à lui, n’est toujours pas à deux dimensions, ne se replie toujours pas dans ma poche, ne semble toujours pas marqué par aucune courbe de niveau et d’ailleurs aujourd’hui qu’il disparaît dans les nuages, il n’a aucunement l’aspect du petit tas de gribouillis calibrés marqués en lettres noires et obliques de corps quinze « mont Aiguille » qui figure sur ma carte. Comment faire pour superposer la carte et le territoire ? Il suffit de faire comme si le mont Aiguille lui-même, en son fond, dans sa nature profonde, était lui aussi fait en formes géométriques. Alors là tout s’explique en effet d’un coup : la carte ressemble au territoire parce que le territoire est au fond déjà une carte ! (Latour 2012, p. 121)
Bruno Latour note le décalage chez les Modernes entre l’expérience et sa représentation. Chez eux, l’expérience ne peut être prise en compte que si elle est découpée en autant d’éléments capables d’être représentés ou rationalisés dans des faits indéniables. Mais la complexité globale de l’expérience, par la présence de médiations multiples dynamiquement interactives, reste réduite à peu de considération. Sous le nom de « sens commun », réputé simpliste, sinon carrément niais, l’expérience appartient au monde oral de la pré-modernité, fait de croyances, de superstitions et de pratiques implicites.
Peut-on alors comparer cette manière de penser avec ce qu’induit la notation musicale des Modernes ? Dans ce contexte aussi, les médiations et les spécificités temporelles multiples tendent à s’effacer au profit de mécanismes automatisés bien huilés. Une difficulté toutefois se présente pour que la comparaison avec l’existence du mont Aiguille et ses chemins soit pertinente. Il est aisé de considérer que la partition musicale joue exactement le même rôle que la carte topographique, dans sa représentation formalisée autour de quelques concepts essentiels et non pas de la réalité physique une et entière. L’équivalent de la fixité massive du mont Aiguille est plus difficile à établir dans le contexte musical. On serait plutôt en présence d’une plus grande diversité de médiations dynamiques parmi lesquelles l’instrument de musique serait l’élément le plus stable, mais où l’élément essentiel du « paysage », le son s’échappant dans l’espace est de nature évanescente et changeante.
Il est difficile d’envisager que le fondement de la musique, « dans sa nature profonde », correspondrait à une représentation sur le papier, car la partition n’est rien sans sa transformation en sonorités qui viennent frapper les oreilles des auditeurs. Seuls les sons comptent et l’œuvre n’existe pas si on ne l’entend pas sonner. Pourtant, la notation musicale, lorsqu’elle passe du statut de simple documentation (aide-mémoire) à celui de prescription principale d’actions à réaliser, devient l’incarnation de la réalité de l’œuvre en dehors de l’expérience de ses sonorités.
La partition est déposée pour garantir le droit d’auteur, elle permet l’accès à la pensée et aux structures musicales des compositeurs absents, qu’ils soient morts ou éloignés, elle est la preuve de l’existence autonome de l’œuvre dans l’histoire, malgré les diverses interprétations qu’elle peut susciter. Surtout la notation qui prescrit des actions, des formules syntaxiques et des formes dicte la nature de toutes les médiations. Ce qui est noté de manière précise, le contour des hauteurs et leur distribution dans le temps compte comme base incontournable de la perception et dicte ainsi progressivement des modes de perception des sons impossibles à contourner. Les concepts de « mélodie », d’« harmonie », de « polyphonie » (etc.) – tous centrés sur l’agencement de hauteurs dans le temps (synchronique ou diachronique) – deviennent, dans des formes de complexité spécifiques à ce que permet la notation, les piliers des rapports signes/sons pour les usagers.
La mise en mélodie conforme à ce que la notation prescrit, l’adoption du système d’intonation tempérée, le contrôle des transitoires et des inflexions particulières, l’harmonisation selon des règles établies et la réorchestration avec des instruments standardisés, constituent la forme technique d’une récupération socio-centrée, conforme aux représentations colonialistes appuyées sur les idées de progrès civilisationnel, des musiques traditionnelles du monde par l’occident, savant autant que commercial. La notation occidentale et les pratiques qui l’accompagnent, imposent au monde entier une manière particulière de percevoir les successions et agrégats de sonorités. Le phénomène de réification de la musique commerciale reprochée par les tenants de la musique savante européenne est ainsi directement lié au système de notation que ces derniers ont mis en place.
La musique issue de la notation articule en effet chez l’auditeur des logiques, par rapport à des successions sonores déjà connues, de prédiction des évènements à venir et de leur accomplissement. L’auditeur, par rapport à ce qu’il a déjà assimilé par l’écoute répétée de musiques particulières, est capable de prévoir à partir d’une formule reconnaissable la suite de la narration musicale, l’œuvre du compositeur propose une suite particulière qui répond plus ou moins à cette attente dans une dialectique entre conformité à la normalité et divergence plus ou moins affirmée à ces normes. La musique sans surprise, conforme à l’attente des auditeurs, sera ennuyeuse ; celle qui n’est constituée que par des surprises, divergentes par rapport aux oreilles des auditeurs, ne pourra faire sens pour eux, sauf après de nombreuses écoutes (voir Leonard B. Meyer 1956). On objectera sans doute que la structuration en succession de hauteurs (le mélodique) se retrouve dans bien des traditions musicales et n’est pas spécifique aux musiques écrites du monde occidental. Mais la force du système, c’est la possibilité d’agencer les hauteurs dans des configurations plus ou moins complexes et qui par la liberté accordée à celui qui est face à sa page blanche, de les agencer « à sa manière » (voir Michel de Certeau 1980). L’importance donnée au contenu narratif et la possibilité de réaliser la pré-planification des structures créent une relation quasi-automatique entre la musique notée sur papier et l’élaboration syntactique de quasi-langages. La rationalité qui fait partie intègre du système de notation occidental, avec sa tendance à mettre les enjeux du côté des narrations syntactiques et de la structuration imaginative, et qui produit l’avènement des notions d’œuvre autonome, différente de toutes les autres, du style personnel que le compositeur doit acquérir pour se distinguer des autres, de la succession des « langages » et des époques historiques, tout cela constitue l’essentiel de ce qui est considéré comme moderne.
1.4 Syntaxe ou sonorité
Dès que le timbre dans sa manifestation instable et quelque peu sauvage affirme son existence, grâce notamment à des progrès techniques ou par les avancées de la science, les musiciens issus de la pensée moderne pensent qu’il y a danger et veulent développer des méthodes pour le contrôler. Face à la possibilité de stocker n’importe quel son par l’enregistrement électro-acoustique, face à la possibilité de synthétiser les sons par des moyens informatiques ou électroniques, face au développement extraordinaire depuis une cinquantaine d’années des recherches sur l’acoustique et la psycho-acoustique, il convient d’inventer des solfèges ou des modes d’accès équivalents au pouvoir structurant de la notation sur partition. En particulier, la traduction du timbre en mensuration des hauteurs qui le compose (analyse du spectre) devient la méthode principale pour continuer à affirmer la suprématie de la structuration rationnelle centrée sur les hauteurs. L’idée de grammaire, de langage, de succession d’évènements faisant sens, dans une relation entre fond et forme, restent des représentations dominantes dans la pensée de la musique contemporaine, même lorsque la sonorité en tant que telle devient un objet au centre des préoccupations des structures compositionnelles.
Dans le cas d’une musique basée sur la complexité syntaxique, l’accent est mis sur l’unité de relation entre des éléments discrets qui se succèdent pour former un discours musical signifiant, les aspects instables du timbre doivent être mis entre parenthèses au profit de cette unité. Dans le cas d’une musique prenant en compte l’instabilité complexe du timbre, les éléments syntaxiques doivent au contraire être réduits à des choses très simples. Plus l’accent est mis sur une syntaxe, moins le timbre doit venir gêner la perception du discours ; plus l’accent est mis sur la sonorité, moins la syntaxe doit venir s’imposer comme principe directeur ; bien sûr, on peut penser que toute musique se situera entre ces deux pôles. On retrouve là les éléments de la querelle entre Rousseau et Rameau au sujet du mélodique et de l’harmonique, sauf que la mélodie est pour Rousseau du côté de la simple nature et que l’harmonie chez Rameau est un moyen de développer un langage (une grammaire) d’affects. Dans les musiques basées sur le principe de cycle, une même succession syntaxique se répétant indéfiniment, l’intérêt de l’oreille se déplace vers des éléments qui vont dans le sens de la complexité du timbre, ornementations, inflexions différentes, manières différentes de dire la même chose, tournures instrumentales ou vocales. Dans les musiques basées sur des phrases et une évolution constante des éléments, l’oreille fonctionne sur le plaisir du parcours : où va-t-on nous mener ? L’oreille anticipe la suite des évènements et la compréhension du discours va dépendre du fait que cette anticipation soit en partie réalisée et en partie déniée dans des éléments de surprise qui rendent vivant le propos.
Prenons un exemple : le carillon d’une église, qui dans les temps anciens servait de moyen important de communication d’informations et qui continue de le faire quelque peu aujourd’hui. Lorsque le carillon sonne « à toute volée », l’oreille ne se préoccupe pas de la succession des hauteurs dans le temps, elle entend un objet sonore qui fait « carillon » : « Tiens, des cloches ! ». Lorsque sonne le glas, la périodicité lente d’une seule cloche grave ne frappe l’oreille que pour quelques secondes : « Tiens, le glas ! ». Puis l’oreille peut entendre la cloche en tant que telle puisque le niveau syntaxique reste indifférencié « Tiens, quelle cloche admirable ! ». Lorsque le carillon se met à jouer une mélodie connue ou structurée de manière familière, l’oreille est attirée vers la reconnaissance de cette mélodie, la sonorité des cloches ne devenant que le support secondaire de cette mélodie : « Tiens, je connais cet air ! ».
Makis Solomos, à la fin de son ouvrage De la musique au son, note cette polarisation de la perception entre timbre et syntaxe :
Deux moments de notre histoire, qui en représentent les pôles opposés en attestent. Le premier se centre sur le son pour mettre en valeur l’écoute. Le son y est souvent matière, nature et il s’agit de lui permettre de se déployer librement afin que nous (re)découvrions cette faculté que la musique a tendance à délaisser : apprendre à écouter, à analyser les détails infimes d’un son, voilà l’un des aboutissements de ce recentrement sur le son. Quant à l’autre aboutissement, il réside dans le moment où l’on parle de son pour désigner des entités construites, fabriquées selon un projet compositionnel : l’œuvre musicale, dans sa totalité – du micro- au macrotemps – y est totalement articulée. Qu’y a-t-il de plus propre à l’art (des sons) que d’un côté, l’écoute et, de l’autre, l’articulation ? (Solomos 2013, p. 495)
Pour être comprise, cette citation doit être reliée à deux questions que soulève Makis Solomos : premièrement, la présentation d’un catalogue de sons pur et simple pourrait signaler une dégradation complète de la notion d’art pour le réduire à une pratique quotidienne dépourvue d’enjeux réels, incapable d’exprimer des valeurs esthétiques et d’élever la production créative au-dessus de l’ordinaire. Deuxièmement, la fixation des sons par l’enregistrement crée la possibilité d’une réification du son et sa réduction à un objet marchand, phénomène déjà noté par Adorno dans sa dénonciation du « caractère fétichiste » de la musique lorsqu’elle est fixée par les moyens des technologies de la reproduction. Nous reviendrons sur ces questions dans la section suivante.
Il faut reconnaître que cette rationalisation de la perception en deux axes distincts (grammaire de succession de hauteurs, affirmation de la sonorité) atteint pourtant très vite ses limites. Le timbre n’est pas un élément brut, en-soi, il dépend d’une part du contexte dans lequel il s’inscrit et, d’autre part, d’éléments syntaxiques – articulations, rythmes, figures, motifs, accentuations, modulations, nuances – pour être perçu comme sonorité en comparaison avec d’autres. Ces deux conditions de perception déterminent le fait que, de toute manière, les sonorités sont toujours comparées à d’autres. La syntaxe des successions de hauteurs, devient sonorité brute, dès que l’oreille n’est plus capable de suivre les éléments du discours, pour les anticiper. Ainsi, l’utilisation de séries dodécaphoniques, organisant pour chaque instance une certaine relation particulière entre les hauteurs, sera perçue comme timbre général (on pourra dire alors « grisaille » de timbre !) jusqu’au moment où l’oreille aura pu par la répétition s’adapter aux conditions de la nouvelle syntaxe. Impossible dans ces conditions de se reposer sur une logique unique des rapports entre hauteurs et globalité du timbre dans leurs inscriptions dans le temps. Il n’en reste pas moins que d’une façon générale, le phénomène de perception tend soit à se concentrer vers les successions d’éléments ayant une ressemblance de timbre, soit vers des sonorités qui se différencient (Klangfarbenmelodie).
1.5 Le concept de la « note »
Ce qui est noté, les contours de hauteurs et leur distribution dans le temps, compte comme base incontournable de la perception et dicte des modes de perception très difficiles à modifier. L’organisation de l’espace de la carte d’état-major, la sinuosité des chemins, des cours d’eau, des lignes, des limites ou frontières (de ce qui se développe dans l’espace topographique) et des courbes de niveaux imposent chez les usagers une rationalité particulière de l’espace qui les entoure. Le reste demeure secondaire par son caractère anecdotique : des signes décrivant des points remarquables, monuments, sources, maisons, etc. ; des couleurs pour caractériser les routes, la végétation, les eaux stagnantes ou non, etc. ; des textes servant à nommer les lieux. Ces signes secondaires représentent des éléments qui peuvent changer dans un temps relativement court (ils peuvent disparaître et de nouveaux éléments peuvent apparaître) alors que l’espace représenté par la carte reste immuable. On retrouve là ce qui correspond dans la partition aux accentuations, nuances, indications instrumentales et textes subjectifs, ils restent imprécis par rapport à l’espace immuable de la carte des hauteurs et des durées.
Le concept de note correspond-t-il à une réalité des perceptions acoustiques en tant qu’unité première de toute musique ? Cela paraît à première vue un fait établi sans aucun doute possible. La perception de l’oreille humaine s’attache à des successions de petites unités de durées qui n’excèdent pas la capacité du souffle, et qui sont assez longues pour que soit perçu un minimum de substance sonore. Cette durée minimum de la note correspond la plupart du temps à la possibilité de percevoir une hauteur. Mais la note notée sur du papier n’a-t-elle pas acquis une autonomie dans la séparation du signe par rapport à ce qui est représenté ? La note écrite de la musique savante occidentale, pour être notationnelle, comme l’exige Nelson Goodman (2005), et avoir ainsi le droit de représenter l’œuvre dans le temps historique, doit avoir obligatoirement une certaine stabilité, un caractère non ambigu. Chaque fois que la note est répétée, elle doit correspondre à la même sonorité. Elle doit pouvoir se distinguer des autres notes selon des principes de clarté et de stabilité. Dans cette tradition, son rôle principal est de représenter une hauteur précise fixée, qui détermine dans la pratique la notion exacte de justesse, de plus en plus contrôlée par des appareils scientifiques. La valeur du faux et du juste ne souffre pas alors de milieu ou de relativité, même si dans la réalité le relativisme est souvent une occurrence inévitable.
Le concept de la note écrite sur partition semble convenir à merveille aux instruments à clavier qui sont devenus le modèle instrumental dominant des pratiques musicales dans l’occident artistique. Ce qui compte c’est l’indication du déclenchement de la note, et ce qui suit cette attaque reste non spécifié comme résonance. L’idéal des instruments à clavier, c’est qu’ils puissent offrir une sonorité homogène sur toute l’étendue de leur gamme de hauteurs, sur plusieurs octaves. On retrouve cet idéal dans l’utilisation des autres instruments : ceux qui ont la capacité de soutenir le son après l’attaque (les cordes, les vents) vont plutôt être utilisés dans le sens d’une homogénéité à la fois dans les tessitures et dans la stabilisation standardisée de leur enveloppe. Si des modifications peuvent être apportées dans le cours du soutien sonore après l’attaque, il s’agit d’une façon générale d’évolutions linéaires ou régulières (crescendo, decrescendo, vibrato peu exagéré et régulier, legato entre les notes). Les compositeurs qui depuis les années 1950 ont tenté de sortir de cet idéal en s’intéressant à ce qui se passe à l’intérieur même d’une note ont été obligés de recourir à des moyens de représentation qui entraient avec difficulté dans le système de notation centré sur la note. La conception tacite de la note chez les musiciens qui sont formés à sa lecture et à sa réalisation instantanée, c’est que la note n’existe que dans une représentation d’une sonorité figée, qui au delà de ses spécifications de hauteur, de durée et d’intensité, n’évolue pas dans le temps de sa réalisation.
La note devient l’objet sacré auquel les apprentis musiciens doivent, dès la première minute de musique, absolument se confronter. Que la note n’ait alors aucun sens par rapport aux autres notes semble être d’une importance très secondaire au fait de la reconnaître à vue et à l’oreille, de la produire en chantant ou en la jouant sur un instrument, de manière individuelle (note par note) ou dans les formules types des exercices « de base », musiques embryonnaires mais pas encore pleinement constituées.
C’est cette situation — fortement amplifiée — de stagnation et d’inertie que dénonce le sociologue Howard Becker. Les institutions de la musique « classique » occidentale imposent à tous un « packaging » dont il est fort difficile de se défaire, ou même de le faire évoluer :
Bref, la façon de faire de la musique est ce que les sociologues de la science ont fini par nommer, de façon peut-être assez peu originale, un « lot » (package). Chaque élément du lot présuppose l’existence de tous les autres. Ils sont tous reliés, de telle sorte que lorsqu’on en choisit un, il est extrêmement aisé de prendre tout ce qui vient avec, et extrêmement difficile de procéder à la moindre substitution. C’est le lot qui exerce son hégémonie et qui contient la force d’inertie, si tant est qu’on puisse attribuer cette qualité à une pareille création conceptuelle. (…) Ce lot qu’est la musique de concert inclut un ensemble d’organismes de formation. Les écoles de musique professionnelles produisent des musiciens qui peuvent satisfaire à toutes les exigences des autres composantes du lot : études rapides avec une virtuosité permettant de s’adapter à toute une palette de chefs d’orchestre. (Becker 1999, p. 64-66)
Dans ces conditions, les musiciens – et ils sont très nombreux – qui pour une raison ou pour une autre ne travaillent pas à l’intérieur du système ou du « lot » (musiques non basées sur le système de notation occidental, accords différents des instruments, organisation sociale de la musique différente, rapports hybrides avec d’autres arts…) ont de grandes difficultés de par le monde à s’intégrer dans les institutions d’enseignement. Soit ils acceptent des règles qui vont profondément modifier les conditions mêmes de la pratique de leur art, soit ils préfèreront rester en dehors des institutions (ou en créant leurs propres institutions séparées) dans la marge de la société musicale officielle. La rencontre effective et réciproque des pratiques qui différencient leur production de timbre par des dispositifs, des procédures, des relations, des lutheries, des manières de transmettre différentes n’est que trop rare dans notre société pourtant réputée pour la diffusion électronique infinie de musiques historiques et géographiques différentes.
1.6 Détour par les technologies électroniques
Existe-t-il un danger, dans le cadre des technologies électroniques liées au son, d’une manipulation des individus par le truchement d’une industrie culturelle très puissante à l’échelle mondiale ? C’est une question souvent soulevée dans les milieux de l’art contemporain. Qu’en est-il ? Deux éléments semblent entrer principalement dans le jeu des controverses actuelles. D’une part la capacité de reproduire à l’identique les sonorités stockées dans les mémoires tend à figer le timbre dans des objets stéréotypés. D’autre part les sonorités stockées peuvent être aisément piratées pour être réutilisées dans des contextes complètement différents de ceux liés aux intentions exprimées lors de leurs productions initiales.
Adorno – qui a énergiquement défendu l’écoute structurelle, celle qui est capable de mettre en relation le détail de la production sonore, la grammaire locale, avec la forme entière de l’œuvre, le discours musical global – s’est attaqué à la tendance des techniques de reproduction sonore à réifier les figures musicales. Dans un article très prospectif pour son époque (1934), « Die Form der Schallplatte » (La forme du disque) (Adorno 1984, p. 530-534), Adorno traite de cet objet capable de produire le son – le disque – de porter en son sein le déroulement de n’importe quelle succession sonore dans les timbres mêmes des instruments ou voix d’origine. Pour la première fois, les sons sont susceptibles d’être incarnés dans un objet qu’on peut emporter et écouter dans le quotidien de son chez-soi. La musique, art temporel évanescent, se solidifie dans la cire des sillons mêmes de cette surface « plate » pas beaucoup plus grande qu’un livre. Pour Adorno, le disque ne révèle rien de beaucoup plus que l’aspect énigmatique de ces sillons menant au néant du centre formé par l’étiquette ronde du titre : « Des lignes courbes le parcourent, une écriture finement ondulée tout à fait illisible » (idem). Cette écriture est bien différente de celle qui permet aux musiciens de faire de la musique. La notion d’écriture n’est ici pas évidente dans la mesure où s’il n’y a pas de lisibilité elle ne servirait à rien. Peter Szendy, citant le même texte d’Adorno souligne que « les sillons du disque ne rendent plus raison (comme le fait la notation solfégique) de ce que l’on entend » (Szendy 2001, p. 100). Pour lui, en tant que langage-machine, il s’agit d’une « écriture trop idiomatique – c’est-à-dire, selon l’étymologie, trop idiote » (idem). Pourtant, s’inspirant de la pratique des DJs, Szendy propose la notion de « l’écoute au bout des doigts » (p. 164). Mais cette pratique ne constitue pas pour autant une « lecture », parce qu’elle est gouvernée par les oreilles et non les yeux, « c’est une opération auriculaire ». Si les sillons du disque ne sont ni écriture, ni lecture, ils n’en impliquent pas moins de nouvelles pratiques qui modifient considérablement les conditions de la perception auditive. Et par extension les conditions de la production musicale. Il faut rappeler ici que plus on essaie de représenter le timbre dans toute sa complexité, plus on sera obligé de remplir la partition de signes au point de la rendre de moins en moins lisible. La représentation de l’onde sonore, que Adorno appelle écriture dans le contexte du disque, est l’ultime représentation du timbre dans son exactitude la plus complète possible.
Notons au passage, que l’idéal de l’écoute musicale dans les institutions d’enseignement de la musique reste, dans le cursus classique, très centré sur la perception d’objets dont la reconnaissance des hauteurs et durées prime fortement sur celle de la couleur sonore, limitée elle à la reconnaissance des instruments ou du style des œuvres. Pour que l’exercice scolaire ne soit pas trop difficile, les sons doivent perdre beaucoup de leur complexité. S’agit-il ici d’une nécessité éducative ou d’une manipulation des oreilles ?
Pour revenir aux propos d’Adorno, la sonorité, dans son incarnation dans les sillons du disque, devient écriture en tant que telle :
Qui a reconnu la contrainte toujours grandissante qu’exercent depuis les cinquante dernières années la notation et l’aspect graphique de la page musicale sur les compositeurs (l’expression péjorative « musique de papier » la dénonce énergiquement), ne s’étonnera pas de voir se produire un jour une transformation telle que la musique, autrefois déterminée par l’écriture, devienne soudainement elle-même écriture : au prix de son immédiateté, mais avec l’espoir que fixée de la sorte elle sera lisible en tant que « dernier langage de l’humanité entière après la construction de la Tour », un langage dont les énoncés à la fois précis et énigmatiques habitent chaque « phrase ». Si les notes autrefois en étaient encore les signes, ce langage en utilisant les circonvolutions de l’aiguille se rapproche de façon décisive de son véritable caractère d’écriture. De façon décisive parce que, en s’abandonnant à sa nature de signe, cette écriture est identifiable en tant que langage authentique : liée indissociablement à la sonorité propre à ce sillon et à nul autre. (Adorno 1984, p. 279-280)
Adorno s’inspire ici d’un passage de L’origine du drame tragique allemand de Walter Benjamin se posant des questions sur les rapports de la musique au langage. Benjamin, lui-même, s’inspire dans ce passage des travaux de Johann Wilhelm Ritter, un physicien et chimiste allemand (1776-1810) ayant fait des expériences sur les figures de Chladni, produites par la répartition du sable sur des membranes ou plaques en vibration. Pour Ritter, ces figures créent la possibilité d’envisager une forme d’écriture directement liée au son et inséparable de sa manifestation : « Chaque figure sonore est une figure électrique, et chaque figure électrique est une figure sonore » (Ritter, cité dans Benjamin 2009, p. 214). Pour Walter Benjamin, la « divination » de Ritter ouvre la voie à une série de questions (sans réponses) : un rapprochement serait possible entre l’oralité et l’écriture, la musique pourrait être vue comme une écriture archaïque (après Babel) antithétique au langage signifiant, et le langage écrit se serait alors développé à partir de la musique plutôt qu’à partir des sonorités de la parole.
Adorno reprend cette idée d’une écriture archaïque équivalente à la musique elle-même pour décrire l’écriture des sillons du disque comme capable de garder en mémoire le jeu éphémère des sons, mais non pas comme un support capable de générer de lui-même des œuvres spécialement conçues pour lui. Il ne peut anticiper en 1934 sur les développements des musiques électroacoustiques sur bande et bien sûr encore moins sur la numérisation et la dématérialisation des technologies sonores. Pour lui, aller au-delà de la préservation de ce qui est joué de manière vivante au concert, serait tomber dans ce qu’il va dénoncer dans un article qui va suivre : la fétichisation des sons dans des objets marchands et leurs contrôles par l’industrie culturelle (Adorno 1988, p. 138-167). Il n’envisage pas non plus que ce nouveau type de support puisse être un outil remarquable pour les musiques de traditions orales, et notamment pour le jazz (déjà beaucoup influencé par les formes écrites sur du papier) qui va pouvoir se développer de manière singulière selon les mêmes contours que les musiques européennes d’avant-garde (voir à ce sujet les travaux de George Lewis 2004a, 2004b, 2008, notamment ceux qui retracent l’histoire de l’A.A.C.M. de Chicago).
Qu’implique en effet pour le jazz, une pratique qui mélange oralité et écriture, la référence majeure de l’enregistrement sur disque, parallèlement à une représentation sur partition volontairement peu précise (grilles et pratiques d’interprétation des signes à partir d’une tradition) ? Comment s’inscrit dans ce type de pratique le principe de l’imitation et par là, en conséquence, de l’expression de différenciations et de divergences dans les sonorités ? Il n’est pas tout à fait dans mes compétences de répondre à ces questions. Il me semble pourtant que l’enregistrement des sons comme support à une pratique implique, en faisant abstraction d’autres éléments tels que la transmission d’une tradition et les gestes visuels, dans le cas de l’imitation, l’impossibilité d’y parvenir complètement. L’écriture sur partition par sa précision sur des paramètres particuliers, peut être précisément mesurée en terme de réalisation réussie ou non des signes dans le domaine sonore, laissant par ailleurs une marge de liberté dans l’interprétation. Le rôle d’assignation à faire des actions spécifiques de la notation, et non pas seulement d’être un moyen de consignation d’évènements, n’est viable que s’il existe des contrôles débouchant sur une évaluation. La globalité de l’objet sonore enregistré, tout en restant un modèle fort pour une pratique donnée, ne permet pas d’accéder par ce seul support à l’authenticité du modèle, ce qui constitue un avantage pour ceux qui considèrent que la répétition imitative des sons, par son académisme, est contraire à l’idéal de créativité. Seul l’échantillonnage électronique permet la répétition exacte et immuable, avec une tendance à réifier la tradition, et par là en quelque sorte à la tuer. Pourtant, pour Derek Bailey, le jazz des années 1980 souffre beaucoup, grâce à la combinaison de plusieurs supports (enregistrements, Real Book, enseignements, méthodes, contacts directs avec des maîtres, etc.), de n’être plus qu’une imitation servile, jusque dans les figures mélodico-harmoniques de l’improvisation, de ce qui avait été dans l’histoire une émancipation politique et artistique des formes traditionnelles (Bailey 1999). Cette importante parenthèse permet de continuer le fil de la pensée.
Cette conception formulée par Adorno de l’écriture totale et illisible de la reproduction de l’onde sonore par des supports analogiques (qui a pris un essor particulier par la suite dans le numérique) a-t-elle vraiment été reprise par la suite par les théoriciens et historiens de la musique, en vue d’une réflexion qui irait au-delà du caractère tautologique de cette observation ? C’est-à-dire a-t-on vraiment posé le problème en termes de ce que les technologies impliquent par rapport aux pratiques musicales et non pas exclusivement par rapport au progrès de la science ? Deux pistes me paraissent importantes à explorer liées au caractère à la fois hyper-oral et hyper-écrit des sociétés contemporaines :
- Le caractère total de l’écriture de l’onde sonore empêche son utilisation par une seule personne. Pour « écrire » l’onde sonore, il faudrait tout écrire. C’est très différent de la notation musicale, qui est facile à manipuler parce qu’elle ne représente qu’une partie spécialisée du son. Mais personne ne peut « tout » écrire seul, il faut être plusieurs pour le faire.
- L’écriture de la totalité de l’onde sonore doit réunir plusieurs personnes provenant de différents champs de spécialisation, cela ne peut être confiné à des musiciens dont le rôle social est déjà fixé. Cela ouvre le champ de la collaboration multidisciplinaire.
- Le caractère illisible de cette écriture énigmatique la rend inapte à contrôler ce que vont faire les interprètes, ni ce que les auditeurs vont percevoir. Etant sonorité et visualité en simultané, elle est source d’une multiplicité de perceptions possibles et donc d’interprétations.
L’écriture totale de l’onde, et donc du son, du timbre, hésite fortement entre être presque orale dans son immédiateté et de ne l’être pas tout à fait car elle est complètement fixée. Elle hésite entre d’une part cette forme assez étrange d’oralité et d’autre part une forme glorifiant l’écriture visuelle réifiée dans des objets transportables qui peuvent se répéter autant de fois qu’on le désire. Le visuel qui déjà dominait la pratique de la musique à travers les partitions, gagne définitivement sa bataille avec la mise en mémoire électronique des traditions, interdisant ainsi leur répétition, assurant leur muséification définitive ; le visuel permet une approche scientifique de l’acoustique et de la psycho-acoustique, achevant ainsi le lent processus occidental vers une certaine rationalité ; et il sécularise le timbre dans une pléthore de stéréotypes. Mais le visuel en gagnant, perd aussi sa bataille au profit de la mise en avant du monde irrationnel du sonore dans l’exposition totale de toutes ses particules, dans l’explosion phénoménale de sa très grande complexité (François 1992).
Pour prendre au sérieux la notion que, comme le dit Adorno, la musique se matérialise en écriture dans l’objet du disque décrivant l’onde sonore, deux phénomènes simultanés doivent être pris en compte. Premièrement, les sonorités enregistrées sont à prendre ou à laisser, elles ne laissent aucun espace ni du côté de l’écriture, ni du côté du son qui permettrait une approche traditionnelle de l’interprétation (une herméneutique) ; la réalité sonore de cette écriture ne peut pas donner lieu à une spéculation sur ce qu’elle pourrait vouloir dire, elle ne peut pas être niée : ainsi en est l’objet. Mais, deuxièmement, cette écriture reste entachée de cette malédiction de la « différance » (temporelle et référentielle) et de la représentation mimétique : elle n’accède pas à l’exactitude vivante du modèle qu’elle enregistre, aussi haute que puisse être la fidélité, il y a toujours un reste qui ne peut être pris en compte. L’onde sonore enregistrée dans les mémoires électroniques reste toujours une simplification (très relative évidemment) de la réalité des timbres.
En 1988, j’ai tenté de définir le « timbre du déclenchement » : il s’agit des sons qui peuvent être extraits des mémoires électroniques dans le format d’une répétition immuable d’une onde sonore donnée (notamment dans le cas de l’échantillonnage) :
Le timbre du déclenchement implique qu’un exécutant pousse un bouton, et une machine produit pour lui, à sa place, la sonorité d’une manière automatique et immuablement figée. L’exécutant ne peut plus influencer la qualité du son après l’avoir déclenché. (François, 1987-88, p. 205-208).
En tentant de ne pas se laisser aller à des considérations morales ou de préférences esthétiques, on peut envisager plusieurs niveaux liés à la perception des timbres fixés dans des mémoires et qui peuvent se répéter de manière exacte :
- En premier lieu, il faut considérer les sons stockés dans des mémoires électroniques qui sont utilisés comme signaux de la vie quotidienne, très souvent dans des structures très répétitives : les camions qui reculent, les cloches d’église, les signaux dans les gare qui annoncent qu’une annonce va être délivrée, les sonneries de téléphone, etc. Ils jouent parfaitement leurs rôles de signaler aux oreilles quelque chose, mais leur répétition constante peut devenir assez rapidement désagréable, voire insupportable. Lorsqu’ils sont maintenus sur une longue période de temps, nous avons tendance à les effacer de notre attention. Les voix (GPS, gares, répondeurs de téléphone, etc.) préenregistrées peuvent être d’une sensualité très aguichante, il n’en reste pas moins que leur répétition exacte devient très vite artificielle, puis lassante, puis énervante, puis comique, puis insupportable.
- Les sons électroniques qui, dans une musique donnée, se répètent immuablement dans leurs enveloppes chaque fois qu’ils sont convoqués par la pression sur une touche, un bouton, une commande ou autres moyens de les déclencher (pianos électroniques, synthétiseurs, boîtes à rythme, échantillons dans des mémoires d’ordinateur, etc.). En général, on classifie ce type de situation sous le nom d’échantillonnage. Ces sons sont le plus souvent utilisés dans des configurations qui reproduisent le concept d’un instrument de musique basé sur une gamme de hauteurs ou d’objets sonores discrets.
- Des œuvres musicales ou des séquences sonores complexes fixées sur des supports électroniques (enregistrements de musique vivante). Il s’agit surtout de pouvoir faire référence de manière assez exacte à des évènements particuliers du passé : le caractère suranné de ces événement datés permet à la fois de retrouver l’atmosphère d’une époque, mais exige aussi que le temps présent se différencie (même de façon minime) au passé, phénomène qu’on avait déjà par rapport aux partitions, mais qui va dans ce cas s’appliquer aux timbres. La succession assez rapide de modes ou d’interprétations différentes est la condition d’existence de cette mise en mémoire de ces moments vécus au départ comme une expérience, et qui deviennent à l’enregistrement un objet qui peut être échangé, vendu, ou ignoré par le grand nombre.
- Des œuvres musicales composées spécifiquement pour n’exister que sur les supports électroniques (compositions électroacoustiques, art numérique), qui peuvent exister en conjonction avec d’autres domaines artistiques (vidéos, films, installations, danse, etc.), ou bien des enregistrements de musique vivante en vue de produire un objet artistique spécifique au support (l’art du studio d’enregistrement) (voir Ribac 2005).
L’appréhension de toutes ces situations par des auditeurs va énormément varier selon les contextes : il est difficile de déterminer les cas où la fixité des timbres crée la lassitude des oreilles, ou bien les cas où les oreilles sont manipulées ou déformées par l’environnement de ces sonorité au point d’être aliénées ou dépendantes. On y reviendra ci-dessous.
Le fait que le son soit déclenché par une action et qu’il se poursuivre ensuite sans intervention humaine n’est pas limité aux mémoires électroniques. Plusieurs situations graduées peuvent être envisagées. Dans le cas du carillon décrit ci-dessus, on peut distinguer quatre possibilités :
- Le battant de la cloche est actionné directement par une personne (comme dans le cas du percussionniste), c’est une solution trop coûteuse et acoustiquement difficile pour les oreilles de celle qui actionne le battant. Mais elle garantit un contrôle sur chaque impact pris séparément et va par là influencer le comportement de l’enveloppe de la cloche. Elle permet en outre d’envisager une diversification du battant dans ses dimensions et sa matière. La place d’impact sur la cloche peut aussi être variée.
- La cloche est actionnée par une corde, permettant à la personne qui la manipule de se placer au rez-de-chaussée, loin de la puissance acoustique de la cloche. Le contrôle sur le son est moins subtil, mais garantit encore que chaque coup de cloche n’est pas la répétition exacte du précédent.
- Le battant est actionné par un mécanisme qui se déclenche automatiquement sans l’aide d’une personne. Celui ou celle qui manipule la cloche en est réduit à régler correctement le mécanisme. Les coups du battant sont tous identiques, mais restent identifiés comme matière acoustique provenant d’une cloche réelle.
- La cloche et le battant n’existent plus, ils sont remplacés par un échantillonnage électronique amplifié et envoyé dans un haut-parleur. Chaque coup est absolument identique et l’oreille, par cette répétition, identifie facilement qu’on a affaire à une cloche virtuelle.
Dans cette graduation allant du réel au virtuel et du contrôle sur la production sonore au son complètement préfabriqué, on reproduit là l’histoire d’une domestication progressive du timbre en vue de le neutraliser. Entre en compte dans cette histoire la question de la séparation des rôles entre individus, celle des fonctions spécialisées assumées par chacun et celle des rapports entre la matière et ceux qui la font sonner. Dans le premier cas le praticien est le constructeur de la sonorité à partir d’une matière donnée (la cloche construite par une autre personne spécialisée). Dans le deuxième cas la technique de production doit être plus raffinée à cause de la distance entre l’objet et son déclenchement, afin de pallier la perte de contrôle par rapport à la production directe. Dans le troisième cas une standardisation du battant et de la place d’impact est nécessaire, le timbre est maîtrisé ; cette configuration permet à un musicien d’actionner un jeu de cloches à partir d’un clavier et de jouer des pièces de musique avec des objets qui jusqu’alors n’étaient utilisés qu’en vue d’une signalisation sonore d’évènements n’ayant rien à voir avec la musique. Dans le quatrième cas le constructeur de cloche et le sonneur disparaissent au profit de forces inconnues qui libèrent la production sonore d’une organisation particulière du travail et libèrent la sonorité de cloche d’une spécialisation dans le domaine de la signalisation religieuse autant que dans d’autres domaines (dont la musique). Ainsi se réalise le rêve moderne d’un contrôle total sur la matière, mais dans le même temps ce qui est atteint n’est que l’artefact du timbre dynamique, celui qui se développe dans la complexité du vivant.
Le timbre du déclenchement, ou plus exactement celui qui est totalement prédéterminé avant qu’il soit déclenché, peut se présenter dans n’importe quelle temporalité. Il peut concerner des échantillons très courts comme dans le cas des claviers électroniques ou synthétiseurs, ou bien des morceaux entiers comme dans le cas des enregistrements d’œuvres musicales stockées sur des disques. Ce n’est pas la nature de la sonorité qui détermine le timbre du déclenchement (sons naturels, sons instrumentaux ou électroniques), mais le fait que l’onde sonore complexe décrite dans une mémoire est lue toujours de la même manière. On peut changer les contextes dans lesquels apparaissent les timbres figés du déclenchement, ou bien les conditions acoustiques de leur diffusion, mais nullement l’ordre immuable de leur mémoire, sauf si on a les moyens de les recomposer, de les réélaborer, dans le cours même de leur déroulement.
Le timbre du déclenchement opère sur les auditeurs de manière ambivalente : la répétition exacte d’un univers sonore permet de revisiter un passé plus ou moins lointain, d’en goûter encore l’atmosphère particulière et les technologies qui lui sont attachées (le retour au vinyle s’explique ainsi, tout au moins en partie). Tout changement de timbre viendrait détruire ces retrouvailles. Le timbre du déclenchement réifie le son et encourage fortement une perception portant sur les objets sonores globaux plutôt que sur leur déroulement différencié dans le temps. Cette réification crée les conditions de la fétichisation des sons, qui deviennent des clichés, des stéréotypes qui, s’ils se répètent immédiatement ou s’ils ne sont pas noyés dans une complexité, deviennent difficiles à supporter par ceux qui les écoutent au quotidien ou plus probablement sont effacés de leur conscience.
Un autre aspect de la fixation exacte des sonorités concerne de manière ambivalente la question de l’identité collective. Les sonorités dans leur reproduction deviennent des sortes de drapeaux capables de rallier ceux qui s’en réclament par rapport à une identité particulière. Toute modification de timbre en annulerait l’effet d’authenticité et, comme dans le cas des accents étrangers dans la bouche des interlocuteurs, en dénoterait immédiatement la fausseté, le défaut d’origine. La multiplicité des sonorités et leur accès fortement facilité par les médias, contribuent d’une part à morceler les identités dans des groupuscules, et d’autre part à encourager la manufacture quotidienne de nouvelles identités qui ne durent que ce qu’il faut pour marquer un territoire particulier. L’exactitude du son permet la reconnaissance d’appartenance, et aussi l’intolérance vis-à-vis de toutes les autres formes de manifestation sonore. Ou bien, dans cette même idée, elle permet l’expression de la tolérance méprisante vis-à-vis des sonorités des autres (« c’est de la musique commerciale », ou bien « c’est de la musique d’intellos »…). La relative simplicité ou complexité des sons ne joue aucun rôle dans cette affaire identitaire. Mais les manifestations des différentes variétés d’intégrismes identitaires produisent aussi, à l’intérieur même des mêmes identités, des pratiques qui viennent modifier dans un sens dynamique la fixité des timbres, soit dans des démarches de récupérations des sons pour en modifier les conditions d’utilisation, soit pour conceptualiser des structures sonores alternatives. Les frontières entre les sons figés et les sons dynamiques sont minces, mais elles sont évidemment essentielles. Chaque identité produit son « underground » alternatif qui la modifie ou la remet en question.
La notion de timbre dynamique n’est pas liée à un refus de la répétition, ni dans son caractère de succession immédiate des sons, ni dans son rapport à une tradition qui se réinvente continuellement. Le timbre dynamique accède à la mémoire, qu’elle soit électronique ou dans le cerveau des humains, pour la modifier dans des actions en temps réel qui vont influencer le déroulement interne des sonorités. Il n’y a pas la nécessité d’un répertoire de timbre très étendu, mais il convient plutôt de se soucier de la non répétition absolument littérale, ouvrant la voie à des variations infinies de timbre. Le timbre dynamique prend au sérieux l’effacement des mémoires pour les réinventer à travers des processus qui confrontent le producteur au matériau. C’est là que se manifeste la complexité du timbre, non dans l’élaboration constante de nouveaux sons.
Deuxième partie : Poly-tiques des pratiques du timbre
2.1 Adorno versus Benjamin
La question du timbre figé dans une mémoire immuable nous fait revenir à la pensée d’Adorno. En 1938, il souligne la relation entre la fétichisation des sons par des moyens de reproduction technologique et la régression de l’écoute qui, selon lui, en est le résultat direct. Le son enregistré pour un usage commercial devient un pur signal et l’auditeur n’a plus rien d’autre à faire que d’en identifier l’origine : « Le simple fait de connaître ce succès [commercial à la mode] se substitue à la valeur qu’on lui attribue : l’aimer signifie tout bonnement le reconnaître. » (Adorno 1988, p. 139) Cela implique une écoute peu attentive au contenu proprement musical. Surtout, cette écoute est tournée exclusivement vers l’attrait sensuel de l’objet sonore local et non plus sur une dialectique structurelle de l’œuvre entière mettant en relation le détail à la forme globale :
Le plaisir du moment et la diversité superficielle deviennent des prétextes pour priver l’auditeur de penser la totalité, exigence présente chez l’auditeur authentique, et cet auditeur suit la pente de la moindre résistance pour se transformer en client docile. Les moments partiels cessent de fonctionner de manière critique contre la totalité en question ; ils suspendent au contraire la critique qu’exerce la totalité esthétique réussie à l’encontre des failles de la société. L’unité synthétique leur est sacrifiée, mais ils n’en produisent pas d’autre à la place de l’unité réifiée ; ils s’y soumettent au contraire avec complaisance. Les éléments d’attrait sensuel isolés se révèlent inconciliables avec la constitution immanente de l’œuvre d’art et en est victime ce en quoi l’œuvre d’art transcende toujours nécessairement en connaissance. (p. 141)
Pour Adorno, l’imposition des sons par l’industrie culturelle sur les populations est au détriment d’une liberté de choix s’exerçant dans le cadre d’une responsabilité individuelle éclairée. L’écoute en devient atomisée sur la reconnaissance instantanée de courtes séquences de sons qu’il n’est pas nécessaire de relier à d’autres entités et qui peuvent être aussitôt oubliées. L’auditeur peut se laisser aller à une écoute distraite, dans les deux sens du terme de distraction : d’une part ne prêter qu’une oreille peu attentive aux sons proposés, permettant de faire d’autres activités en même temps et, d’autre part, se divertir, ne pas prendre très au sérieux ce qui est proposé à l’écoute. Surtout, la particularité de ce type d’écoute paresseuse est qu’elle tend à refuser tout ce qui peut se présenter comme différent ou ce qui viendrait contester l’univers sonore standardisé. Adorno ne semble pas prendre assez en compte un phénomène qui est antérieur à l’apparition des techniques de reproduction sonore et qui est lié à l’imprimerie des partitions : la diversification de plus en plus grande des œuvres présentées aux auditeurs, dans une très grande divergence de styles, qu’il s’agisse de différences d’origine historique, géographique, ou bien le produit d’antagonismes entre musiciens vivant à proximité les uns des autres. Quelques notes seulement de Mozart dans une forme enregistrée, suffisent alors à identifier l’objet-Mozart en tant que timbre, comme différent de tous les autres. Pour faire face à cette diversification, l’auditeur n’a peut-être pas d’autre choix que de se tourner vers ce type d’identification de timbre localisé, ce qui n’empêche pas d’avoir une oreille beaucoup plus attentive aux musiques très spécifiques que l’amateur choisit avec passion. En face de la foison de sons, l’auditeur doit hiérarchiser ses écoutes entre distraction et attention soutenue.
Comme l’a bien montré Richard Leppert dans son introduction à la publication de cet article dans le recueil d’essais qu’il a sélectionnés (Adorno 2002), il faut replacer les propos d’Adorno dans le contexte d’un débat épistolaire avec Walter Benjamin. L’article d’Adorno sur la fétichisation des sons répond directement à celui de Benjamin sur la reproduction des œuvres d’art, publié quelques années auparavant (Benjamin 2000, p. 269-316). Benjamin, en effet, concernant le même type de situation de reproduction technologique, mais du côté des arts visuels, notamment de celui du cinéma, avait tenu des propos beaucoup plus optimistes sur une ouverture vers des pratiques culturelles permettant une existence démocratique de l’art à travers une attention beaucoup plus libre aux œuvres. La possibilité d’emporter chez soi les reproductions des œuvres d’art ouvrait des perspectives complètement différentes de celles confinées à la seule contemplation devant l’œuvre authentique et appelait à une nécessaire sécularisation de l’art, à sa désacralisation. Deux pôles influencent plus ou moins la manière de contempler l’art : « l’un de ses accents porte sur la valeur cultuelle de l’œuvre, l’autre sur la valeur d’exposition » (p. 282). Du côté de la valeur cultuelle, l’œuvre ne concerne que des initiés, elle tend à rester secrète, hors de portée de l’œil du commun des mortels. Du côté de la valeur d’exposition, le musée émancipe l’art de cette dépendance aux rituels, il permet aux œuvres en les exposant de s’adresser à tous, mais la contemplation reste du domaine du recueillement respectueux. La reproduction technique, notamment le cinéma, ouvre la voie à la distraction du regard. Le mouvement, le choc des images empêche la fixation du regard et la contemplation. L’œil saisit les images dans leur globalité immédiate, et elles échappent à la réflexion par leur disparition soudaine et leurs métamorphoses continuelles.
L’idée de distraction, en opposition au recueillement, est au centre de la réflexion de Benjamin sur la reproduction des œuvres d’art. Le sens du terme distraction doit être envisagé de manière complexe et ne peut être simplement réduit au sens de divertissement. Répondant à Georges Duhamel qui dénonce le cinéma comme un divertissement ne demandant aucun effort, Benjamin s’insurge sur ce cliché qui lie irrémédiablement d’une part les masses, forcément ignorantes, à la paresse et d’autre part les connaisseurs d’art au recueillement. Il envisage de nouveaux rapports entre distraction et recueillement à la lumière des changements qu’apportent les technologies de la reproduction :
L’opposition entre distraction et recueillement peut encore se traduire de la façon suivante : celui qui se recueille devant une œuvre d’art s’y abîme ; il y pénètre comme ce peintre chinois dont la légende raconte que, contemplant son tableau achevé, il y disparut. Au contraire, la masse distraite recueille l’œuvre d’art en elle. (p. 311)
Il fait alors référence à l’architecture qui, de tout temps, « a été le prototype d’une œuvre d’art perçue de façon à la fois distraite et collective ». L’architecture, en effet, est un exemple très parlant. La totalité de la population n’a pas d’autre choix que d’exister au milieu des édifices qui l’entourent, la contemplation oscille continuellement entre un regard distrait, notamment quand les usages sont liés à d’autres préoccupations, et un regard d’une grande concentration, lorsqu’il y a du temps pour le faire (le tourisme, la flânerie sans but, par exemple…) ou lorsque des circonstances viennent perturber la vie quotidienne (l’ascenseur est cassé, il y a une grève de métro…). La vie au milieu des structures architecturales tient du paysage environnemental, qui se pratique au quotidien – à la fois dans le sens donné par Michel de Certeau d’invention du quotidien et dans le sens d’un exercice répété qui tacitement construit des savoirs. L’architecture mêle en son sein le beau et le laid, les richesses et les pauvretés, les bâtiments anciens dans toutes les couches historiques, dans tous les styles, et les nouvelles constructions futuristes, imitatives de l’ancien ou simplement fonctionnelles. L’architecture, parce qu’elle ne peut pas faire autrement que d’organiser l’espace public pour tous, suscite des conflits violents, mais qui se résorbent souvent en peu de temps par les capacités d’accoutumance des humains à leur environnement, au point que ce qui choquait profondément au début, peut devenir par la suite un objet auquel on tient particulièrement : la masse « recueille l’œuvre d’art en elle ».
Cette focalisation sur le quotidien et sur le regard distrait rejoint aussi les préoccupations du sociologue anglais Richard Hoggart (1957) s’agissant de la réception par les classes populaires des messages véhiculés d’en haut par les médias de communication. Selon Jean-Claude Passeron, Hoggart décrit une attitude ambivalente de la part des usagers des médias, à la fois « accueillante au sensationnalisme » de la société de consommation et sceptique par rapport aux diverses propagandes :
(…) c’est en réalité une attitude qui consiste à « savoir en prendre et en laisser », une forme de réception qui trouve dans un acquiescement peu engagé à l’écoute le moyen de « ne pas s’en laisser conter » par le message, attitude de défense, peut-être plus efficace que la polémique intellectuelle ou l’indignation morale ; attitude paradoxale en tout cas dont j’ai essayé de rendre la subtilité par l’expression d’« attention oblique » ou « distraite ». (Passeron 1993, §19)
Pour Hoggart, si les classes populaires ouvrières (des années 1930-60) peuvent si bien résister aux méfaits de la publicité, des publications commerciales et aux injonctions de la société de consommation, c’est parce qu’elles fonctionnent culturellement surtout de manière orale, avec un accent particulier sur la vie de famille et le lieu d’habitation. Cette tradition joue encore à l’époque de l’écriture du livre Uses of Literacy (Hoggart 1957) un rôle majeur de résistance pour contrebalancer ce que Hoggart perçoit comme danger majeur de manipulation des masses : « une forme néfaste de matérialisme » (p. 292), « le divertissement mis en boîte », et les « mises à disposition empaquetées » (p. 295). Essayer de comprendre ce qu’il en est de cette situation aujourd’hui n’est pas une mince affaire, tant les cultures se sont morcelées. De nouveau les notions développées par Michel de Certeau (1980) de stratégie, comme imposition d’un ordre provenant d’en haut ou de l’extérieur, et de tactique, comme utilisation de cette imposition instituée à des fins personnelles pour en détourner le sens et résister à la manipulation généralisée, semblent être des outils très utiles pour rendre compte d’un phénomène qui est la marque de notre temps dans toutes les couches de la population.
Dans une analyse du texte de Walter Benjamin, Michael Wood, professeur d’anglais et de littérature comparée à Princeton, affirme que l’idée de distraction ne peut se confiner seulement au manque d’attention. La distraction sème le trouble, lorsque suivant T. S. Eliot on peut être « distrait de la distraction par distraction » (voir le poème « Burnt Norton »). Elle est traversée par des énergies, tentations, parenthèses, digressions, elle touche à ce qui est complètement hors sujet. Comme dans les questionnaires à choix multiple où les réponses fausses paraissent séduisantes dans leur plausibilité, la distraction mène sur des chemins de traverses. Wood interprète l’argumentation de Benjamin comme se situant dans une logique pleine de malice : la distraction n’est pas antinomique au recueillement, à la concentration, mais ne l’est pas assez pour devenir respectable. Le recueillement a des vertus, « mais il a aussi le don étrange de manquer tout ce que la distraction peut trouver » (Wood 2009, ma traduction). La distraction est un vrai lieu d’apprentissage : la réception à travers la distraction, selon Benjamin, « a trouvé dans le cinéma l’instrument qui se prête le mieux à son exercice »(Benjamin 2000, p. 313). Michael Wood conclut la deuxième partie de son article :
L’essentiel n’est pas que nous ayons besoin de nous arrêter de nous concentrer – sur les films ou sur tout autre chose – mais que nous puissions essayer d’entrer en accord (to tune into- de s’accorder) avec notre distraction, d’écouter la séduisante plausibilité de ses messages surtout plutôt désordonnés, sans que la distraction ne devienne pour autant respectable. (Wood 2009, ma traduction)
Ouvrant la voie à des logiques de perception liées à la vie quotidienne et à l’environnement, la distraction chez Benjamin n’a rien à voir avec la régression de l’écoute d’Adorno. Elle annonce plutôt des pratiques assez jouissives, qui ont eu lieu par la suite, liées aux environnements qui nous entourent. En musique, l’utilisation des objets de la vie quotidienne par John Cage pour produire des sons, sa philosophie d’inclusion sans hiérarchie de tous les sons possibles, leur juxtaposition dans des formes arbitraires permettant de se concentrer sur leur matière interne et non sur les relations à d’autres sons, ou bien permettant de se distraire, ou encore permettant d’écouter distraitement sans penser qu’il convient de se pâmer. On pense aussi aux démarches de Murray Schaeffer (et bien d’autres après lui) par rapport à l’environnement sonore. À celles de Pauline Oliveros du Deep Listening (Oliveros 2006, p. 481-2), l’écoute profonde, méditative, menant à des états qui dépassent largement l’idée du recueillement, au point où souvent le sonore semble être un prétexte à d’autres états mentaux (une distraction de l’esprit ?). On pense aussi à toutes ces pratiques qui récupèrent ce que déversent les médias pour en faire autre chose en se les appropriant, dont celle de DJs est un des modèles particulièrement parlant. Ou bien à ces pratiques nomades qui sans cesse retravaillent les mêmes matériaux dans des variations infinies.
Mais les sonorités qui existent dans notre entourage ne sont-elles pas différentes des sollicitations visuelles ? N’y a-t-il pas dans le sonore une manipulation insidieuse qu’il est difficile soit d’ignorer, soit de subir sans révolte ? Adorno reconnaît que la fixation des sons dans l’écriture définitive de l’enregistrement phonographique, qui met l’accent sur le local au détriment des formes complexes, peut susciter un type d’écoute pleine d’attention : « C’est dans l’appréciation des voix par le public, que le fétichisme musical exerce son emprise avec le plus de passion » (Adorno 1988, p. 144). La sensualité vocale est la source d’une fascination, et par là selon lui un envoûtement, un aveuglement de l’oreille. Il met là le doigt sur l’idée que l’explosion du timbre, par des moyens d’amplification qui mettent sur le devant de la scène les particules sonores, la sensualité des sonorités, au détriment de ce qui peut se raconter par ailleurs, a été inaugurée quasi exclusivement par les musiques commerciales. Adorno écrit (on ne sait jamais si c’est pour s’en lamenter) : « Aujourd’hui, on célèbre l’instrument en tant que tel, en dehors de toute fonction ». Ceci sans qu’il y ait besoin d’aptitudes ou de techniques particulières. Mais par le même phénomène de culte fétichisé du son, les sonorités parfaites (« barbarie de la perfectio ») de l’orchestre dirigé par Toscanini jouant des concerts vivants comme s’il s’agissait d’un disque, viennent aussi faire régresser l’oreille se fermant à la sauvagerie des interprétations qui se risquent à l’imperfection expérimentale et aux musiques incompréhensibles.
Alors, dans cette forêt d’injonctions contradictoires, où se situent les pauvres oreilles de nos contemporains ? Distraites ou recueillies ? Pour Makis Solomos, la centration sur le son (et non sur l’articulation des sons dans un langage) est directement liée à l’écoute intense, à condition qu’il y ait un apprentissage pour redécouvrir son état de « nature », ce que l’articulation (culturelle ?) avait effacé (Solomos 2013, p. 495). Ce programme esthétique séduisant correspond-t-il à la réalité des tactiques de perception des auditeurs ? Il ne peut certainement pas être séparé de mises en conditions dans des pratiques régulières (ateliers par exemple), dans une liaison forte entre fabrication des sons par les participants eux-mêmes et de leur perception par les mêmes. Pour Peter Szendy, « l’écoute plastique » implique une praxis dans laquelle d’autres moyens, d’autres médiations que celle de la simple écoute contemplative, viennent mettre en action « tactile » l’auditeur qui devient ainsi un auteur : mots, annotations, lecture de partitions, manipulations d’enregistrements, etc. C’est un développement historique que ni Adorno, ni Benjamin ne pouvaient réellement prévoir : la capacité aujourd’hui qu’ont tous les auditeurs de manipuler les sons enregistrés de manière créative, en utilisant des techniques de leur choix. Voilà qui change la donne de l’écoute des sons qui flottent dans notre environnement saturé, dans un sens de diversification des modes de perception. Ainsi il est devenu absolument impossible d’envisager la perception cognitive dans des logiques linéaires fléchées partant du compositeur compétent et menant à l’auditeur éclairé, en passant par toute une série de médiations bien organisées. L’écoute se déploie aujourd’hui dans une dynamique des contextes dans lesquels toutes les médiations peuvent jouer simultanément des rôles contradictoires et dans lesquels la catastrophe côtoie allègrement le sublime.
2.2 La question de l’ineffable
Ce qui ne peut être représenté par la notation est laissé à la subjectivité de l’interprète, à travers un certain nombre de médiations, qui sont considérées comme faisant partie de la nature de la pratique musicale. Ces médiations semblent aller de soi et en conséquence, elles restent non explicitées et ne faisant pas partie de la réflexion menant à l’interprétation : contrôle des gestes corporels et des postures, par une lente et longue éducation, automatismes des rapports entre les signes et les actions nécessaires pour produire les sons correspondants, reproduction de l’interprétation du maître, éclairages éventuels de la musicologie, mythologie des chefs-d’œuvre, etc.
Pour Latour, cette manière chez les Modernes de laisser à la subjectivité des usagers « tout ce qui reste », par-delà l’objectivité des représentations produites par la science, est la source de la forte dichotomie entre théorie et pratique :
Pour désigner le mont Aiguille réel, invisible, pensable, objectif, substantiel et formel, saisi par la cartographie dont on a gommé la pratique, on a pris l’habitude au XVIIe siècle de parler de ses QUALITES PREMIERES – celles qui ressemblent le plus à la carte. Pour désigner le reste (presque tout, souvenons-nous-en) on parlera de QUALITES SECONDES : celles-ci sont subjectives, vécues, visibles, sensibles, bref secondaires puisqu’elles ont le grave défaut d’être impensables, irréelles et ne pas faire partie de la substance, du fond, c’est-à-dire de la forme même des choses. (Latour 2012, p. 123)
Ainsi, pour revenir à la musique, lorsqu’elle se pratique dans la réalité de la présence sonore, on préfère dire qu’elle procède de l’ineffable et qu’elle ne peut être expliquée. L’interprète est obligé de respecter les notes de la partition, mais ne doit pas le faire de manière solfégique. Pour rendre la musique vivante, pour que la magie opère, l’interprète doit aller au-delà des notes, en les oubliant. Il y a bien d’un côté le formel de la partition et de l’autre le monde inexpliqué du rêve, c’est-à-dire en fait la réalité de l’expérience pratique. Latour parle de bifurcation : le mont Aiguille est dédoublé entre la réalité formelle de la représentation sur la carte et un « ensemble de traits » laissés à l’impensé de ce que les randonneurs peuvent réaliser. C’est le fondement moderne pour Latour : « Cette bifurcation multipliée va rendre infiniment difficile la réconciliation de la philosophie moderne avec le sens commun ; c’est sa genèse qui va nous permettre d’expliquer pour une grande part l’opposition entre théorie et pratique si caractéristique des Modernes ». (p. 124)
Il y a une petite complication concernant la pratique musicale de ceux qui respectent l’ordre formel de la notation sur partition : la subjectivité, l’ineffable, l’inouï, s’inscrivent très vite dans le dur des croyances fixées dans les oreilles. Tout un mimétisme, toute une tradition changeante mais transmise de génération à génération, interdit dans les institutions d’enseignement de s’écarter de chemins balisés par les oreilles, mais sans qu’ils aient besoin d’être explicités. Mozart, selon les canons de ceux qui jugent les musiciens, doit se jouer comme cela et pas autrement. Personne pourtant n’explique pourquoi il faut qu’il en soit ainsi, et pourquoi des interprétations moins respectueuses de cet ordre non-écrit n’auraient pas droit de cité.
2.3 Chaînes de référence, matière et matériau
La sonorité globale, ce que j’ai nommé timbre, dans l’action de sa production réelle et non représentée sur la partition, reste dans sa complexité, d’essence dynamique. Cette dynamique concerne le déroulement temporel local des sons dans leurs aspects les plus micro-soniques et elle affecte plusieurs paramètres à la fois de manière indépendante. La sonorité globale défie fortement les velléités de la maîtriser par des principes canoniques ou des méthodes spécifiques. On ne peut cerner le matériau sonore que par une série infinie de mesures ou d’expérimentations, chacune d’entre elles s’attaquant à un aspect limité du son : l’attaque, le spectre, l’enveloppe temporelle, le bruit, les micro-évènements qui modulent le son, la nature acoustique de l’objet ou instrument qui produit le son, le rapport entre les aspects acoustiques des sons et la perception de ces mêmes sons par l’oreille humaine, le rapport du son et de l’environnement acoustique dans lequel il est produit, la manière par laquelle l’onde sonore se déplace dans l’espace, etc. Chacune de ces mesures ou expérimentations implique pour être comprise des représentations spécifiques et différentes, c’est-à-dire spécialisées de manière scientifique. Ces mesures et expérimentations, ce que Latour appelle les médiations, forment une chaîne de référence qui s’enrichit constamment, mais qui ne peut rendre compte de la sonorité globale dans le temps réel de sa production. Une autre chaîne importante de référence concernant la sonorité est constituée par le développement de techniques concernant la construction des objets ou instruments appelés à produire des sons et l’utilisation efficace de ces objets ou instruments. Et le développement artisanal de ces techniques est lui-même soutenu par des recherches scientifiques concernant les matériaux utilisés dans la lutherie, le comportement des corps des humains dans la manipulation la plus efficace des outils, les conditions psychologiques de l’acte physique, la médecine qui peut aider à cette manipulation, les conditions sociales de la production des sons, l’histoire politique qui les détermine, etc. La théorie de la musique dans ses dimensions des études sur l’harmonie, sur l’instrumentation et sur l’orchestration, contribue aussi à la détermination du timbre. Tout cet appareillage est merveilleux, mais ne saisit toujours pas le son dans sa complexité dynamique globale, il peut au contraire aveugler ceux qui pensent l’avoir saisi. De plus, la multiplicité des disciplines hyper spécialisées rend l’accès à la compréhension d’un phénomène général très difficile à établir.
Selon Bruno Latour, pour accéder à l’appréhension du matériau, il faut bien passer par la minutie de toute une série de médiations qui se sont développées au cours d’une histoire longue et difficile. Le réseau constitué concernant la randonnée dans le Vercors, tous les objets qui la compose pour qu’il puisse exister, des sentiers aux chaussures de marche, l’histoire de la philosophie de la promenade, peuvent mener à l’émotion du randonneur. Mais cela ne produit toujours pas la connaissance du matériau : « Pas de médiation, pas d’accès. Mais ce parcours ne serait pas clarifié non plus – la symétrie est importante – en introduisant la notion de « chose connue » » (Latour 2012, p. 88). La pratique du déchiffrement des notations implique de nombreux allers et retours entre ce qui est représenté et la représentation :
Il est bien vrai qu’au début nous avons devant les yeux, dès que je déplie la carte et la rapporte au paysage – jamais « directement » bien sûr mais par le truchement des balises et de tout le tintouin – une forme de transsubstantiation : les signes inscrits sur le papier imperméable se chargent progressivement – au fur et à mesure que je parcours suffisamment d’allers et de retours – de certaines propriétés du mont Aiguille et permettent de m’en rapprocher. Pas de toutes (…) : pas de son poids, pas de son odeur, pas de sa couleur, pas de sa composition géologique, pas de sa dimension à échelle un ; et heureusement, car sans cela je serais écrasé sous son poids (…). (p. 88-89)
Le problème des Modernes selon Latour est que, quand tout fonctionne à merveille dans la relation du matériau à sa représentation, les médiations tendent à s’effacer, l’expérience devient ordinaire, invisible à l’œil du savant, le sens commun est dévalorisé comme « simpliste », et le signe sur le papier, l’équation devient synonyme de la réalité elle-même. Ce qui compte vraiment n’est plus la réalité des choses dans leur complexité mais c’est la manière dont elles sont représentées, c’est cela qui constitue la matière même de la réalité. Lorsque la carte est dépliée, le bon randonneur, faisant un heureux parcours autour du mont Aiguille, oublie les médiations qui ont permis à la carte d’exister et le « chemin d’existence » autonome du mont Aiguille, pour ne se concentrer que sur les aspects formels de correspondance entre la représentation et le représenté :
la carte ressemble au territoire parce que le territoire est au fond déjà une carte ! (p. 121)
Pour Latour, le « matérialisme » des Modernes tient dans l’accumulation (un réseau, une chaîne continue de transformation) du dévoilement de la matière telle qu’elle est par une série ponctuelle et distincte d’expérimentations qui assure une continuité, et qui donne l’impression d’avoir saisi la matière même. Chaque élément du réseau correspond à un angle de vue, à une discipline, à une situation créée dans un laboratoire. L’ensemble des éléments donne l’impression que la réalité du matériau est saisie dans une continuité. Pourtant, chaque gain de connaissance
provient justement de ce que la carte ne ressemble aucunement au territoire, tout en maintenant par une chaîne continue de transformations – continuité constamment interrompue par la différence des matériaux emboîtés – un tout petit nombre de constantes. C’est par la perte de ressemblance que se gagne la formidable efficacité des chaînes de référence. (p. 88)
Il fait en conséquence la distinction entre la matière, fiction d’une connaissance prétendument matérialiste des Modernes, et le matériau qui garde son autonomie d’existence, sa propre vérité.
Malgré les chaînes de référence et les représentations ponctuelles qu’elles produisent, le matériau continue son existence autonome. Latour propose de remplacer la notion de construction par celle d’instauration. Dans les domaines scientifiques l’idée de construction est liée de manière négative à ce qui ne peut pas être la vérité vraie. Si un fait est construit par le cerveau d’un être humain, il est le résultat de l’imagination et non un fait scientifique indéniable : « si c’est construit, c’est donc probablement faux » (p. 160). Dans cet énoncé, les médiations sont discréditées et les artefacts nécessaires à la production en laboratoire des faits indéniables sont niés.
Pour réhabiliter la construction dans le concept moins violent d’instauration, trois éléments qui entrent dans toute construction ont besoin d’être explicités – Latour donne les exemples de la construction d’un « fait scientifique, une maison, une pièce de théâtre, une idole, un groupe » (p. 163) :
- Dans l’action de construction l’identification de l’auteur se perd, car on est en présence d’un « faire faire ». Quelqu’un (une architecte par exemple) fait faire à d’autres des actions. Qui construit ?
- L’action n’est pas seulement le fait qu’un individu construit en imposant son pouvoir sur un matériau, le matériau lui-même exerce son influence sur l’individu. Le vecteur de l’action est réflexif, il va dans les deux sens. Latour donne l’exemple du marionnettiste qui à la fois manipule les marionnettes et est manipulé par elles.
- La construction implique un jugement de valeur : est-ce bien construit ?
On aurait là, dans la considération de ces trois éléments de la construction, un programme de recherche tout trouvé pour tenter d’expliciter les pratiques musicales et artistiques dans leurs différences, notamment dans leurs diverses manières de produire le timbre : que se passe-t-il dans les processus du « faire faire », quel est le rôle de ceux et celles qui font par rapport à ceux et celles qui font faire ? Comment cela se fait-il ? Quels sont les processus de la manipulation des matériaux par des artistes et des artistes par des matériaux ? Quelles valeurs s’expriment dans l’action de ces processus ?
Le deuxième point de la démonstration de Latour sur la construction peut être élargi aux préoccupations sur la question principale de cet article : le timbre. Dans la production des sons le producteur se confronte au matériau de manière réflexive. Il oriente ses actions pour tirer des sonorités contrôlées, mais le matériau dicte en retour aussi ses conditions. L’instrument résiste par son inertie. Les échecs répétés dictent les comportements futurs, dans le tâtonnement des essais. Les succès répétés dictent des voies à poursuivre là aussi par le tâtonnement. Un répertoire lentement s’installe, le corps apprend les gestes appropriés aux sonorités, le matériau est éventuellement modifié par de nouvelles façons de le construire. Eventuellement les luthiers sont convoqués, des appendices à l’instrument sont inventés (sourdines, microphones) ou bricolés, etc.
Dans ses analyses sur les pratiques des amateurs, Antoine Hennion développe l’idée qu’il n’y a pas d’autres finalités chez les participants à une activité donnée que de déployer l’activité souhaitée. Dans ces conditions la réflexivité s’exprime dans l’action elle-même, dans l’inscription de parcours contextualisés et non prédéterminés. Prenant l’exemple de l’escalade, il observe que le but de ceux qui font cette activité n’est pas du tout d’aller au sommet, mais est constitué par l’escalade elle-même. Il s’agit surtout de se confronter au rocher, de se mettre à escalader selon des modalités qui se déterminent au fur et à mesure de l’action :
Suit-on un plan ? Rien ne se passe comme on voudrait, le mouvement se définit avec le geste qui le réalise. On pourrait dire que l’objet de l’escalade est la réussite même de la voie. Mais même cela… les efforts qu’on fait échouent, et tout le plaisir est là. Une voie faite est une voie oubliée, au profit de la suivante, plus dure, différente, qu’un autre grimpeur vient d’essayer en vain. Drôle d’action, en effet, dont l’échec intéresse plus que le succès. (Hennion 2009, p. 1-2)
Dans ce contexte, nous dit Hennion, « le moyen devient l’objet, l’objet le moyen ». Peu importe alors ce qu’on pense habituellement comme essentiel à l’action : le sujet, le but, le plan. Ce qui compte est l’interaction du corps avec le rocher, dans une modalité globale qui déploie à chaque instant sa signification d’être de l’escalade, activité qui s’apparente alors autant au sport (la technique, la performance) qu’à l’art (l’élégance des figures).
En traduisant les propos d’Hennion sur l’escalade en termes de pratique musicale, on pourrait dire que, pour les musiciens praticiens, l’organisation méthodique de la temporalité dans des notations bien ciblées a beaucoup moins d’importance pour la signification de l’activité que celle des situations globales où l’instrumentiste se confronte à l’instrument (ou le/la vocaliste à sa propre voix, ou pour la technopersonne à la technologie) pour en tirer des sons qui font sens. Si, comme c’est bien souvent le cas, la musique est désignée d’emblée comme inatteignable dans sa perfection transcendantale, alors clairement le « sommet » (et non la pratique de la musique) est désigné comme le seul objet de l’activité. Si seule la réussite de ce but va compter, alors il n’y a plus de musique sur terre. Pour qu’il y ait « musique », il faut surtout musiquer.
L’instauration (plutôt que la construction) pour Latour implique la prise en compte des trois éléments décrits ci-dessus : le « faire faire » collectif, la réflexivité dans la manipulation du matériau, et « la recherche risquée, sans modèle préalable, d’une excellence qui résultera (provisoirement) de l’action » (Latour 2012, p. 166). Est-ce là une définition de l’improvisation dans le domaine musical ? Selon lui l’instauration implique la présence d’« êtres » (ici dans le sens de matériaux, d’entités vivantes ou non) qui puissent y répondre de manière à nous inquiéter par le fait qu’ils n’impliquent pas des résultats prédéterminés et qui, en conséquence, se présentent comme des énigmes :
(…) il faut des êtres qui échappent à ces deux types de ressources : l’« imagination créatrice » d’un côté ; la « matière brute » de l’autre. Des êtres dont la continuité, le prolongement, l’extension se paieraient, si l’on peut dire, en assez d’incertitudes, de discontinuités, d’inquiétudes pour qu’il reste toujours bien visible que leur instauration pourrait rater si l’on ne parvenait pas à les saisir selon leur clef d’interprétation selon l’énigme propre qu’ils posent à ceux sur lesquels ils viennent peser ; des êtres qui se dressent toujours inquiets, à la croisée d’un chemin. (p. 167)
Les matériaux, ni prédéterminés par la construction astucieuse, ni dénués d’une existence complexe, peuvent « répondre » aux praticiens (ont « du répondant »), peuvent interagir avec eux et par là participer à l’instauration d’évènements significatifs. Voilà une image « critique » qui émancipe à la fois le timbre dans sa complexité et les praticiens qui les produisent. Emancipation en particulier de la notation (ce matériau complexe) vis-à-vis de la production sonore et émancipation des instrumentistes/vocalistes vis-à-vis de l’utilisation exclusive de la notation sur partition pour produire de la musique reconnue comme véritable.
La figure de l’instrumentiste acteur de sa production sonore prend de la consistance. On peut envisager des pratiques musicales dignes d’intérêt qui se passent en dehors de l’interprétation d’écritures faites par des compositeurs sous forme de notation sur du papier. Les capacités à écrire de la musique ne sont plus le parcours obligé pour les compositeurs qui choisissent de produire leurs sonorités par des moyens électroacoustiques. La production du timbre devient une activité créatrice reconnue.
Mais en retour, la personne qui écrit les sons par le biais du système de notation n’en est pas moins une praticienne des sons. L’aller-et-retour constant entre l’acte d’écrire et celui d’entendre le résultat de l’écriture – comme celui du randonneur entre la carte et la réalité du terrain du mont – permet à la longue d’anticiper ce résultat et d’expérimenter de nouvelles combinaisons. D’une façon artisanale l’acte d’écriture reproduit indirectement la confrontation interactive avec le matériau, la plume (ou le clavier d’ordinateur) guidant la pensée autant que le penseur la plume, à travers un usage poursuivi sur de longues périodes. Le compositeur est autant théoricien que praticien, ces deux aspects étant indistinctement mêlés. Même les élucubrations les plus conceptuelles doivent déboucher sur des réalités sonores. Pourtant, ceux qui restent fidèles à l’écriture de partitions ont à faire face aux grandes difficultés à changer les conditions des médiations nécessaires à la transformation des signes en sonorités : le conservatisme des institutions, l’inertie des interprètes, les instruments que les industries culturelles veulent bien mettre sur le marché ; ils ont aussi à prendre en compte la limitation imposée par l’espace sur lequel les signes sur le papier peuvent s’inscrire, les dimensions limitées de la représentation sur une surface plane et la lisibilité de cette inscription en vue d’une traduction fidèle à son esprit.
2.4 L’écriture du timbre – L’idée de dispositif
Comme les technologies informatiques nous l’ont montré, le timbre synthétisé doit répondre à la définition d’une série assez impressionnante de paramètres qui doivent interagir de manière dynamique. L’écriture, qui s’exprime dans sa version finale dans une onde sonore complexe, devient totale (tout doit être défini par l’homme ou des algorithmes d’origine humaine), ce qui la distingue fortement de la notation musicale qui ne représente le son que très partiellement. La lecture de cette écriture électronique ne peut se faire qu’en passant par des étapes de notation partielles (spectrogrammes, graphismes mesurant les enveloppes, etc.), sinon elle ne peut faire aucun sens hors le langage-machine. L’écriture productrice des sons prend le pas sur la lecture. Le timbre, pour l’instrumentiste (ou vocaliste) constitue aussi une écriture totale d’une très grande lenteur qui s’exerce sur le corps même de l’être humain. Il s’agit d’une acculturation liée à une incorporation s’exerçant sur de longues périodes de temps qui se comptent en années. Cette acculturation / incorporation dépend à la fois d’un environnement particulier et de la répétition de gestes et d’attitudes corporelles résultant en sonorités par l’entremise d’objets matériels. Ce type de processus se manifeste avec une efficacité particulière dans les institutions d’enseignement spécialisé de la musique. Cette écriture sur le corps n’est lisible que dans la globalité constatée dans le résultat d’un musicien achevé produisant des sonorités selon ce qui est convenu. Les nombreuses médiations restent invisibles soit parce qu’elles sont trop complexes dans leurs nombres et leurs historiques, soit qu’elles risqueraient d’effacer la beauté du résultat par les vicissitudes de la sinuosité des parcours et le nombre très élevé d’échecs irrémédiables.
Les alternatives aux institutions, notamment les parcours autodidactes, s’instituent autrement mais restent par force instituées par des éléments épars d’acculturation et d’incorporation. Elles tendent à être moins efficaces dans la performance technique, mais par le fait qu’elles dépendent beaucoup plus de l’initiative personnelle des acteurs, ont la qualité de ne pas séparer les significations de la production des sons (voir Green 2002). Que la manipulation – notamment par les médias de masse – des acteurs de ses démarches soit à la source de leur apprentissage ne fait aucun doute, mais ceci n’est pas différent des institutions publiques qui au moins en annoncent explicitement la couleur.
Si l’acte de composer ne se limitait plus à l’élaboration d’une succession de sons mais se préoccupait maintenant de « composer » – ou construire – le corps même de l’interprète, son incorporation totale en vue d’une production sonore particulière, cela paraîtrait sans doute une imposition insupportable dans ses dimensions déshumanisantes (à la Frankenstein). S’il s’agissait d’un « compositeur » unique, ce ne serait pas acceptable. Mais le phénomène d’incorporation des musiciens interprètes dans un contexte collectif, s’agissant d’une société démocratique liée par une culture particulière, paraît tout à coup très « naturel ». Pour reprendre la notion de Latour d’instauration (à la place de celle de construction), il serait possible aujourd’hui d’envisager dans les processus d’incorporation, des logiques d’émergence de diversités par rapport à des contextes de confrontation réflexive des corps humains au matériau. Cette diversité de gestes et d’attitudes corporelles par rapport à l’instrument (ou à l’appareil vocal) servirait autant à comprendre les intentions de la musique notée sur partition, à maintenir vivante les traditions fortement constituées, que de donner aux participants le choix de leur parcours musical dans la détermination de leurs sonorités, c’est-à-dire le plus souvent dans leur choix d’une expression musicale déjà constituée.
Dans l’absence (heureusement) d’un accès direct sur le contrôle des processus d’incorporation à long terme, quels peuvent être les mécanismes pour ouvrir les musiciens praticiens à une diversité de manières de produire des sons, dans une temporalité relativement brève ? Comme l’a bien montré l’anthropologue et pianiste de jazz David Sudnow (2001) lorsqu’il décrit les processus d’apprentissage de ses mains pour produire des improvisations dans le domaine du jazz, les modèles sonores et visuels, s’ils sont essentiels à la définition d’objectifs à atteindre, ne suffisent pas à produire des résultats tangibles par simple imitation. Des dispositifs de « bricolage » sont nécessaires qui permettent aux participants d’arriver à leurs fins par des détours hétérogènes qui leur sont propres.
L’idée de dispositif peut se définir à partir de celle du Petit Robert comme un « ensemble de moyens disposés conformément à un plan ». On peut reprendre la définition qu’en a donnée Michel Foucault par rapport à son utilisation dans ses textes en opposition du terme de structure :
Ce que j’essaie de repérer sous ce nom [dispositif] c’est (…) premièrement un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements d’architectures, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propos philosophiques, moraux, philanthropiques, du dit aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on peut établir entre ces éléments. (Foucault 1977, p. 63)
Dans l’application de cette idée à la production des timbres dans le domaine des pratiques musicales, les éléments institutionnels de cette définition sont bien présents, mais l’accent est surtout mis ici sur la mise en réseau des éléments du dispositif à travers l’action quotidienne, contextualisée par des acteurs et des matériaux donnés. Les moyens sont ainsi définis ici comme étant constitués à la fois par les personnes en présence, par leur statut social et hiérarchique au sein d’une communauté artistique donnée, par les matériaux, instruments et techniques mis à disposition ou déjà développés, par les espaces dans lesquels se déroulent les actions, par les interactions particulières, formalisées ou non entre les participants, entre les participants et les matériaux ou techniques et par les interactions avec l’extérieur du groupe. Les dispositifs sont plus ou moins formalisés par des chartes de conduite, des protocoles d’action, des partitions ou images graphiques, des règles d’appartenance au groupe, des évaluations de capacités, des processus d’apprentissage et de recherche. Pour une grande part pourtant, les dispositifs sont régis au jour le jour de manière « orale », dans des contextes qui peuvent fortement changer selon les circonstances, et à travers des interactions qui par leur instabilité peuvent fortement produire des résultats très différents – plus ou moins probants selon l’évaluation des acteurs eux-mêmes ou de personnes extérieures (voir François et al 2007).
Concernant la question de la technique, Bruno Latour souligne la discontinuité et l’hétérogénéité des actions dans chacun des dispositifs qui la mettent en œuvre. Il parle de « trajectoires » techniques dont les sinuosités complexes sont difficiles à saisir :
Tout dans la pratique des artisans, des ingénieurs, des technologues, et même des bricoleurs du dimanche met en évidence la multiplicité des transformations, l’hétérogénéité des combinaisons, la prolifération des astuces, le montage délicat de savoir-faire fragiles. Si cette expérience reste difficile à enregistrer, c’est que pour lui demeurer fidèle, il faudrait accepter sa rareté, sa fulgurante invisibilité, sa profonde et constitutionnelle opacité. C’est qu’elle oscille toujours entre deux listes d’éléments contradictoires : rare et banale, imprévisible et prévisible, fugitive et constamment reprise, opaque et transparente, proliférante et maîtrisée. (Latour 2012, p. 219-220)
Les mécanismes de détermination des timbres restent opaques par les détours qu’il convient de faire pour y parvenir. Mais ils peuvent être problématisés dans des dispositifs de contraintes qui placent le musicien dans une posture expérimentale à l’intérieur même de termes contradictoires comme ceux proposés par Latour. Dans la série d’exemples qui va suivre, chaque fois une problématique est présentée suivie d’un champ de possibilités qui ouvre des perspectives d’expérimentation :
- les questions relatives aux stéréotypes ou clichés, s’inscrivant entre la répétition du même et de nouvelles manières de faire la même chose ;
- aux éléments fixés à l’avance par rapport à ceux qui ne le sont pas et qui peuvent émerger dans le cours d’une prestation, s’inscrivant entre ce qu’une tradition impose absolument et ce qu’elle permet de varier ;
- à la répétition de gestes pour produire à travers des variations insensibles des accidents, s’inscrivant dans un jeu entre le connu et l’inconnu ;
- à la production des mêmes types de sonorités transposés sur des instruments ou matériaux sonores différents, s’inscrivant entre différences et similarités ;
- à la traduction des signes imprécis notés sur la partition (les articulations et les accents par exemple) en sonorités particulières, s’inscrivant dans le jeu entre ce qui est présenté comme faisant partie de la tradition et ce que permet une traduction plus théorique des signes écrits ;
- à la tradition par rapport à sa traduction en actualité vivante, s’inscrivant dans la nécessité à faire face aux nouvelles technologies et aux nouvelles manières qu’elles imposent à la perception des sons, etc.
Dans l’élaboration de ces dispositifs, le résultat sonore reste du domaine de l’imprévu, il émerge d’un processus, il construit au fur et à mesure un système particulier de valeurs, mais en même temps il se manifeste dans un contexte bien défini de modèles et de situations pratiques qui inscrivent les sonorités dans le cadre d’une tradition ancrée dans des valeurs.
2.5 Exemple critique d’un dispositif remarquable
En partant d’un dispositif en tout point remarquable, une série de circonstances, un processus, il s’agit de tenter de saisir tous les aspects problématiques de la production du timbre dans les perspectives de l’écologie des pratiques. On aborde ainsi pour terminer – avec la partie qui suit sur le concept de praxis – les aspects politiques de la production sonore.
Qu’entend-on par « écologie des pratiques » ? Ce concept a été développé par Isabelle Stengers, philosophe des sciences, dans le Tome 1 de Cosmopolitiques. Stengers remarque la capacité du capitalisme à redéfinir constamment son pouvoir par le jeu de délocalisation et de relocalisation (ou pour reprendre les termes de Deleuze et Guattari de déterriorialisation et de reterritorialisation) : la capacité géniale du capitalisme « à parasiter sans tuer » (Stengers 1996, p. 22). Refusant les aspects moralistes que cette constatation peut engendrer, Stengers fait remarquer que toutes les grandes causes contemporaines n’échappent pas à l’accusation de compromission par rapport au capitalisme et à sa dynamique. Pour elle, l’idée de résistance se trouve à l’intérieur même des pratiques vivantes « même si aucune n’a échappé au parasitage généralisé qui les implique toutes » (p. 23). Les pratiques sont hantées aujourd’hui par l’instabilité, incarnée dans la figure inquiétante du sophiste, « vecteur de lucidité ou créateur d’illusion » (p. 52) et par la présence du pharmakon, à la fois remède bienfaisant et poison menant au désastre : « drogue dont l’effet peut muter en son contraire, selon le dosage, les circonstances, le contexte, toute drogue dont l’action n’offre aucune garantie, ne définit aucun point fixe à partir duquel on pourrait avec assurance, en reconnaître et comprendre les effets » (p. 52-53). Les pratiques peuvent à tout moment basculer dans des dérives mortifères contradictoires, elles doivent se maintenir tant bien que mal sur une crête entre deux précipices.
Pour Isabelle Stengers la signification du terme « écologie », emprunté par analogie à la science pour être utilisé dans le sens politique, concerne des groupes humains dans le cadre de pratiques :
Par analogie, on pourra donc dire que la population de nos pratiques relève en tant que telle, quels que soient « le mode d’existence immanent » de chacune et l’ingrédient que constitue pour chacune l’existence des autres, d’une mise en scène écologiste. (…) Pour un écologiste, toutes les situations « écologiques » ne se valent pas, en particulier lorsqu’elles font intervenir les membres de l’espèce humaine. La pratique (politique au sens large) des écologistes a donc trait à la production de valeurs, à la proposition de nouveaux modes d’évaluation, de nouvelles significations. Mais ces valeurs ne transcendent pas la situation constatée, elles n’en constituent pas la vérité enfin intelligible. Elles ont pour enjeu la production de nouvelles relations venant s’ajouter à une situation déjà produite par une multiplicité de relations. Et ces relations sont lisibles elles aussi en termes de valeur, d’évaluation, de signification. (p. 59)
L’écologie des pratiques se décline sur le mode de l’émergence continuelle de pratiques nouvelles à partir de celles déjà en existence et de la disparition d’autres pratiques. Leur apparition implique, comme dans le cas des inventions techniques, qu’il convient d’envisager les dangers que les pratiques font courir à celles qu’elles ont pouvoir de détruire, en vue de garantir ainsi leur coexistence. La multiplicité extraordinaire des pratiques qui émergent et disparaissent, par le contenu très varié des significations qu’elles expriment, a pour conséquence la remise en cause des processus de normalisation menant à des vérités universellement reconnues et imposées à tous. Stengers parle des notions de symbiose « où chaque protagoniste est intéressé au succès de l’autre pour ses propres raisons » (p. 64) et d’entre-capture, où la relation entre protagonistes implique des identités radicalement différentes tout en maintenant la nécessité de coexister sous peine de mutuellement disparaître. Ces notions deviennent essentielles pour comprendre qu’aux idées, source d’imposition de « faits incontournables », s’oppose la résistance des pratiques qui se confrontent à l’instabilité des réalités et de leurs valeurs relatives à des contextes.
En conséquence, l’idée ici d’écologie ne concerne pas seulement les contenus des œuvres ou démarches artistiques par rapport à une écologie du sonore, c’est-à-dire d’une part les questions relatives à la pollution sonore dans nos sociétés, et d’autre part à la mise en valeur des environnements sonores diversifiés. L’écologie des pratiques implique un ensemble complexe qui gravite autour des notions d’interaction entre êtres humains, entre les humains et les non-humains, en particulier avec les objets inertes et les technologies. Dans ce cadre les pratiques artistiques sont confrontées, comme les autres pratiques, à de difficiles dilemmes ayant trait par exemple aux questions de piratage des données, de respect du droit d’auteur, du pouvoir publicitaire des médias, de l’économie des industries culturelles et des pratiques alternatives à ces industries, d’accès gratuit ou non aux informations, d’accès facilité aux apprentissages (notamment spécialisés dans des techniques) et à la pensée critique, d’accès à des emplois, en bref tout ce qui contribue à influencer l’environnement, son avenir instable et incertain, et l’existence des êtres en son sein.
Passons maintenant à la description du dispositif choisi pour l’analyse d’un processus global en vue de la production d’un univers sonore. Il s’agit de la pièce de Karlheinz Stockhausen, Mikrophonie I. Ecrite en 1964-65, la pièce peut être décrite de la manière suivante :
Dans Mikrophonie I, deux percussionnistes jouent sur un grand tam-tam avec des accessoires variés. Une autre paire d’exécutants utilise des microphones tenus dans leurs mains pour amplifier des détails subtils et des bruits en modifiant le son par des mouvements rapides (et définis précisément dans la partition). Les deux derniers exécutants manipulent des filtres passe-bande résonants et distribuent les sons qui en résultent dans un système quadriphonique de haut-parleurs. (Burns 2002, p. 63, ma traduction)
On est bien là dans la définition d’un dispositif selon le sens que Michel Foucault a donné à ce terme (voir ci-dessus) :
- « un ensemble résolument hétérogène » : autour d’un instrument central – le grand tam-tam – à la fois imposant et symbolique dans sa théâtralité autant que dans sa musicalité, s’affairent de manière interactive des musiciens spécialistes de différentes disciplines, utilisant des objets hétéroclites et des technologies disparates.
- « comportant des discours » : la partition qui définit le déroulement temporel des évènements sonores, n’est qu’un élément parmi d’autres du propos du compositeur ; les explications concernant des processus, des situations, des descriptions d’objets, des places d’impact sur le tam-tam, ont une importance considérable dans la définition des types de sonorités déterminées par l’auteur ; des photos viennent aider à cette définition et en plus les interprètes ont accès aujourd’hui à des vidéos de réalisations de cette pièce.
- « des institutions » : la pièce est sous-tendue par l’existence d’institutions indispensables, mêmes si elles ne sont pas nommées expressément ; principalement les institutions d’enseignement qui déterminent les spécialités, celles de la recherche qui développent les technologies, celles qui concernent l’économie du concert, impliquant ici, en particulier, la présence d’un budget important pour acheter des matériels onéreux et payer le temps de travail des musiciens.
- « des aménagements d’architectures » : les espaces nécessaires aux expérimentations, répétitions et présentations publiques.
- « des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives » : celles qui concernent en particulier le droit d’auteur, le respect des instructions données par le compositeur.
- « des énoncés scientifiques » : la présence de technologies sophistiquées et de lois acoustiques et psycho-acoustiques s’appliquant dans le cadre d’un système particulièrement instable.
- « des propos philosophiques » : on est ici en présence d’une philosophie très innovatrice pour l’époque, celle d’un traitement du signal sonore par des moyens électro-acoustiques en temps réel, au moment du concert.
- « du dit aussi bien que du non-dit » : du côté du dit, les spécifications de la partition, du côté du non-dit la réalisation des instructions dans la réalité de la manipulation des objets pour produire les sonorités adéquates ; au contraire des partitions d’usage courant, le résultat sonore ne peut jamais être prédit de manière fiable.
Tous ces éléments constituent bien un réseau de possibilités à mettre en action interactive dans un processus temporel assez long en vue de produire une exécution publique de la pièce. Contrairement à l’exécution d’une pièce usuelle, aucun des éléments du réseau ne peut s’exercer automatiquement de manière habituelle, il faut tous les ré-envisager à nouveau à la lumière des exigences formulées par l’auteur dans un ensemble interactif.
L’exécution de cette pièce pose trois problèmes épineux :
- Les matériaux utilisés à l’époque de la création de la pièce ont depuis fortement évolué. Il s’agit surtout des technologies électroniques, et des matériaux utilisés pour exciter le tam-tam. Sans oublier le fait que l’accès au tam-tam d’origine est problématique et que tous les tam-tams sont différents.
- Stockhausen, ayant essayé de définir très précisément les actions réalisées lors de la création dans des descriptions et des données précises, a trouvé cette solution trop complexe. Et il a opté pour une série de mots (par exemple coasser ou cancaner [allemand quakend], froissement [knisternd], caqueter [gackernd], geindre [winseld], etc.) qu’il convient de traduire en sonorités. Cela implique un temps assez long d’expérimentations, de collecte d’objets, de développement de techniques de jeu appropriées.
- Les expérimentations ne peuvent pas se dérouler purement du point de vue de la préparation personnelle de chaque exécutant, elles doivent absolument impliquer la totalité du groupe en interaction pour prendre en compte le résultat sonore final.
Si la partition écrite pour les percussionnistes est très précise, notamment par rapport à la distribution des évènements dans le temps, elle demande de leur part tout un processus d’expérimentations préalable aux répétitions. Le tam-tam particulier utilisé sera différent de tout autre tam-tam dans sa capacité à produire des combinaisons de partiels lorsqu’il est excité à différents endroits de sa surface. La place exacte d’impact des objets, baguettes ou mailloches, spécifiée par l’auteur, doit pouvoir être déterminée par rapport à un résultat sonore significatif. La sélection des objets en métal, bois, verre, etc., ne peut se faire qu’en fonction de résultats à tester sur le tam-tam, et l’expérimentation des objets selon les spécifications de Stockhausen doit amener les instrumentistes à développer des techniques particulières pour parvenir à des productions sonores correspondant aux idéaux du compositeur.
On peut penser que le rôle de ceux qui manipulent les microphones et les filtrent est beaucoup plus traditionnellement passif : obéir aux instructions notées. Mais la nature des microphones, des haut-parleurs et surtout des filtres peut fortement varier, autant que le tam-tam lui-même. Aussi les chiffres inscrits sur la partition ont besoin d’être fortement interprétés par rapport au contexte acoustique et technologique. C’est certain, l’exécutant n’est plus seulement obéissant, mais doit pleinement prendre ses responsabilités dans la création du résultat sonore dans un espace acoustique donné. L’inscription de l’œuvre dans un long processus est clairement revendiquée par Stockhausen lui-même. A l’origine de la pièce le compositeur commence par une expérimentation sur le tam-tam en sa possession et par des essais improvisés d’amplification et de filtrages électroniques. Dans une conférence sur Mikrophonie I, Stockhausen décrit comment les musiciens lors de la création ont dû, à partir de la liste de mots, aller faire leur marché, puis longuement expérimenter les sonorités :
Nous avons procédé de cette manière : pendant des semaines, nous nous sommes réunis chaque jour ou tous les deux jours pendant plusieurs heures, en essayant beaucoup de matériaux sur le tam-tam et en optant pour les solutions qui nous paraissaient les meilleures. (Stockhausen 1989, p. 85, ma traduction)
Le compositeur est conscient de la nature instable de sa partition par rapport au résultat sonore effectif : « je ne peux pas prédire ce que cette interférence entre les trois exécutants pourra produire comme résultat sonore » (p. 82). Il reconnaît l’importance du travail collectif dans le processus d’expérimentations : « Dans beaucoup de cas, les solutions que nous avons trouvées en travaillant ensemble ont été meilleures que celles que j’avais choisies à l’origine » (p. 85). Il imagine avec un plaisir non dissimulé ce que pourrait être une exécution de cette pièce dans un avenir lointain, en pensant que cela n’aurait plus rien à voir avec les sonorités réalisées lors de la création de la pièce. Et finalement il donne lui-même aussi la possibilité de réaliser la pièce sur d’autres matières sonores que sur un tam-tam, il pense notamment à une vieille Volkswagen sur laquelle il serait possible d’explorer selon les méthodes utilisées dans la partition. La pièce, le dispositif, le processus ont donc une marque – « Stockhausen » – mais tout ceci relève aussi d’un collectif qui va collaborer à son expression. Pour garantir l’authenticité de la marque, de l’étiquette, il devient nécessaire de créer une collectivité initiée par le maître, ou par ceux qui en sont les héritiers directs. Sinon, on risquerait de laisser le concept Mikrophonie à des usages multiples et dont les résultats ne peuvent plus être garantis.
Peut-on envisager d’aller plus loin dans l’utilisation du dispositif Mikrophonie en laissant la liberté à des musiciens de l’utiliser à leurs propres fins ? L’utilisation en concert du dispositif sans la présence des spécifications de la partition de Stockhausen apparaîtrait sans aucun doute comme un vulgaire plagiat. Pourtant personne ne peut se prévaloir d’avoir des droits sur des dispositifs tels que l’orchestre symphonique, le quatuor à cordes ou même l’ensemble imaginé par Schoenberg pour le Pierrot Lunaire. L’irruption du timbre en tant que tel dans la production des compositeurs de la fin du XXe siècle crée des problèmes lorsque l’ensemble instrumental conceptualisé devient propriété intellectuelle. La collection d’instruments construite par Harry Partch de manière artisanale est l’exemple même d’un dispositif peu propice à l’élaboration d’une musique autre que celle que son auteur a composée spécialement pour les sonorités que cette collection est capable de produire. Chez Partch, on est en présence d’une non séparation des divers éléments constitutifs de la totalité d’une création : la construction des instruments par le compositeur lui-même dans des perspectives à la fois visuelles pour en faire des décors d’un théâtre et sonores à partir de matériaux soigneusement sélectionnés ; l’utilisation d’une théorie de l’intonation certes universelle, mais ici appliquée à un système de gammes donnant à chaque instrument son timbre particulier et son utilisation idiomatique propre au compositeur ; le parti pris d’un refus de la « musique abstraite », dans la présence obligée des textes, de la dramaturgie et du rôle théâtral « corporalisé » des musiciens. Le système proposé a une telle autonomie qu’il devient très difficile d’en extraire certains aspects sans impliquer la totalité sonore et théâtrale de la référence Partch.
De même, dans la pièce Zwei-Mann-Orchester de Mauricio Kagel (1971-73), la construction par le compositeur lui-même d’un espace scénique remarquable constitué d’objets sonores hétéroclites qui sont manipulés à distance par deux musiciens, démontre la primauté du concept – une globalité théâtrale et sonore – sur le langage musical utilisé. En effet toute combinaison sonore produite sur ce dispositif va se rapporter à son existence scénique et à ses modes de production inventés par l’auteur, comme dans le cas des sculptures sonores. Toute velléité de développer après coup des combinaisons sonores par d’autres musiciens en leur nom propre devient alors impossible, s’ajoutant d’ailleurs à l’interdiction par Kagel lui-même de le faire. Un même phénomène peut se constater dans le cas de Mikrophonie I, où le dispositif conceptuel en tant que tel, les instruments et technologies, leurs modes d’utilisation, prime fortement sur la grammaire : c’est l’univers sonore extraordinaire qu’il permet qui compte plus que le détail de l’organisation temporelle. C’est cet univers qui définit la pièce comme concept inventé par Stockhausen.
On peut pourtant imaginer plusieurs cas – tous inacceptables du point de vue du droit d’auteur, mais pourtant productifs d’autres significations que celles élaborées dans la partition qui définit l’œuvre – dans lesquels les exécutants, déjà créateurs lorsqu’il s’agit de jouer la partition, deviennent réellement des acteurs à part entière. Premièrement lors du processus d’expérimentation pour un choix adéquat d’objets et de techniques de manipulation du tam-tam, des microphones et des filtres, on peut imaginer d’une part que cette phase se fasse avec la réunion de tous les musiciens explorant de manière collective les possibilités du dispositif ; et d’autre part, on peut aussi imaginer que, au cours de cette expérimentation, les participants puissent prendre des chemins buissonniers et s’éloignent (pour mieux y revenir) des essais centrés exclusivement sur les spécifications de l’auteur. Deuxièmement, après l’exécution de la pièce en public, le groupe des exécutants, à partir de cette première expérience, pourraient avoir la possibilité de développer leur propre version de l’univers sonore du dispositif. Troisièmement, il est possible d’envisager, en gardant le dispositif tel quel, de mener une investigation des possibilités sonores n’ayant plus rien à voir avec la partition détaillée de Stockhausen et d’en faire un objet séparé, soit dans une nouvelle partition définissant le détail du déroulement sonore, soit dans une improvisation dont le protocole serait à la fois le dispositif Mikrophonie, et le réservoir de possibilités explorées dans un travail planifié d’expérimentations. Notons que ces trois possibilités sembleraient acceptables – car se situant en dehors de la présentation publique des œuvres – dans le cadre d’un projet pédagogique dont l’objectif serait de faire découvrir à des élèves une palette sonore à partir de contraintes fortement structurées, à leur faire découvrir comment la construire.
Mais les limites entre expérimentation, apprentissage et production, on le voit bien dans ces exemples, sont minces : ces trois secteurs d’activité s’entremêlent dans tout dispositif. Aussi la notion de dispositif correspond à une situation nouvelle, à la fois économique et esthétique. Au moment de la création de Mikrophonie I, en Europe, les processus d’expérimentation nécessaires à réaliser par les interprètes eux-mêmes étaient complètement intégrés au budget de concert, grâce à des subventions publiques très importantes et la présence acceptée des musiques expérimentales au sein d’institutions telles que les radios. C’est ce qui depuis les années 1980 s’est petit à petit fortement réduit et a correspondu aussi à la transhumance des musiciens des pratiques expérimentales vers les institutions d’enseignement, pour subvenir à leurs besoins. Ce mouvement vers l’enseignement et le monde universitaire avait été déjà constaté aux Etats-Unis depuis 1945, à cause de l’absence de subventions publiques importantes pour soutenir les activités musicales non commerciales. Et c’est à travers cette notion de dispositif regroupant dans un même mouvement, apprentissage, recherche et production, que la présence des musiciens dans les conservatoires et universités prend un sens esthétique au-delà des nécessités de survie économique. Sans l’espace, l’encouragement à la recherche, les salaires et les outils mis à disposition par l’université, l’expérience décrite par Christopher Burns dans l’élaboration d’une version de qualité de Mikrophonie I de Stockhausen ne pourrait avoir lieu. Mais cette émigration vers les lieux d’enseignement a aussi quelques effets pervers pour les musiques s’adressant à des publics limités et spécialisés ou qui se démarquent des industries culturelles : la culture de la gratuité gagne l’espace des concerts publics. Si rendre public ce qui se passe dans l’anonymat des institutions devient une nécessité « à n’importe quel prix » pour assurer une notoriété, si les avancées dans la carrière d’enseignant chercheur nécessitent des publications (dans le cas des interprètes, des concerts publics) et la participation à des colloques, alors il devient acceptable de le faire gratuitement, voire de payer pour le faire. Cela rejoint un autre phénomène, produit lui par Internet : une tendance de plus en plus affirmée à demander un accès gratuit aux productions culturelles, en plus de l’impunité des diverses pirateries informatiques. Le monde des productions « underground » devient de plus en plus pauvre et de plus en plus peuplé, celui des superstars de plus en plus riche et restreint à un tout petit groupe de personnes en comparaison avec l’ensemble des professionnels. C’est dans ce contexte politique que la question de l’écologie des pratiques prend tout son sens.
Un autre aspect politique créé par la notion de dispositif de production de timbre « apprentissage-recherche-production » est celui du droit d’auteur. Le droit d’auteur, tel qu’il a été élaboré à la fin du XVIIIe siècle, prend tout son sens lorsque, à partir d’une situation de production sonore commune à tous les auteurs (ou compositeurs) – le livre, la partition en notation standardisée, l’apprentissage du français écrit dans les écoles, les écoles de musique formant des musiciens « classiques », etc. – des différenciations peuvent s’exprimer. Lorsque ces outils communs de production sonore – c’est-à-dire la présence d’un support stable – disparaissent au profit de l’élaboration par les artistes eux-mêmes des conditions de production des supports, à travers des concepts sonores regroupant matériaux, techniques et interactions humaines, les choses se compliquent : la présence nécessaire évidente de collectifs d’individus participants à l’élaboration créative, les usages potentiels des dispositifs conceptuels dans des configurations qui se différencient de l’œuvre originale, contribuent à remettre en cause la suprématie d’un auteur unique, le réduisant à une marque d’origine contrôlée, ou à une étiquette publicitaire.
En France, dès le début des législations sur le droit d’auteur à la Révolution, se pose la question de savoir si les idées peuvent devenir la propriété d’un auteur, ou bien si le droit de propriété est inaliénable. D’après Benhamou et Farchy, dans les questions relatives au droit d’auteur, on est constamment dans un équilibre à trouver entre la « protection de l’auteur » et l’espace public, celui dans lequel les biens sont accessibles à tous (2014, p. 9). Cet équilibre reste instable selon les divers contextes historiques dans lesquels il s’inscrit. Confronté à la culture du numérique, cet équilibre devient de plus en plus difficile à trouver. Dans ces conditions il faut se demander si la question du timbre, dans la mesure où son élaboration concerne à la fois les supports technologiques, la formation des musiciens, le détail acoustique de sa création et aussi son instabilité fondamentale, rejoindrait celle des idées ne pouvant appartenir à personne en particulier. Rien ne semble très clair dans cette affaire.
La manipulation des timbres pose de nombreuses questions, notamment celle qui suggère que l’éthique interdit de se les approprier pour soi-même à des fins de prestige ou de commerce. Mais si l’on se réfère au contexte historique de la composition Mikrophonie I de Stockhausen, l’invention de ce dispositif s’inscrivait à l’époque dans une démarche où les innovations de l’avant-garde européenne en matière notamment de production électroacoustique avaient un sens profond. On ne peut retirer à Stockhausen le crédit d’avoir été un des pionniers de la musique électronique vivante (en temps réel). Aujourd’hui, dans le monde de l’information numérique et de son ambivalence oscillant entre catastrophe pour le monde des professionnels, concentration exagérée des pouvoirs de diffusion et bonheur des amateurs chercheurs, les enjeux ont profondément changés. Dans leur conclusion, Benhamou et Farchy nous mettent dans un dilemme concernant l’accessibilité de tous aux informations et la défense des intérêts des créateurs :
L’élargissement du droit d’auteur vers de nouveaux territoires, alors même qu’il est menacé de toutes parts est un paradoxe auquel aucun analyste ne saurait échapper. Cela pose la question des effets pervers à venir de la tentation de trop tirer le droit d’auteur vers des fonctions qui ne sont pas les siennes. A trop vouloir élargir le champ, ne risque-t-on pas d’en ruiner le sens ? (2014, p. 112)
La production du timbre semble se placer à la limite entre légitime reconnaissance d’objets sonores caractéristiques d’un auteur et usages collectifs indéterminés. Pour reprendre l’exemple de Mikrophonie en tant que dispositif, toutes les sonorités possibles et imaginables qu’on pourra en tirer sonneront bien comme l’expression du domaine du compositeur Stockhausen. Pourtant, la partition elle-même limite trop l’univers à quelques possibilités, laissant un monde infini inexploré.
Toutes ces préoccupations, toute proportion gardée, ne sont pas éloignées des questions éminemment politiques des brevets concernant les innovations techniques, notamment dans le domaine des manipulations du vivant. Comme dans le cas du timbre, le droit des brevets s’attaque aux supports mêmes de la vie (et de la survie) des espèces vivantes, pour en faire des objets de propriété et d’usage exclusif. Il est évident dans cette affaire, que la production du timbre et son contrôle n’a pas l’impact économique des brevets, ni ne pose la moindre menace envers l’environnement en dehors de l’influence de nuisances sonores sur l’ouïe. Mais, il faut se placer ici sur des considérations éthiques, qui sont essentielles dans les perspectives de l’écologie des pratiques.
Dans le cas des Organismes Génétiquement Modifiés, par exemple, une des controverses majeures est celle qui concerne le développement libre de nouvelles variétés d’organismes à partir de variétés protégées par le droit international. Selon le rapport du Conseil Economique et Social sur les OGM, « le droit des brevets ne favorise pas une innovation ouverte » (Siecker 2012, §4.3). Les gènes et les séquences de gènes pouvant être brevetés, « certaines variétés couvertes par un brevet ne peuvent alors plus être utilisées par d’autres pour poursuivre l’innovation, ce qui est dommageable pour la diversité biologique agricole » (§4.4).
En ce qui concerne la production sonore, nous nous situons très loin d’une absence de liberté ou d’interdictions arbitraires qui viendraient museler l’apparition d’une très grande variété de pratiques. Mais la question qui est posée, c’est celle de savoir si le timbre, qui est au centre des logiques d’invention de l’avant-garde européenne depuis au moins les compositions d’Edgar Varèse, est un objet qui dans sa création appartient à qui que ce soit, sinon dans le meilleur des cas à un collectif hétérogène, au sein d’un dispositif particulier. Qui peut prétendre au monopole de l’invention des timbres ? Est-ce du côté des concepts ou de celui des pratiques, du côté des compositeurs pragmatiques ou des instrumentistes ayant des projets réfléchis ?
2.6 Poiêsis ou Praxis ?
Avant de conclure ce long texte, revenons sur la question de la société électronique et le statut de l’œuvre d’art, à partir de cette notion développée auparavant d’une écriture lente des qualités de timbre. La modernité occidentale se caractérise par le statut sacré de l’œuvre (et son expression achevée dans le chef-d’œuvre) identifiée à la personne de son créateur. L’œuvre est incarnée dans un objet témoin qui garantit une stabilité atemporelle et met l’accent sur la personne qui la produit, un auteur identifié, laissant à tous les autres un rôle secondaire d’interprétation. Chaque œuvre doit se différencier des autres œuvres déjà produites et s’inscrit ainsi dans une temporalité historique.
Pourtant, la plupart des musiques traditionnelles du monde ne peuvent se définir en termes d’identification à des produits définitivement fixés, mais elles s’inscrivent plutôt dans des processus continus où la participation d’une communauté se joue au quotidien. La pratique est fixée par des règles sociales plus ou moins implicites qui se traduisent par des actes improvisés sur le moment et qui ne répètent jamais exactement les prestations du passé. La production est déterminée par un amalgame des productions collectives du passé réactualisées sous le regard critique de la communauté. On a l’impression que cette instabilité de l’acte artistique s’inscrit dans un formalisme immuable complètement conforme à son origine. Il n’y aurait donc pas d’histoire explicitée, alors qu’en réalité la production collective demande une adaptation permanente aux conditions des participants.
L’enjeu s’articule ici sur l’opposition entre les concepts de poiêsis, qui renvoie à une fabrication qui produit un objet et de praxis, qui implique une action qui n’a pas d’autre fin qu’elle-même. Ces concepts sont issus du monde de l’antiquité grecque et ils prennent aujourd’hui un sens particulier (Arendt 1961-1983). L’œuvre, selon Hannah Arendt, domine la modernité à travers la fabrication infinie d’objets et d’outils dans des logiques où le produit final prime sur les processus d’élaboration qui restent cachés comme moyens de parvenir à des fins :
Les outils de l’homo faber, qui ont donné lieu à l’expérience la plus fondamentale de l’instrumentalité, déterminent toute œuvre, toute fabrication. C’est ici que la fin justifie les moyens ; mieux encore, elle les produit et les organise. (…) Au cours du processus d’œuvre, tout se juge en termes de convenance et d’utilité uniquement par rapport à la fin désirée. (p. 206)
On peut facilement voir une connexion entre le productivisme de l’époque moderne et le développement de la société de consommation et de la marchandisation généralisée des biens. Mais pour H. Arendt, les œuvres d’art, si elles correspondent bien à cette primauté de l’objet fini, restent par leur caractère de transcendance hors d’un utilitarisme immédiat : « dans le cas des œuvres d’art, la réification est plus qu’une transformation » (p. 224). Elles sont capables par la pensée qu’elles incarnent d’assurer au monde moderne une permanence et une stabilité :
Le monde des objets faits de main d’homme, l’artifice humain érigé par l’homo faber, ne devient pour les mortels une patrie, dont la stabilité résiste et survit au mouvement toujours changeant de leur vie et de leurs actions, que dans la mesure où il transcende à la fois le pur fonctionnalisme des choses produites pour la consommation et la pure utilité des objets produits pour l’usage. (p. 229-230)
Les œuvres d’art de tradition européenne sont pensées par beaucoup comme se plaçant hors du champ d’un simple échange utilitaire. Pour eux, la garantie d’authenticité des genres et des styles, peut être considérée par beaucoup comme le seul rempart contre la marchandisation générale des produits culturels, facilitée par les médias électroniques. Les objets qui identifient dans le spectacle vivant l’auteur et l’œuvre (partitions, textes, notations diverses) ont la particularité de les distinguer des objets utilitaires par leur forme bizarrement hybride : c’est l’endroit de référence où est fixée la pensée de l’œuvre, et en même temps cette référence n’est rien sans sa réalisation sur scène, elle reste un élément caché faisant encore partie des moyens pour parvenir à une fin : l’acte.
Cependant toutes les pratiques d’aujourd’hui doivent d’une façon ou d’une autre se confronter aux formes de stockage des informations mises à la disposition par les technologies électroniques qui viennent subtilement changer la donne : enregistrements, disques, mémoires électroniques… La fixité des mémoires électroniques tend à une réification générale à la fois des œuvres sur partition et des actions ritualisées fixées dans la mémoire collective des participants. L’enregistrement fixe à jamais un moment particulier, mais dans ce processus même de solidification du réel, moins que jamais il ne peut prétendre représenter la tradition authentique : c’est ainsi que, à un certain moment, des personnes particulières ont fait cela, c’est un exemple parmi d’autres d’un type de pratique (voir ci-dessus, au sujet de Adorno et du phonographe). Pourtant, ces forteresses tournées vers le passé risquent de disparaître si elles ne sont pas capables de permettre en leur sein des manières diverses de respecter la tradition. Par ailleurs la numérisation des mémoires permet très facilement de les pirater à loisir et de les modifier à son propre profit. Les enregistrements fixent des évènements réels, mais ils sont précaires dans leur virtualité.
L’exactitude des mémoires restituant l’acte dans sa totalité, tend à dématérialiser l’objet comme un instant comme un autre, un référent de ce qu’il est possible de faire, mais qui n’est pas exactement ce qu’il conviendrait de faire dans la fidélité à la source, dans l’authenticité de l’origine. C’est le processus de fixation exacte des mémoires électroniques qui favorise dans tous les domaines la marchandisation générale des pratiques. Pour y échapper, il n’y a pas d’autres choix que de ruser en s’assurant que chaque évènement ne soit pas la simple répétition exacte d’une version qui l’a précédée. C’est là où se situe la nécessité de développer cette capacité de pouvoir traiter le signal sonore, le timbre, en temps réel.
Influencé aussi par les mémoires exactes des technologies liées à l’électricité, l’art traditionnel de l’Europe, dans sa version « savante », se trouve lui aussi dans l’obligation de réinventer son quotidien : il suffit d’examiner les différentes manières d’aborder les musiques anciennes ou d’historiciser les œuvres du répertoire, en réintroduisant notamment des formes improvisées qui avaient disparu. Un certain nombre de dispositifs expérimentés depuis 1945 ont profondément modifié la position du compositeur : les œuvres ouvertes, l’indétermination, l’aléatoire, les musiques électroacoustiques, les expérimentations sur les échelles et la manière d’accorder les instruments, la construction de nouveaux instruments, la collaboration avec des instrumentistes pour développer de nouvelles techniques, l’improvisation… Toute cette diversité de pratiques, basée sur des matériaux hétéroclites appropriés à des contextes, des manières différentes d’envisager la création, la présentation des œuvres au public et les rôles potentiels des participants (y compris le public), tout cela vient brouiller les pistes du chemin monolithique de l’art d’Occident.
On peut ainsi envisager que les nouvelles technologies sont loin de remettre en cause les traditions qui ont la capacité, grâce à leur pouvoir d’information et de stockage, de les promouvoir auprès d’aficionados de plus en plus experts. Cependant ces technologies entament aussi énormément la prétention à l’exclusivité des traditions et par là, leur aura. Elles favorisent les différenciations des pratiques dans tous les domaines et donc remettent au premier plan le caractère processuel et collectif de la praxis.
Revenons au texte de Hannah Arendt, pour qui le terme de praxis est remplacé par « l’action », liée le plus souvent à la « parole ». Pour elle, la condition de l’action dépend à la fois d’un collectif d’êtres humains à la fois égaux et différents. Dans ce sens, l’action et la parole caractérisent l’acte politique dans sa plus haute manifestation : faire quelque chose ensemble en reconnaissant également nos différences :
L’action, en tant que distincte de la fabrication, n’est jamais possible dans l’isolement ; être isolé, c’est être privé de la faculté d’agir. L’action et la parole veulent être entourées de la présence d’autrui de même que la fabrication a besoin de la présence de la nature pour y trouver ses matériaux et d’un monde pour y placer ses produits. La fabrication est entourée par le monde, elle est constamment en contact avec lui : l’action et la parole sont entourées par le réseau des actes et du langage d’autrui, et constamment en contact avec ce réseau. (p. 246)
L’interactivité entre participants dans la notion de praxis interdit la prédiction de ce qui va se passer et de la nature exacte du produit final, qui dans ce sens ne peut plus prétendre à être un produit digne de ce nom à offrir au marché. S’inscrit dans la praxis la fragilité et l’instabilité des rapports entre humains : « un seul fait, un seul mot, suffit à changer toutes les combinaisons de circonstances » (p. 249).
H. Arendt compare les systèmes d’interactions politiques de la Grèce et de Rome. Dans la Grèce antique, les lois sont là pour permettre les actions subséquentes des citoyens, « la polis n’était pas Athènes, mais les Athéniens » (p. 254). A Rome, au contraire, le génie politique était complètement tourné vers un art de la législature et de la fondation d’institutions. On retrouve cette même opposition dans, d’une part, les improvisations cadrées par des règles permettant la multiplicité des actions possibles, et, d’autre part, le formalisme plus structurel des partitions écrites ciblant des résultats prévisibles et précis.
La société moderne, plus influencée par Rome que par Athènes, a complètement dégradé l’action – qui fait correspondre l’acte au produit – dans l’exécution s’apparentant selon Adam Smith (cité par Arendt) aux « besognes domestiques » et aux « travaux les plus bas et les moins productifs ». Et Arendt de noter :
Ce sont précisément ces occupations, celles du guérisseur, de l’acteur, du joueur de flûte, qui fournissent à la pensée des Anciens les exemples des plus hautes et des plus nobles activités de l’homme. (p. 268)
Il est clair que les questions auxquelles il faut se confronter aujourd’hui par rapport à la production du « timbre » se situent du côté de la praxis, non seulement à cause de l’accent mis sur les processus (comme chez John Cage), mais aussi par rapport aux actions collectives centrées sur des questions politiques (comme chez George Lewis). Ce qu’on a besoin de réinventer au quotidien, c’est la pratique et non pas le résultat productif. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de production, mais qu’elle perd de son importance par rapport à la praxis. La réhabilitation de la praxis à l’époque de la mondialité électronique, remet le joueur de flûte dans la position d’être acteur de sa propre pratique, dans l’instabilité des rapports à autrui, le caractère éphémère des actes, et l’imprédictibilité des fins.
Conclusion
Ce texte oscille avec hésitation entre d’une part, du côté de l’écriture, l’impossibilité de la représentation des timbres par la notation qui signale l’impossibilité d’une hégémonie totale des compositeurs sur la production musicale et d’autre part, du côté de l’oralité, l’impossibilité d’une pure production des timbres libérée de toutes contraintes externes à ceux qui la rendent manifeste, ce qui signale l’impossibilité des mythologies qui gravitent autour de l’improvisation. Il convient de travailler dans l’entre-deux de ces deux abîmes en évitant d’y tomber. Le travail sur le timbre remet l’expérience pratique dans l’orbite de la dignité qui lui avait été refusée par les Modernes au nom de la rationalité et du refus des superstitions qu’elle ne manque pas de créer.
Le travail sur le timbre ne peut oublier les travaux scientifiques qui ont contribué à en approcher l’explicitation de sa réalité, ni ceux artistiques nés de la détermination arbitraire et hors le sonore réel de la composition musicale sur partition et qui ont aussi contribué à leur manière à émanciper le timbre de ses idiosyncrasies traditionnelles. On raconte souvent une fiction qui n’est pas dénuée d’éléments factuels : le timbre comme élément structurel à part entière a été inventé par Arnold Schoenberg, Edgar Varèse et quelques autres compositeurs de tendance « euro-logique » (pour reprendre un terme créé par George Lewis, 2004a). Une autre fiction moins connue raconte que, dans cette affaire, les musiques créées à peu près à la même époque par des instrumentistes ou vocalistes ont aussi joué un rôle éminemment important. Il ne semble pas acceptable qu’une de ces fictions prenne le pas sur l’autre. Il n’est pas non plus normal de verser dans le dénigrement du rôle joué par les musiques populaires dans l’exposition nouvelle des différents timbres, même dans le cadre très commercial (et par là problématique) des industries culturelles. L’importance de l’enregistrement des sons dans des mémoires (analogiques, puis électroniques et numériques) et le rôle essentiel qu’il assume dans l’élaboration des sonorités des diverses pratiques musicales de notre temps mérite d’être particulièrement souligné.
Par ailleurs, le présent texte, en reprenant la pensée de Bruno Latour dans son Enquête sur les modes d’existence, en traduit de manière subversive les propos, sans en comprendre la totalité de son contenu, mais surtout en changeant complètement la direction de sa finalité. Pour Latour, l’anthropologie des « Modernes », en faisant ressortir les contradictions qui les traversent, doit pouvoir les réhabiliter de manière pacifiée afin de faire face aux catastrophes annoncées par la destruction programmée de la terre et de ses habitants. La pacification des Modernes concerne la reconnaissance que la vérité n’appartient pas exclusivement aux sciences, mais que d’autres vérités s’expriment dans d’autres modes d’existence dont les arts font partie (classés dans son livre dans la catégorie des fictions). Pour étayer cette affirmation, Bruno Latour s’engage dans la présentation d’une asymétrie constitutive entre les sciences par définition « des Modernes » et les autres modes d’expérience qui, il semblerait, ne le seraient pas, chaque mode ayant ses propres conditions de « hiatus », de « trajectoire », de « félicités et d’infélicités », « d’être à instaurer » et « d’altérations » (Latour). D’un côté, les faits indéniables des sciences qui ne sont pas des constructions de l’esprit humain, de l’autre, toutes les constructions ou fictions possibles que les humains peuvent élaborer dans des vérités et des langages hétérogènes. En tentant de remédier à cette asymétrie, l’erreur moderne est placée du côté des sciences et de ses faits indéniables qui dénient toute vérité aux autres modes d’existence, qui les tolèrent de manière assez méprisante. Les arts de l’Europe savante, en tant que fictions, dans ce schéma échapperaient à toute critique, ils n’auraient aucune tendance à coloniser les autres cultures, à les tolérer avec condescendance, ou même à leur dénier le droit à être qualifiées pour en faire partie.
Ma fiction particulière, loin de contredire cette indépendance de vérité par rapport aux sciences modernes, détermine qu’il y a aussi à l’intérieur des arts des vérités relatives, dont une en particulier s’inscrit dans la fiction de la modernité dans les mêmes termes que les discours tenus par les sciences. Le déploiement de la confrontation des pratiques artistiques, chacune d’entre elles ayant son propre système de justification dans un monde globalisé, crée les conditions d’une critique aiguë dirigée contre toute forme d’hégémonie. Comment « les Modernes pourraient se ressaisir eux-mêmes » (Latour 2012, p. 187) par la captation des modes d’existence ayant leurs vérités propres, si ces modes d’existence sont entachés des mêmes maladies que celles notées au sujet des faits indéniables des sciences, de leur dévoilement par des dispositifs complètement construits par l’homme ? Comment pourraient-ils se ressaisir si les arts de la modernité occidentale n’avaient pas la même certitude que les sciences à considérer que les autres mondes construisent de toute pièce leurs dieux et qu’en plus ils y croient comme si c’était des faits indéniables ? Les mêmes injonctions contradictoires mises en œuvre à l’intérieur des autres modes d’existence (hors sciences) empêchent-elles l’asymétrie entre le moderne et le non-moderne et la fin des « bifurcations » des langues fourchues ?
L’analyse critique de la représentation, ici sous la forme de la notation musicale, est-elle la preuve d’une position fondamentaliste iconoclaste qui consiste à brûler les idoles des autres et à refuser pour des raisons morales (protestantes et puritaines) toute matérialisation des divinités ? Latour se demande : « Sommes-nous maintenant en mesure de remplacer l’irréparable fêlure entre ce qui est construit et ce qui est vrai, par le déploiement des trajectoires qui distinguent les différents modes de véridiction ? » (p. 181) A cette question, il répond résolument « non », en regrettant le triomphe du fondamentalisme et de la critique qui ont besoin l’un de l’autre pour continuer à exister dans la fiction du moderne en brûlant à tour de rôle leurs fétiches. Ou bien, autre scénario, est-ce que la position de la présente analyse se place au sein de l’expérience comme « victime collatérale » des contradictions des Modernes, « êtres de fiction » qui ne sont dignes de considération que « par charité » ? L’expérience qui serait alors réhabilitée dans la réconciliation des représentations et des choses ?
Edwin Muir (poète écossais) : Dans l’église écossaise des Orcades, sévère, « il n’y avait pas le moindre signe extérieur pour me dire que le Verbe s’était fait chair ». Marshall : « Le signe extérieur est nécessaire au poète. En définitive, c’est son rejet de l’image, de l’Incarnation au sens le plus fort du terme que Muir déplora dans l’Eglise de sa jeunesse. La foi lui apparaissait comme une abstraction, un rejet de la vie ».
(Jack Goody, La peur des représentation, p. 32-33)
Bibliographie
Adorno, Theodor W. 1984 : Gesammelte Schriften, vol. 19, Musikalische Schriften VI. Francfort sur le Main : Suhrkamp Verlag, « Die Form des Schallplatte », p. 530-34. La traduction français est ici.
——- 1988 : « Du fétichisme en musique et de la régression de l’audition », trad. en français de Marc Jimenez, Inharmoniques N°3, Musique et Perception. Paris : IRCAM Centre Georges Pompidou, Christian Bourgeois Editeur, p. 138-67.
——- 2002 : Essays on Music, selected, with introduction, commentary, and notes by Richard Leppert, trad. Susan H. Gillepsie.
Arendt, Hanna 1961-1983 : Condition de l’homme moderne. Paris : Calmann-Lévy.
Babbitt, Milton 1971 : « Edgard Varèse, A Few Observations of his Music », Perspectives on American Composers, Eds. Benjamin Boretz et Edwrd T. Cone, New York : Norton and Comapny Inc.
Bailey, Derek 1999 : L’improvisation: Sa nature et sa pratique dans la musique. Paris : Outre-Mesure.
Becker, Howard S. 1999 : Propos sur l’art. Paris : L’Harmattan, Coll. « Logiques Sociales ».
Benhamou, Françoise et Farchy, Joëlle 2014 : Droit d’auteur et copyright. Paris : La Découverte, Coll. Repère.
Benjamin, Walter 2000 : « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproduction technique », Œuvres III. Paris : Gallimard, Folio essais, première version (1935) p. 67-113, dernière version (1939) p. 269-316.
——- 2009 : L’origine du drame baroque allemand. Paris : Flammarion, Champs essais.
Burns, Christopher 2002 : « Realizing Lucier and Stockhausen: Case Studies in the Performance Practice of Electroacoustic Music », Journal of New Music Research 31, N°1 (mars 2002).
Cage, John 1961 : Variations II. New York : Edition Peters.
Certeau, Michel de 1980 : L’invention du quotidien, 1. Arts de faire. Paris : Union Générale d’Editions, Coll. 10/18.
Charles, Daniel 1978 : Le temps de la voix. Paris : Editions universitaires, Jean-Pierre Delage.
Erickson, Robert 1975 : Sound Structure in Music. Berkeley : University of California Press.
Foucault, Michel 1977 : « Entrevue. Le jeu de Michel Foucault », Ornicar, N°10.
François, Jean-Charles 1982 : « La note musicale et la synthèse digitalisée de l’onde sonore », Revue Traverses N°26, Rhétoriques de la technologie. Paris : Centre Pompidou, octobre 1982.
——- 1987-88 : « Timbre figé, timbre dynamique », Revue d’Esthétique, numéro spécial sur Cage, p. 205-208.
——- 1991 : Percussion et musique contemporaine. Paris : Editions Klincksieck.
——- 1992 : « Writing without Representation and Unreadable Notation », Perspectives of New Music, Vol. 30 N°1, Hiver 1992.
——- 2008 : « Dialog des Hochbegabten des Verstandes », in Vinko Globokar, 14 Arten einen Musiker zu beschreiben, Eds. Werner Klüppelholz et Sigrid Konrad, Saarbrücken : PFAU Verlag, 2008, p. 11-35
——- 2009a (version anglaise du précédent) : « Dialog of Deafening Gifted Eavesdroppers », Open Space Magazine N° 11, automne 2009, p. 2-23.
——- 2009b : « Que deviennent les valeurs dans la liaison globalisante entre pratique, recherche et enseignement dans le domaine de la musique ? » in Périphériques vous parlent, N°28 Web. Voir en ligne sur lesperipheriques.org.
——- 2013 : « Oralité – improvisation – écriture », in Théories de la composition musicale au XXe siècle, Vol. 2, Nicolas Donin et Laurent Feneyrou (direction scientifique). Lyon : Symétrie, p. 1315-1336.
——- 2015 : « Improvisation, Orality and Writing Revisited », in Perspectives of New Music, Vol. 53 N°2, été 2015, p. 67-144.
François et al 2007 (Jean-Charles François, Eddy Schepens, Karine Hahn et Dominique Clément), « Processus contractuels dans les projets de réalisation musicale des étudiants au Cefedem Rhône-Alpes », Enseigner la Musique N°9-10. Lyon : Cefedem Rhône-Alpes et CNSMD de Lyon, p. 173-194.
Goodman, Nelson 2005 : Langages de l’art : Une approche de la théorie des symboles (trad. fr. J. Morizot). Paris : Hachette.
Goody, Jack 2003, 2006 : La peur des représentations, L’ambivalence à l’égard des images, du théâtre, de la fiction, des reliques et de la sexualité, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat. Paris : La Découverte/Poche (première édition en anglais 1997).
Green, Lucy 2002 : How Popular Musicians Learn, A Way Ahead for Music Education. Aldershot, England and Burlington, Vermont, USA : Ashgate Publishing Company.
Hennion, Antoine 2009 : « Réflexivités. L’activité de l’amateur » dans Réseaux N°153 Passionnés, fans et amateurs, p. 55-78. Paris : La découverte. En ligne sur Cairn : Réseaux-2009-1-page-55.
Hoggart, Richard 1957 : The Uses of Literacy. Aspects of working-class life with special reference to publications and entertainments. Londres : Chatto & Windus.
Kagel, Mauricio 1971-73 : Zwei-Mann-Orchester. Universal Edition (UE 15848).
Latour, Bruno 2012 : Enquête sur les modes d’existence, une anthropologie des Modernes. Paris : Editions La Découverte.
Lewis, George 2004a : « Improvised Music After 1950 : Afrological and Eurological Perspectives, The Other Side of Nowhere », Jazz, Improvisation, and Communities in Dialogue, Eds. Daniel Fischlin and Heble Ajay. Middeltown : Wesleyan University Press, p. 131-62, (1996).
——- 2004b : « Afterword to ‘Improvised Music After 1950’: The Changing Same », The Other Side of Nowhere : Jazz, Improvisation, and Communities in Dialogue, Eds. Daniel Fischlin and Heble Ajay, Middeltown : Wesleyan University Press, p. 163-72. Article publié en français dans le site PaaLabRes, Edition 2016 ‘Plan PaaLabRes’, à la station « Afterword » (trad. Jean-Charles François).
——- 2008 : A Power Stronger Than Itself: The A.A.C.M. and Experimental Music. Chicago : University of Chicago Press.
Marc’O 1994 : Théâtralité et Musique. Paris : Association S.T.A.R.
Meyer, Leonard B. 1956 : Emotion and Meaning in Music. Chicago : Chicago University Press.
Oliveros, Pauline 2006 : « Improvisation in the Sonosphere », in Contemporary Music Review, Improvisation. Eds. Peter Nelson and Frances-Marie Uitti, Vol. 25, Parts 5+6, p. 481-2. Voir aussi www.deeplistening.org
Page, Christopher 1989 : « Polyphony before 1400 », chapitre 5, in The Norton/grove Handbooks in Music, Performance Practice, Music before 1600, Eds. Howard Meyer and Stanley Sadie. New York, London : W. W. Norton & Company.
Partch, Harry 1974 : Genesis of Music. Second Edition, Enlarged. New York : Da Capo Press.
Passeron, Jean-Claude 1993 : « Portrait de Richard Hoggart en sociologue », Enquête N°8 « Varia », p. 79-111. En ligne : openedition.org/enquete/175
Rimsky-Korsakof, Nikolay 1964 : Principles of Orchestration. New York : Dover Publications, Ed. Maximilian Steinberg, trad. Edward Agate.
Ritter, Johann Wilhelm 1810 : Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. Ein Taschenbuch für Frennde der Natur. Heidelberg : Zweytes Bändchen.
Ribac, François 2005 : « Cultures techniques et reproduction sonore dans la musique populaire », Enseigner la musique N°8, Education permanente, action culturelles et enseignement : les défis des musiques actuelles amplifiées, Actes des rencontres à Lyon, les 2 et 3 mars 2005, Lyon : Cefedem Rhône-Alpes, CNSMD de Lyon, p. 97-114.
Schoenberg, Arnold 1975 : Style and Idea, Ed. Leonard Stein. Londres : Faber and Faber.
Siecker, Martin (rapp.) 2012 : « Avis du Comité économique et social européen sur « Les OGM dans l’UE » (supplément d’avis) », Journal officiel de l’Union européenne du 6 mars 2012, p. C68/56-62. En ligne : JO Union Européenne du 6.3.2012
Solomos, Makis 2013 : De la musique au son, L’essence du son dans la musique des XXe-XXIe siècles. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
Stengers, Isabelle 1996 : Cosmopolitiques, Tome 1, « La guerre des sciences ». Paris : La Découverte/Les Empêcheurs de penser en rond.
Stockhausen, Karlheinz 1989 : « Microphony », in Stockhausen on Music, Conférences et Interviews regroupés par Robert Maconie. Londres, New York : Marion Boyars.
Sudnow, David 2001 : Ways of the Hand, A Rewritten Account. Cambridge, Mass., and London : MIT Press.
Szendy, Peter 2001 : Ecoute, Une histoire de nos oreilles. Paris : Les Editions de Minuit.
Weber, Max 1998 : Sociologie de la musique, Introduction, traduction et notes de Jean Molino et Emmanuel Pedler. Paris : Editions Métailié.
Wood, Michael 2009 : « Distraction Theory: How to Read While Thinking of Something Else », Michigan Quarterly Review, vol. XLVIII, N°4, Bookishness: The New Fate of Reading in the Digital Age, Automne 2009. En ligne sur quod.lib.umich.edu.


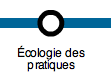
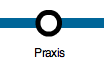






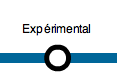
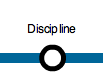
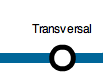

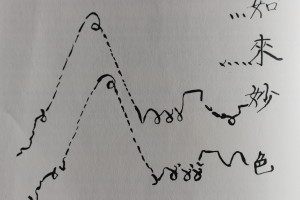
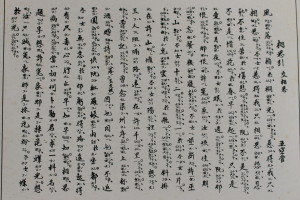
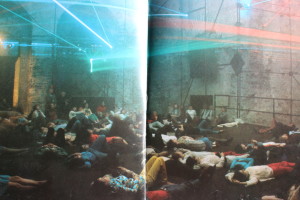

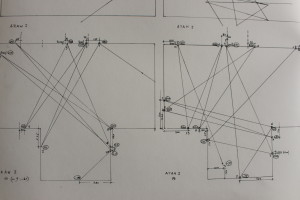

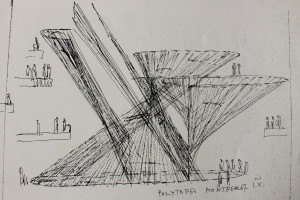
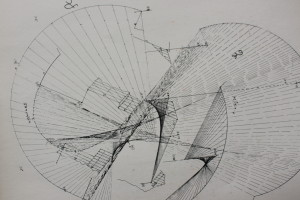
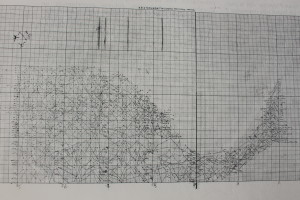


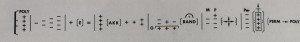
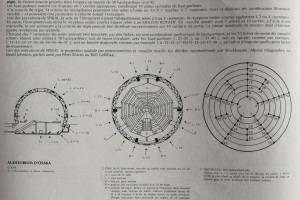
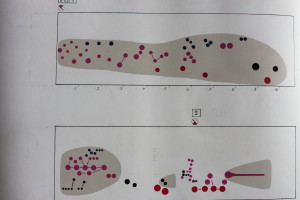
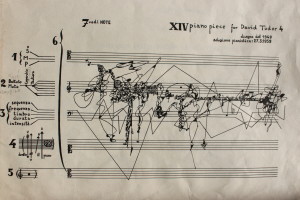
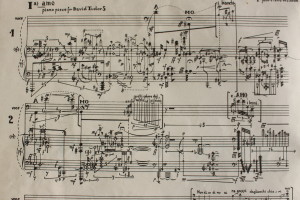

 IIMA
IIMA