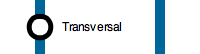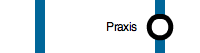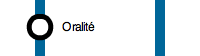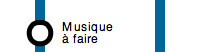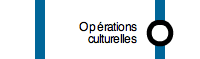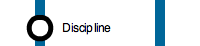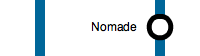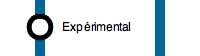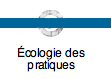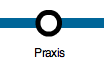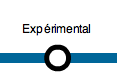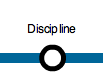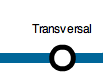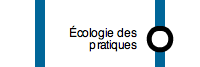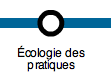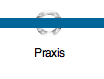Qu’entend-on par « écologie des pratiques » ? Le terme d’écologie affirme que des êtres vivants ont des relations avec leur environnement, dans des configurations d’interdépendance. La vie et surtout la survie des êtres vivants dépendent d’autres êtres, qu’ils soient vivants ou inertes, dans des situations particulières. L’écologie est devenue une préoccupation importante étant donné les menaces qui pèsent aujourd’hui sur la survie de la planète entière, par rapport précisément aux actions des humains. Les questions écologiques concernent de plus en plus les domaines importants de la culture et des relations entre les êtres humains, en sortant des préoccupations purement scientifiques pour envahir la sphère du politique.
Dans le domaine des arts, l’écologie s’est manifestée récemment plutôt sur le registre d’une prise de conscience des phénomènes naturels, souvent en voie de disparition, ou bien d’une prise de conscience de l’environnement urbain dans des perspectives d’une moralisation des usages excessifs et d’une volonté de créer des pratiques pondérées qui respectent l’espace des autres et l’environnement en général. Dans le domaine culturel l’écologie est pensée comme l’influence qu’exerce l’environnement sur les comportements et les mentalités des individus qui y sont immergé.
Pour le collectif PAALabRes, l’application du terme d’« écologie » prend un autre sens dans sa relation aux pratiques. Le terme de « pratique » fait référence à des situations concrètes constituées par des actions s’inscrivant dans une durée. La pratique implique le plus souvent des relations entre des êtres humains dans un collectif, et aussi des interactions entre ces mêmes êtres et des objets, tout ceci se passant dans un environnement matériel, culturel et institutionnel bien déterminé. C’est un dispositif particulier de tous ces éléments interactifs, instables dans la durée, qui constitue une « pratique ». Dans les domaines artistiques, les pratiques se définissent à la fois par :
- Des relations hiérarchisées entre des personnes qualifiées. L’idée de hiérarchisation implique qu’il y a des personnes plus ou moins qualifiées et que les qualifications peuvent varier selon des rôles définis, certains rôles étant réputés plus prestigieux que d’autres. La hiérarchie elle-même peut être plus ou moins affirmée et plus ou moins contrôlée par des règles démocratiques.
- Des relations entre d’une part des personnes et des objets sur lesquels des actions particulières sont mises en œuvre. Les objets influencent les actions des personnes autant que les personnes façonnent les objets. Des gestes techniques sont développés en fonction du comportement des outils de production.
- Des usages plus ou moins fixés par des règles. Les règles proviennent de traditions établies, ou bien peuvent être inventées pour des contextes déterminés. Elles sont plus ou moins explicites, et lorsqu’elles sont implicites, on a souvent l’impression qu’il n’y en a pas. Pour créer l’absence de règle, il faut inventer des mécanismes qui pour être efficaces doivent être réglés comme du papier à musique.
- Des relations avec le monde extérieur, notamment avec le public à travers des médias particuliers. Mais aussi des relations avec d’autres pratiques voisines, ne serait-ce que pour s’en différencier, pour en être influencé, ou pour pouvoir les disqualifier.
Les pratiques peuvent être ainsi pensées comme des êtres, des entités vivantes en tant que telles, qui interagissent d’une manière ou d’une autre avec d’autres pratiques. L’interaction entre les pratiques est précisément ce qui intéresse notre collectif PAALabRes comme concept fondamental à développer.
Le concept d’« écologie des pratiques » a été développé par Isabelle Stengers, philosophe des sciences, dans le Tome 1 de Cosmopolitiques. Dans une interview publié dans la revue Recherche, Stengers, parlant de l’écologie en termes de relations entre les êtres et les populations, désigne ces relations comme ouvrant la voie à trois options possibles qui varient selon les circonstances : a) les individus peuvent être des proies ; b) ils peuvent être des prédateurs ; c) ils peuvent constituer des ressources. Un des exemples favoris de Stengers, s’inspirant des pratiques instaurées par Toby Nathan, gravite autours des pratiques de la psychothérapie occidentale cadrées par l’esprit scientifique de la médecine moderne et des pratiques des psychothérapies traditionnelles pré-modernes ou non modernes. La plupart du temps ces deux pratiques ont du mal à coexister, car les premières disqualifient toutes les autres au nom de la rationalité scientifique, et les autres sont tolérées du bout des lèvres par la première dans le cadre de la survie muséifiée des cultures. Pourtant les clés du succès des thérapies se trouvent bien souvent dans les croyances et l’environnement culturel des individus concernés :
En termes écologiques, la manière dont une pratique humaine se présente à l’extérieur, et notamment dont elle se propose d’entrer en relation avec le grand public, fait partie de son identité. Pour le moment, l’identité de la physique, c’est à la fois tous les êtres qu’elle a créés, le neutrino et consorts, et son incapacité à se présenter en tant que pratique au grand public. Pour moi, essayer de créer de nouveaux liens d’intérêt autour de la physique ou d’autres pratiques, c’est faire une proposition, non pas de changement radical mais de mutation d’identité. (…) Le physicien ne serait plus cet être qui, soudain, intervient au nom de la rationalité en disqualifiant tous les autres. (…) Dans ma spéculation, ce physicien pourrait devenir un allié si l’on décidait, par exemple, de prendre au sérieux les pratiques psychothérapeutiques traditionnelles qui font intervenir des djinns ou des ancêtres. Il saurait qu’en disant cela on ne prétend pas que le djinn est de même nature que le neutrino : il saurait qu’on va s’intéresser au risque de ces pratiques, à ce qu’elles réussissent à faire. Dans ce monde où les pratiques sont présentes par leurs risques et leurs exigences, le physicien peut coexister avec le thérapeute traditionnel1.
Dans le domaine des arts, en particulier dans l’art musical, parce qu’il est tellement lié aux problèmes d’identité, la disqualification des pratiques des autres est la règle plutôt que l’exception. Les genres ou styles sont plus souvent des proies ou des prédateurs, rarement des ressources. La disqualification se manifeste principalement de quatre façons différentes et souvent de manière simultanée : premièrement sur des questions de compétences ou d’expertises artistiques techniques, soit par exemple qu’on ne sache pas lire la musique sur partition, soit qu’on soit incapable d’improviser lors d’une soirée ; deuxièmement la disqualification se mesure à l’aune d’une prétendue authenticité, soit par exemple qu’on accuse une pratique de ne pas respecter une tradition, soit au contraire qu’on accuse une tradition d’être la source d’une stagnation mortifère ; troisièmement, la disqualification est induite par rapport à un succès public, soit en accusant une forme artistique d’être commerciale au point de ne plus faire partie de l’art légitime ou en l’accusant d’être trop éloignée de la compréhension du public, au point d’être trop marginalisée ; et quatrièmement elle s’inscrit dans un rapport aux institutions d’enseignement officielles, soit qu’une pratique donnée en soit exclue, soit au contraire que cette même pratique revendique fortement son existence hors institutions, celles-ci étant mises en accusation d’être la source d’existences trop confortables.
La question posée par la tentative de sortir des logiques infernales de la disqualification des pratiques des autres pour entrer dans une écologie des pratiques pacifiée n’est pas simple. Il ne s’agit pas de faire cesser les conflits, ou de fondre les cultures dans un « melting pot » idéalisé, mais plutôt d’organiser la confrontation des pratiques sur un pied de reconnaissance mutuelle et d’égalité de droits. La difficulté majeure à ce programme politique est qu’il ne s’agit pas de laisser les cultures coexister dans un espace même s’il apparaît à première vue pacifique : les enclaves multiples dans une institution commune (ou un territoire commun) dans l’ignorance mutuelle de leur raison d’être et dans des relations qui consistent simplement à les juxtaposer, voire même à les superposer, ne créent nullement les conditions d’un contrat démocratique viable susceptible de pacifier les antagonismes fondamentalistes. La confrontation effective des pratiques dans des mécanismes à inventer qui les obligent à les faire interagir dans le respect de leur propre existence, sans compromis, devient une nécessité pour faire face (tout au moins en partie) aux difficultés dans lesquelles s’enfoncent nos société. Seules l’existence d’institutions publiques dédiées à cet effet pourraient sans doute venir éviter le danger permanent de guerres civiles plus ou moins violentes.
L’écologie des pratiques se décline sur le mode de l’émergence continuelle de pratiques nouvelles à partir de celles déjà en existence et de la disparition d’autres pratiques. Ce phénomène semble s’être fortement renforcé par l’apparition des moyens électroniques de communication instantanée. L’apparition de ces nombreuses pratiques implique dans chaque cas, comme le note Isabelle Stengers, la « production de valeurs, (…) la proposition de nouveaux modes d’évaluation, de nouvelles significations »2. Dans les perspectives de l’écologie des pratiques, il ne s’agit plus de penser ces valeurs, évaluations et significations comme venant remplacer les anciennes au nom d’une vérité qu’on aurait enfin découverte, mais elles « ont pour enjeu la production de nouvelles relations venant s’ajouter à une situation déjà produite par une multiplicité de relations »3. La multiplicité extraordinaire des pratiques qui émergent et disparaissent, par le contenu très varié des significations qu’elles expriment, a pour conséquence la remise en cause des processus de normalisation menant à des vérités universellement reconnues et imposées à tous. Aux idées, source d’imposition de « faits incontournables », s’opposent la résistance des pratiques qui se confrontent à l’instabilité des réalités et de leurs valeurs relatives à des contextes.
En conséquence, l’idée ici d’écologie ne concerne pas seulement les contenus des œuvres ou démarches artistiques par rapport à une écologie du sonore, c’est-à-dire d’une part les questions relatives à la pollution sonore dans nos sociétés, et d’autre part à la mise en valeur des environnements sonores diversifiés. L’écologie des pratiques implique un ensemble complexe qui gravite autours des notions d’interaction entre êtres humains, entre les humains et les non-humains, en particulier avec les objets inertes et les technologies. Dans ce cadre les pratiques artistiques sont confrontées, comme les autres pratiques, à de difficiles dilemmes ayant trait par exemple aux questions de piratage des données, de respect du droit d’auteur, du pouvoir publicitaire des médias, de l’économie des industries culturelles et du subventionnement des pratiques alternatives, d’accès gratuit ou non aux informations, d’accès facilité aux apprentissages (notamment spécialisés dans des techniques) et à la pensée critique, d’accès à des emplois, en bref tout ce qui contribue à influencer l’environnement, son avenir instable et incertain, et l’existence des êtres en son sein.
1. Isabelle Stengers : « Inventer une écologie des pratiques » www.larecherche.fr/savoirs/autre/isabelle-stengers-inventer-ecologie-pratiques-01-04-1997-69210
2. Ibid., p. 59.
3. Ibid.
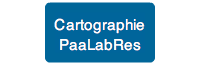 Pour un itinéraire-chant vers…
Pour un itinéraire-chant vers…