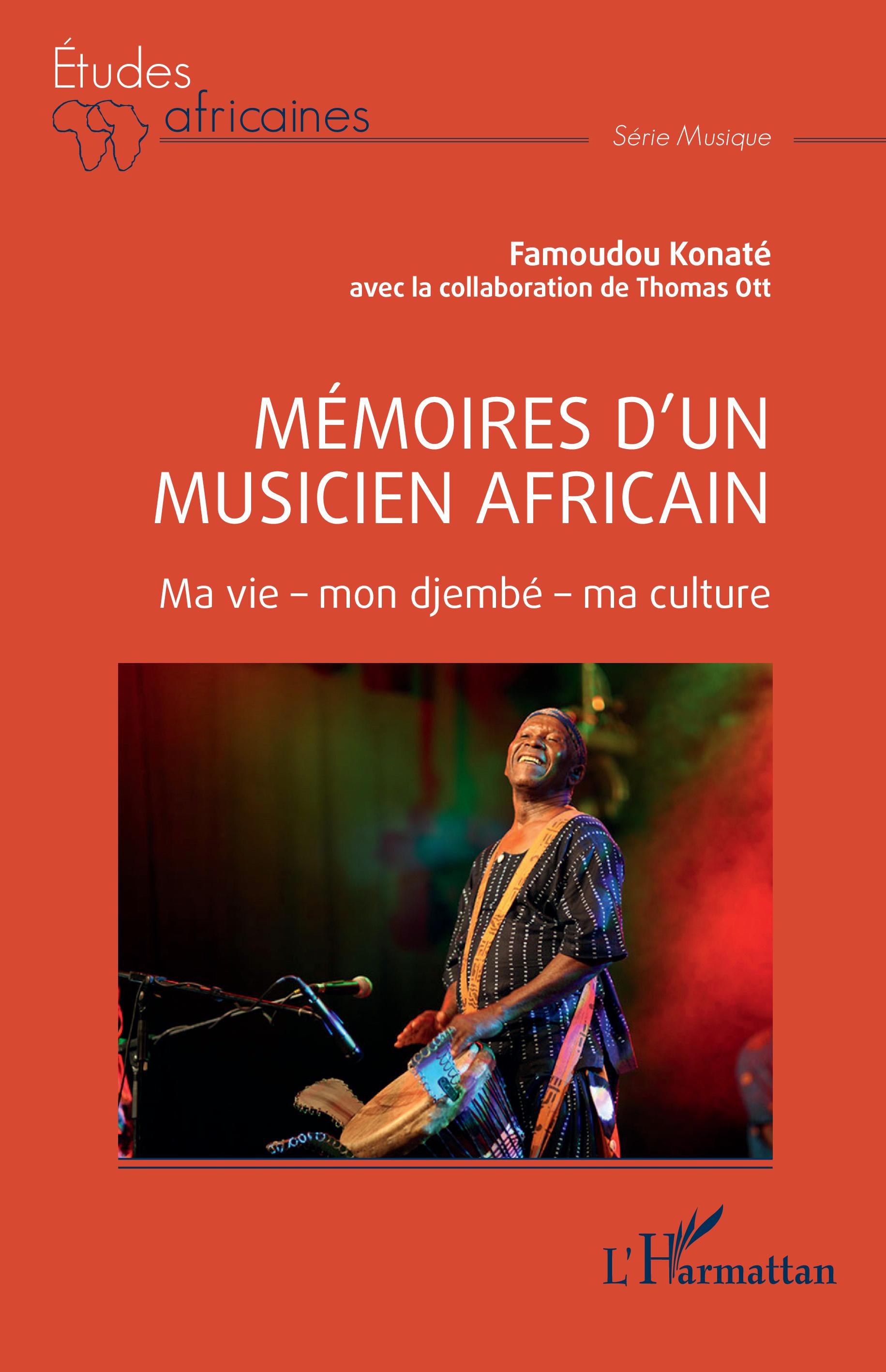Commentaires sur le livre de Famoudou Konaté
Mémoires d’un musicien africain
Jean-Charles François
2025
Sommaire :
Introduction
La création d’un Ballet national en Guinée.
Le choix de se présenter aux Ballets Africains
Les Ballets Africains entre émancipation et oppression
L’indépendance artistique grâce à l’enseignement
Conclusion
Introduction
En 2022, Famoudou Konaté, « grand représentant de la tradition musicale Malinké de la Guinée »[1], a publié un livre tout à fait remarquable, Mémoires d’un musicien africain, Ma vie – mon djembé – ma culture écrit avec la collaboration de Thomas Ott, qui « a été professeur universitaire de pédagogie musicale à Berlin ».
Loin d’être une simple autobiographie, il s’agit d’un récit très approfondi des divers problèmes de nature artistique, sociale et politique auxquels a dû se confronter un musicien africain dans la période de 1940 à nos jours : grandir dans un village traditionnel en Guinée, parcourir le monde en tant qu’artiste représentant la Guinée indépendante, apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte, devenir professeur en Guinée et en Europe, mener une réflexion approfondie sur sa propre pratique et sur la tradition dans laquelle elle s’inscrit. Famoudou Konaté, dans son livre, nous fait part avec une richesse de détails et d’analyses d’un certain nombre d’aspects de sa propre vie qui couvrent des domaines tels que la pratique musicale, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’Afrique, la géopolitique, la sociologie des pratiques artistiques, la lutherie instrumentale, les techniques de jeu sur les instruments, la pédagogie des musiques orales, et pour unifier le tout la présentation d’une riche philosophie de la vie. Pourtant ce n’est pas du tout un livre à prétention « académique », tout le monde peut avoir accès à l’aperçu global de sa pratique, avec en plus de nombreux récits, histoires, légendes, qui illustrent avec humour les informations d’ordre artistique et autobiographique.
Dans son introduction au livre, Thomas Ott en explique la genèse. Après avoir appris à lire et à écrire lors des tournées mondiales des Ballets Africains, Konaté a pris l’habitude de rédiger « un grand nombre de notes autobiographiques (…) en français pendant de nombreuses années » (page 15). Le travail de Thomas Ott a consisté à classer ces notes, les traduire en allemand[2] et de les rassembler dans une forme qui fait sens. Il décrit les deux tournants heureux de la vie de Famoudou Konaté :
- Tout d’abord sa sélection pour faire partie des Ballets Africains représentant la Guinée, alors que dans la tradition de son village il devait se marier et abandonner sa pratique du djembé.
- Et beaucoup plus tard il quitte les Ballets Africains qui était aussi pour lui devenu une organisation trop oppressive qui limitait l’extension de sa posture artistique internationalement reconnue. Il devient alors artiste indépendant, grâce en partie à l’enseignement de sa musique, de sa culture dans son village d’origine et dans les institutions européennes.
Dans chacun des tournants de la vie de Konaté, l’ambivalence qu’on peut rencontrer dans toute pratique se fait jour et le met dans la nécessité de creuser son chemin dans le tissu des contradictions, ce qui le rend capable d’acquérir une hauteur de vue universelle dans la conduite de ses récits multidimensionnels. Les conditions dans lesquelles s’inscrit toute mise en pratique est que tout acte se passe dans l’obscurité au milieu d’éléments qui jouent les uns contre les autres. Il convient comme dans l’improvisation de se tracer un chemin tant bien que mal à partir de ce qu’on a déjà construit, sans la possibilité d’avoir le temps de penser rationnellement. Mais ce tracé n’est pas comme l’écriture où chaque mot pris individuellement tisse une signification globale avec la série qui vient de se lire et celle qui va se lire. Dans les pratiques orales, les contradictions, les complexités sont là bien présentes et il faut en jouer sans penser aux conséquences. Mais au fil des ans on peut prendre des notes réflexives et arriver avec le temps à des vues qui clarifient dans une globalité les aléas des circonstances. Dans ce sens la pratique n’est pas consciemment idéologique, même si les idéologies peuvent bien s’exprimer inconsciemment dans les comportements du corps humain.
Thomas Ott nous dit que la musique de Famoudou Konaté a été pour lui « le pont vers l’Afrique en général ». Il précise que :
« Fidèle à l’adage “Qui ne connaît que la musique ne connait rien à la musique”, j’ai rapidement commencé à m’intéresser aux problèmes politiques, sociaux et économiques de l’Afrique » (page 19).
Pour ma part, je dirais que je ne connais pas très bien la musique de Konaté ni les musiques et danses africaines, mais grâce à la lecture de son livre, j’ai une idée beaucoup plus précise dans sa globalité de ce qui entre en jeu dans ces contextes, avec toutes les informations utiles qu’il donne sur les aspects musicaux, artisanaux, politiques, sociaux, économiques et culturels de sa pratique artistique et des liens qu’il est capable de tisser entre tous ces domaines.
La création d’un Ballet national en Guinée
En 1958, le gouvernement du Général De Gaulle propose aux colonies africaines subsahariennes de la France leur indépendance dans le cadre d’une association intitulée Communauté franco-africaine. Un seul pays, la Guinée, sous l’impulsion de Sékou Touré qui en deviendra le président, refuse par référendum cette association. En deux mois la France retire tout l’appareil administratif et économique, cessant ainsi toute relation.
Pour affirmer une complète indépendance, la Guinée est placée devant la nécessité d’être reconnue en tant que nation de par le monde. Il lui faut absolument affirmer son identité culturelle africaine et développer des outils diplomatiques pour la représenter. C’est ainsi que se créent les Ballets Africains (sur le modèle d’ensembles déjà en existence) regroupant les meilleurs artistes de la musique et de la danse du pays. Il s’agit de présenter l’essence d’une nouvelle nation, sa tradition spécifique en dehors des influences extérieures, dans une seule soirée à l’issue de laquelle n’importe quel public va être à même de comprendre de quoi il en retourne. Pour se faire, il semble qu’il n’y ait pas d’autre choix que de se conformer aux lois de la représentation dominante de l’époque, c’est-à-dire celle déterminée par la pensée occidentale à la fois dans les manifestations culturelles et la diplomatie. La mise en spectacle de la tradition semble donc être le moyen de parvenir à ce but.
Cette tâche contradictoire par rapport aux pratiques traditionnelles du village peut paraître anodine, étant donné que ce sont bien les manières traditionnelles qui sont présentées sur scène et non des pratiques édulcorées ou complètement déformées. Pourtant ce petit détail de mise en forme en vue d’être compris par ceux qui mènent le monde, change profondément la donne. Il ne s’agit pas ici pour moi de rechercher une quelconque authenticité qui se trouverait à l’origine d’une tradition. En effet, les traditions orales ont bien la capacité de se réinventer constamment au gré des évènements. Il s’agit seulement de souligner la tension existante entre l’affirmation de l’indépendance vis-à-vis de la puissance coloniale, tournée vers les cultures autochtones d’une part, et l’affirmation de l’existence de la nouvelle nation sur la scène internationale d’autre part. La Guinée doit alors se conformer aux formats en vigueur : il faut qu’elle se constitue en nation, qu’elle se dote d’un drapeau et se résoudre à se mettre en scène dans les formes inventées par la modernité occidentale.
Pour construire le récit de la nation guinéenne, il faut effacer en partie les différences culturelles qui peuvent exister dans le pays et faire en sorte que les pratiques puissent se détacher des contextes globaux dans lesquelles elles s’inscrivent. Il convient alors d’inventer des actes artistiques qui soient séparés des implications sociales, politiques et culturelles liées à la vie quotidienne des villages. Il faut transformer les personnes ayant des rôles sociaux prédéterminés en artistes professionnels.
Le choix de se présenter aux Ballets Africains
Famoudou Konaté a grandi dans son village et il est devenu très tôt reconnu pour ses grandes capacités à jouer du djembé. Il est issu d’une famille noble ce qui détermine son rôle dans la société du village auquel il appartient. Il décrit cette situation dans ces termes :
Dans les villages de Hamana, toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants savent à quel groupe ils appartiennent et quelles sont leurs tâches au sein de la communauté :
Les hörön (« hommes libres ») constituent la noblesse. Ils sont les gouvernants. Autrefois, ils décidaient de la guerre et de la paix et étaient eux-mêmes de grands guerriers. Ils règlent tout ce qui est lié à l’agriculture. Mais en fin de compte, ils sont responsables de toute la communauté et de toute ses affaires. (Page 91)
Pour Konaté, les autres castes, « artisans de la société » se divisent en trois groupes : a) les travailleurs du cuir ; b) les griots ; et c) les forgerons.
Thomas Ott souligne dans son introduction au livre que Famoudou Konaté ne serait pas devenu un musicien professionnel s’il n’avait pas été sélectionné pour faire partie des Ballets Africains créés au moment de l’indépendance de la Guinée en 1958. En effet les membres de la famille des nobles devaient à l’âge adulte se marier et ne plus pratiquer la musique. Konaté écrit :
Celui qui s’appelle Coulibaly, Keïta ou Konaté, comme membre de la classe supérieure, n’est en fait pas compétent pour jouer du tambour. Dans ma famille, il devait cesser de le faire dès qu’il se mariait. Mamady Keïta et moi sommes devenus des percussionnistes professionnels uniquement parce que nous étions recrutés pour les grands ensembles d’État. (Page 92)
Les griots sont à la fois des historiens, des conteurs, des généalogistes, des diplomates, des conseillers et des musiciens dont « les outils de travail sont les mots (langage) et les sons (musique) » (page 92). Pour lui, dans la tradition l’usage des instruments de musique leur est réservé, mais la musique n’est pas pour eux une « fin en soi, mais un moyen d’expression dans leurs multiples tâches sociales » (page 94)[3]. Selon Konaté, les forgerons fabriquent les djembés, et à ce titre « les joueurs de tambour sont souvent issus des familles de forgerons » (page 92), les griots jouant le plus souvent du balafon ou de la kora.
Voici donc une première contradiction fondamentale entre le respect de la tradition et l’accès à une certaine modernité. Famadou Konaté ayant déjà acquis une réputation de grand joueur de djembé, a été placé devant le choix de rester dans son village et de cesser de jouer cet instrument, ou bien de se tourner vers l’univers du spectacle vivant qui crée ses objets de manière séparée pour être présentés dans un temps limité à un public à priori non « initié ». Dans la tradition du village, le statut du domaine de la musique reste ambigu. Le système de caste prédétermine les rôles en mettant sur les griots l’obligation d’être musiciens, mais comme le dit Konaté ci-dessus, la musique n’est pas pour les griots une « fin en soi », la musique s’inscrit toujours dans un contexte global. Pourtant il n’y a pas d’activité (travail, cérémonies ou fêtes) sans la présence très importante de la musique. L’apprentissage de la musique se fait en dehors de toute méthode pédagogique, il n’y a pas d’obligation à atteindre une excellence spécifiée, mais les réputations créent des hiérarchies, des comparaisons et des préférences. Par réputation, Famoudou est considéré comme le meilleur djembéföla dans son village et au-delà, mais maintenant il doit le prouver pour être recruté comme soliste dans les Ballets Africains en entrant en compétition avec tous ceux provenant de toutes les régions du pays. Le statut de la musique change lorsqu’on passe d’un contexte très localisé à la notion de nation constituée : Konaté n’est plus jugé comme homme africain, mais de manière stricte comme musicien. Sauvé par l’indépendance de la Guinée et la création des Ballets Africains, il peut continuer à jouer du djembé, sa passion dans la vie. C’est d’avoir grandi dans la tradition dans laquelle le djembé est inscrit qui lui permet de remporter le concours d’entrée aux Ballets, mais par cet acte il devient un spécialiste professionnel dans le sens européen du terme.
On a donc d’une part une tradition villageoise qui tend à ne pas différencier les aspects politiques et sociaux des expressions religieuses, culturelles et artistiques, tout le contraire des rationalités occidentales qui spécialisent fortement les diverses fonctions et domaines de pensée. D’autre part il s’agit de regrouper au niveau national les meilleurs artistes de la musique et de la danse issus de ce type de tradition. Mais la grande étendue du territoire de la Guinée n’est pas culturellement homogène, ce qui nécessite la création d’une musique prenant en compte les différences. Même si la pratique de la mise en scène et mise en musique des Ballets Africains reste complètement orale, la conciliation des différences crée une situation de musique qu’il faut fabriquer au préalable de la prestation scénique. Famoudou cite le cas de Arafan Touré, qui était second soliste dans les Ballets Africains, originaire de Basse-Guinée, et ayant une approche rythmique complètement différente, difficile à concilier avec son propre jeu (page 88). Il cite aussi le cas de Mamady Keïta en ces termes :
Ma relation avec Mamady Keïta a été marquée par une grande affection et un respect mutuel (…). Il était originaire du village de Balandugu, près de Siguiri, à 150 km de Kouroussa. Nous appartenons à la même culture Malinké, néanmoins il y a quelques différences musicales et culturelles entre nos deux régions (Hamana et Wassulu), et nous n’avions ni l’un ni l’autre une connaissance parfaite de la culture de l’autre. (Page 89)
Les Ballets Africains entre émancipation et oppression
La deuxième source d’ambivalence dans la vie de Konaté se trouve dans le fonctionnement même des Ballets Africains, à la fois source d’une ouverture sur le monde, d’un succès artistique international et d’un système répressif qui réduit les membres de l’ensemble à une existence d’exécutants serviles. L’opportunité des Ballets représente une chance inouïe pour un villageois, mais les conditions dans lesquelles se passent le travail ont parfois des équivalences avec un statut indigne d’êtres humains.
La chance que représente la sélection de Famoudou Konaté pour faire partie des Ballets Africains va pour lui bien au-delà du seul fait qu’il peut se consacrer pleinement à l’art du djembé. En premier lieu, pendant les 25 ans où il joue avec les Ballets Africains, il y a chez lui une grande fierté de représenter au monde la culture de son pays avec les plus hautes exigences artistiques :
Comme on pouvait s’en douter, d’un point de vue artistique, on exigeait de nous, musiciens, danseurs, danseuses, un dévouement total à notre travail et la plus haute qualité d’exécution. C’est sous cette loi que nous nous sommes présentés, car nous devions faire honneur à notre pays dans le monde entier. (Page 52)
Les Ballets Africains font plusieurs fois le tour du monde, il y a peu de contrées qui n’ont pas reçu pendant cette période la visite de cet ensemble. D’après Famoudou, il s’agit là d’un « énorme privilège » pour des Africains (page 65). C’est l’occasion pour lui de faire des comparaisons sur les différents modes de vie et attitudes culturelles, notamment par rapport au partage à l’époque entre le monde communiste et l’occident. Il s’agit aussi de se confronter à la fois au succès immense auprès de publics fortement intéressés par la découverte des cultures du monde entier, et aussi aux préjugés et attitudes racistes rencontrées dans la vie quotidienne.
C’est surtout l’occasion pour lui d’apprendre à lire et écrire, ce qu’il n’avait pu faire dans son enfance à cause de l’absence d’école dans son village :<:P>
Les nombreux voyages avec les Ballets ont représenté pour nous tous qui n’avaient pratiquement jamais quitté nos villages d’origine en Guinée, un énorme élargissement de nos horizons. Je trouvais particulièrement important d’apprendre à parler et à lire le français, car je n’étais jamais allé à l’école. Le manque d’éducation est un lourd fardeau. C’est pourquoi j’étais reconnaissant que l’on nous donne des cours de français dès notre premier voyage. (Page 97)
C’est ce qui lui permet de tenir un journal de bord riche de réflexions et d’anecdotes significatives. Éventuellement cela lui permet d’écrire le livre autobiographique basé sur les notes accumulées sur des années.
Cet immense succès international, cette ouverture sur le monde, cet accès à l’éducation doit pourtant se payer par la corruption de la direction des Ballets, et l’oppression d’un système qui limite fortement la liberté de ses membres. Les conditions de travail sont souvent très dures, les logements peu dignes, les salaires trop bas pour une vie normale, avec des mises à l’amende pour tout manquement au règlement. Les relations au sein de l’ensemble entre les hommes et les femmes sont strictement interdites et une police interne surveille les chambres pour faire respecter cette règle.
Quand les choses se passent en présence du président Sékou Touré, tout va bien, mais sinon le système répressif bat son plein, avec son cortège d’intrigues. À un certain moment, Sékou Touré est celui qui améliore les conditions de vie en octroyant aux artistes des Ballets le statut de fonctionnaires. Mais après sa mort en 1984, le nouveau pouvoir néglige les politiques artistiques et les rapports au sein des Ballets se détériorent considérablement. C’est à ce moment-là que Konaté a quitté cet ensemble prestigieux.
L’indépendance artistique grâce à l’enseignement
Quitter les Ballets n’a pas été une mince affaire, mais petit à petit Famoudou Konaté acquiert son indépendance artistique. Surtout il établit des contacts très suivis avec des musiciens et universitaires allemands qui viennent le voir en Guinée, dans son village, et qui l’invitent régulièrement en Allemagne pour donner des concerts et animer des ateliers. Il contribue grandement dans les années 1990-2000 à développer dans différents pays les capacités des non-africains à pratiquer sérieusement les musiques de sa propre culture.
L’idée d’avoir à enseigner le jeu sur le djembé à des personnes adultes n’ayant pas grandi dans sa tradition, bien que souvent formées dans les conservatoires de la musique « classique » européenne, est pour lui un défi : il doit développer une méthodologie qui à la fois doit rester dans les cadres de l’oralité et permettre aux étudiants/étudiantes de progresser vers des compétences techniques non séparées des significations musicales et culturelles du jeu instrumental.
Autre défi, en Guinée même, les structures sociales en plein bouleversement (urbanisation, mines, influence des technologies de communication) signifient que les jeunes tendent à perdre contact avec la tradition. Là aussi, dans un souci de maintenir et transmettre son art, ses manières de jouer et le contexte culturel dans lequel il évolue, il doit inventer des méthodes adéquates pour enseigner dans le cadre de son village et au-delà dans l’Afrique.
Dans sa manière d’envisager l’enseignement du djembé, Konaté doit inventer des méthodes appropriées à la diversité des publics auxquels il s’adresse, qu’ils soient africains ou européens. Il doit les inventer de toute pièce, car la notion d’enseignement n’existait pas dans le village où il a grandi : à partir de modèles établis se manifestant au quotidien, chaque enfant devait au village développer son propre jeu sans l’aide ni la supervision de qui que ce soit. Comment, envers les personnes qui ne sont pas insérées dans ce monde culturel, concilier l’idée d’instiller des principes et celle de les laisser petit à petit déterminer de manière autonome leurs propres styles de jeu. Il formule la dimension du problème en décrivant l’exemple suivant :
En 1987, quand je suis arrivé en Allemagne et ai donné mes tous premiers stages, j’avais d’énormes difficultés à enseigner les phrases de solo du djembé. La raison était simple : les solos n’étaient pas catalogués dans ma tête d’une manière qui m’aurait permis de les transmettre. Les phrases d’accompagnement des trois tambours basse et second djembé me posaient beaucoup moins de problèmes. Petit à petit, je réussissais de mieux en mieux à les systématiser et à les enseigner en conséquence. Ce qui m’a aidé, c’est mon expérience avec les élèves européens et leurs difficultés d’apprentissage. Je leur suis très reconnaissant pour ces échanges. Cependant, en ce qui concerne les solos, il ne suffit pas de simplement répéter ce que fait le maître. Ce que vous devez atteindre, c’est l’improvisation libre et autonome. (Page 239)
Pour lui, il s’agit « d’apprendre et d’enseigner sans pédagogie », comme s’intitule un sous-chapitre de son livre. Il fait la différence entre l’enseignement de la musique en Europe centré sur l’apprentissage de la lecture et l’écriture du solfège (« certains ne savent pas jouer sans avoir tout noté auparavant ») et le caractère oral de sa musique qui ne sépare pas la tête du corps :
Selon mon expérience, l’écriture de notes est utile si l’on veut se rappeler plus tard ce qu’on a appris avec son professeur. Mais en situation d’apprentissage et en jouant de la musique, la tête et le corps devraient être entièrement libres. Nous autres africains avons l’habitude d’utiliser la tête avec le corps ensemble. A la fin, tout est enregistré dans notre mémoire et nous le maîtrisons en jouant. Si au lieu de cela, on nous demandait de jouer d’après des notes, ce serait un casse-tête pour nous ! (Page 236)
Pour pouvoir enseigner dans un contexte multiculturel qui mélange écriture et oralité, il doit systématiser ses propres pratiques rythmiques, tout en restant conscient qu’il convient pour les personnes qui apprennent qu’elles doivent absolument dépasser le stade de cette systématisation pour mieux parvenir d’une manière globale à l’essence même de la musique.
Dans cette nouvelle phase de la vie de Konaté, on retrouve de nouveau les situations de tension entre tradition locale et modernité mondialisée. Les choix qui se présentent vont au-delà d’une option conservatrice de traditions à maintenir coûte que coûte ou d’une option progressiste qui consisterait à les effacer. Il faut à chaque fois se tracer un chemin tortueux dans des pratiques effectives. Dans le village de son enfance l’enseignement de la musique, des instruments, n’existe pas, chacun, chacune, doit trouver sa voie à partir de données stables, quotidiennes, qui semblent naturelles. Dans le monde auquel il se confronte, notamment pour se libérer des Ballets Africains, l’enseignement devient une nécessité et l’apprentissage de la musique doit être réinventé pour à la fois maintenir la tradition vivante et la faire fortement évoluer, dans le cadre d’une tension silencieuse mais dans ce cas très amicale entre les conceptions africaines et européennes.
Conclusion
Il est rare de trouver un ouvrage écrit par un praticien de la musique dans lequel tous les aspects pertinents à des contextes de vie diversifiés sont traités de trois manières : a) une description détaillée de ce qui entre en jeu dans les pratiques artistiques ; b) une réflexion très élaborée sur la signification des moindres éléments de pratique ; et c) le récit souvent humoristique, mais aussi dramatique, de situations réelles d’existence.
De cette manière, tous les sujets sont traités en profondeur : l’histoire de sa famille, son enfance, ses premiers pas vers le jeu du djembé, la domination coloniale, le voyage (aller à l’aventure) chez son frère, Les Ballets Africains, le contexte politique de la Guinée indépendante, les tournées dans le monde entier, les conditions de travail dans cet ensemble. Puis la période après 1987 d’indépendance artistique et d’enseignement Afrique et en Europe : en 1996 il devient professeur honoraire à l’Université des Arts de Berlin.
Au fil des chapitres, on a aussi accès à une description critique de sa propre culture : l’ordre social dans le village, la place de la musique et de la danse, les fêtes, et les aspects plus problématiques, par exemple celui de l’excision et celui de la distribution rigide des rôles, notamment entre les hommes et les femmes. Il y a un chapitre important sur les « fonctions individuelles et sociales de la musique » (p. 169-223), sur les instruments, leurs constructions, leurs techniques, leur histoire et les divers contextes dans lesquels ils sont utilisés. L’ouvrage se termine sur une rétrospective personnelle sur les expériences qu’il a vécues et les réflexions qu’elles ont pu susciter au fil du temps. Il propose des pistes de travail en vue de la « conservation de la musique africaine » et le maintien de son caractère d’oralité. Il s’agit pour lui de définir dans un sens très universel qui a le droit de pratiquer cette tradition : « la musique ne connaît ni “races” ni couleurs » (p. 239). L’impact de la modernité sur les traditions est aussi abordé, notamment vis-à-vis de la préservation des pratiques (enregistrements, vidéos) et de la question des droits d’auteurs. Pour Konaté le bilan de la confrontation entre tradition et modernité est « mitigé » (p. 249). Il parle alors des problèmes économiques de l’Afrique, de la médecine traditionnelle et moderne, des méfaits du tourisme intensif, du racisme qu’il a subi en Europe et ailleurs, des « conditions de vie et d’écologie, hier et aujourd’hui » (p. 257).
1. Extrait de la quatrième de couverture, Famoudou Konaté, avec la collaboration de Thomas Ott, Mémoires d’un musicien africain, Ma vie – mon djembé – ma culture, Paris L’Harmattan, 2022.
2. Ce livre a tout d’abord paru en allemand en 2021 sous le titre : Famoudou Konaté, Mein Leben – meine Djembé – meine Kultur, Autobiographische Aufzeichnungen eines afrikanischen Musikers. Herausgegeben von Thomas Ott (2021 Schott Music GmbH & Co. KG. Mainz, Allemagne).
3. Voir l’interview de Djely Madi Kouyaté dans la présente édition.