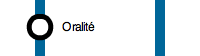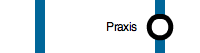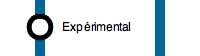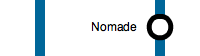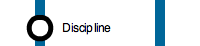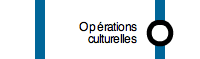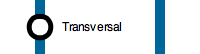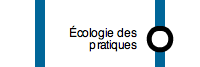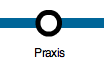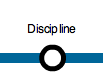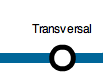« Il y a deux musiques (du moins je l’ai toujours pensé) : celle que l’on écoute, celle que l’on joue. Ces deux musiques sont deux arts entièrement différents, dont chacun possède en propre son histoire, sa sociologie, son esthétique, son érotique : un même auteur peut être mineur si on l’écoute, immense si on le joue (même mal).» (Barthes, 1992, p.231)
La dichotomie présentée par Barthes est intéressante pour PaaLabRes parce qu’elle place la musique dans une activité à faire là où elle n’est souvent présentée que comme un produit à écouter. Nous allons essayer de comprendre en quoi cette distinction est importante pour la diversité des pratiques de la musique.
La musique à écouter n’est pas très difficile à définir: c’est ce qu’on appelle en général « La Musique ». Il s’agit de la définition implicite qu’on retrouve dans les (nombreux) aphorismes sur la musique :
« La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. » Pablo Casals
« Sans la musique, la vie serait une erreur. » Friedrich Nietzche
La musique n’est ici plus qu’un pur produit sonore avec lequel nous sommes mis en présence, qui n’existerait que pour l’oreille. En tant que produit, elle est parée de vertus extra-ordinaires, voire de pouvoirs magiques qui peuvent aller jusqu’à sauver les hommes (ça marche d’autant mieux avec les « pauvres » considérés en général comme des pêcheurs culturels). Même dans la tentative de distinction que propose Duke Ellington – « Il n’existe que deux sortes de musique : la bonne et la mauvaise » – , la musique se conjugue au singulier parce qu’elle est réduite à une fonction: être écoutée.
Mais la conséquence de cela, c’est que pour être écoutée, la musique doit être bien jouée. La musique à écouter – et je ne parle pas ici uniquement de la musique classique – doit donc être fabriquée par des spécialistes, jouée par des spécialistes qui l’ont apprise grâce à des spécialistes, excluant de fait, sans s’en rendre compte, une pratique commune de la musique. Même en imaginant la multiplicité de la musique en autant de musiques différentes qu’il y a de styles (rock, jazz, classique, variété, expérimental, etc.), ces musiques ont toujours en commun le fait d’être bien jouées.
Pourtant, dans la citation de Barthes, le plus important c’est la parenthèse « (même mal) » ! La différence entre la musique à jouer et la musique à écouter tient toute entière dans cette parenthèse. Barthes la définit ainsi « c’est la musique que vous ou moi pouvons jouer, seuls ou entre amis, sans autre auditoire que ses participants (c’est-à-dire tout risque de théâtre, toute tentation hystérique éloignés) ».
Pour notre part, à l’expression « musique à jouer » nous préférons le terme de « musique à faire », qui reste néanmoins dans le sens que Barthes lui donne dans la dernière phrase de son article : « A quoi sert de composer, si c’est pour confiner le produit dans l’enceinte du concert ou la solitude de la réception radiophonique ? Composer, c’est, du moins tendanciellement, donner à faire, non pas donner à entendre, mais donner à écrire. » Le verbe « faire » nous semble moins chargé symboliquement que le verbe « jouer » (évidemment que la musique est jouée tout le temps !) et que le verbe « écrire ». S’il insiste sur l’idée d’une fabrication, le verbe « faire » implique surtout l’idée d’un acte ordinaire, banal, commun.
Pour exister, la musique à écouter doit en revanche être produite dans des conditions extra-ordinaires, spectaculaires : le concert. C’est la systématisation et la sacralisation de la pratique du concert au XIXe qui nous a fait concevoir toute musique comme une musique à écouter en inscrivant le rapport de communication entre un producteur et un récepteur au centre du dispositif, la salle et le moment du concert étant exclusivement tournés vers l’activité de l’écoute. L’avènement de l’enregistrement a par la suite encore amplifié – aux deux sens du mot – ce rapport à la musique. Si la seule différence entre le concert et l’enregistrement réside dans la séparation temporelle et spatiale des lieux de production (salle de concert, studio d’enregistrement, etc.) et de réception (salon, voiture, etc.), l’enregistrement, pensé comme fixation du moment de jeu et donnant une possibilité de ré-écoute infinie, a rendu l’oreille encore plus en demande d’un produit bien joué, voire « parfait » qui chasse les imperfections possibles du moment de jeu (remarquons simplement le temps passé et les efforts fournis en re-recording, montage et mixage d’un enregistrement pour soigner le produit sonore). Mais ce qu’on gagne en « pureté » ou « qualité » musicale, on pourrait bien le perdre en différences de pratiques…
Dans les médias, la musique est actuellement souvent présentée comme une musique écoutée enregistrée. Par exemple cet article grand public, Les Français prêts à sacrifier leur télé plutôt que la musique, reprenant une enquête récente présente la musique comme un produit dont la consommation, c’est-à-dire l’écoute, est indispensable au bon fonctionnement d’un foyer. Pourtant, il n’est pas uniquement question de « musique à écouter » dans cet article. La dernière phrase cite en effet avec étonnement des pratiques qui peuvent entrer dans notre catégorie de « musique à faire » :
« Plus amusant, 10 % des sondés confessent avoir été surpris par leurs proches en train de danser nus, 23 % s’adonnant à « l’air guitar », ou encore 30 % s’entraînant devant un miroir. »
Mais la manière de présenter ces pratiques les marque directement d’un stigmate d’inavouabilité certain…
Si la musique à écouter est donc avant tout un produit, dont la focalisation sur la qualité à atteindre masque les conditions sociales, écologiques et politiques de sa production, la musique à faire est avant tout une activité sociale dont la fin ne saurait justifier les moyens. Rabattre l’une sur l’autre signifie la mort musicale de cette dernière.
Chanter sous la douche, jouer dans sa chambre, chanter à tue-tête par dessus une radio, gratouiller une guitare au coin d’un feu avec des amis, jouer mal un morceau de Bach, jouer un quatuor à trois instruments seulement, etc. sont autant de pratiques invisibles car « innommables » – on ne peut pas les nommer « musique »- en particulier là où on fabrique les musiciens qui produisent la musique à écouter: le conservatoire. On devrait donc pouvoir a minima préciser les circonstances de la production de « musique », a fortiori dans les lieux de son enseignement afin d’éviter tout « malentendus »[1], pour ne pas faire prendre une pratique pour une autre. C’est en effet certainement de là que vient le malentendu sur ce que « faire de la musique » veut dire : l’emploi du substantif « musique » sans y attacher explicitement les circonstances de sa production.
Pour donner une illustration de l’explicitation des circonstances de production de l’objet « musique », tentons pour finir de préciser ce qui est généralement sous-entendu dans l’expression « apprendre la musique » en conservatoire :
Apprendre la musique,
c’est apprendre la musique classique,
c’est-à-dire apprendre la musique classique de manière classique,
c’est-à-dire apprendre à plusieurs à lire une partition écrite dans le langage occidental stabilisé au XIXe siècle avec un professeur de solfège et apprendre seul à jouer d’un instrument de musique moderne de tempérament égal avec un professeur du même instrument de musique moderne de tempérament égal pour pouvoir ensuite répéter avec d’autres musiciens qui ont reçu la même formation, mais sur un autre instrument de musique moderne de tempérament égal avec un professeur de cet instrument moderne de tempérament égal, pour former l’ensemble qui correspond à la nomenclature de la pièce de musique occidentale savante composée par un génie entre 1685 et 1937 dans le but de l’interpréter sous la direction d’un chef le plus correctement possible sur la scène surélevée d’une salle de concert adaptée à recevoir un public adapté lui aussi.
Si elle a au moins le mérite d’être claire, permettant peut-être d’éviter quelques malentendus, cette définition pourrait néanmoins à terme empêcher toute pratique de musique classique en affichant trop crûment ses conditions de production aujourd’hui implicites mais pourtant bien réelles, ainsi que le signale les propos d’un directeur de conservatoire : « un musicien qui vient ici pour simplement jouer dans sa chambre, à la limite il n’a pas sa place ici. » On a donc peut-être intérêt à maintenir ce malentendu et à ne pas trop expliciter les attendus pour ne pas décourager ceux qui jouent dans leur chambre… et qui ne souhaitent pas spécialement en sortir. Toutefois, et sans aller jusqu’à une description intenable des conditions spécifiques de chaque pratique, on pourrait néanmoins s’interroger un peu plus sur les différents modèles de pratique existants et par là ne pas s’arrêter à l’utilisation des seules catégories portées par les institutions et leurs acteurs. En développant des pratiques centrées autant sur la musique « à faire » que sur le produit musical « à écouter », ou pour le dire autrement sur la musique comme activité sociale autant que comme pratique artistique séparée du quotidien, on pourrait donner la possibilité d’une existence légitime à d’autres pratiques que celles qui visent une perfection sans fin induite par la pratique sur scène, même si ces pratiques restent dans leur chambre.
Pour aller plus loin
Barthes, R., « Musica practica », L’obvie et l’obtus, Essais critiques, Paris, Éditions du Seuil, 1992, p. 231-235.
Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1965). Langage et rapport au langage dans la situation pédagogique in Rapport pédagogique et communication, Bourdieu, P., Passeron, J.-C., & Saint Martin, M. de., Paris La Haye Mouton.
Bozon, M., Vie quotidienne et rapports sociaux dans une petite ville de province : la mise en scène des différences, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1984.
Chagnard, S., (2012) Modèle de pratique et pratique du modèle en conservatoire – Un musicien, c’est fait pour jouer. Mémoire de Master à finalité recherche sous la direction de G. Combaz – Institut des Sciences et des Pratiques de l’Education et de la Formation – Université Lumière Lyon 2.
Lahire, B., « Logiques pratiques : le “faire” et le “dire sur le faire” », in L’esprit sociologique, Textes à l’appui, Paris, Éditions La Découverte, 2005, p.141-160.
Levine, L. W. (2010). Culture d’en haut, culture d’en bas : l’émergence des hiérarchies culturelles aux États-Unis. Paris : Éditions la Découverte.
[1]. « Ce qui fait la gravité du malentendu linguistique dans le rapport pédagogique, c’est qu’il porte sur le code. […] Apprendre, c’est indissociablement, acquérir des savoirs et acquérir le savoir du code dans lequel ces savoirs sont susceptibles d’être acquis. Autrement dit, le code ne peut ici s’apprendre que dans le déchiffrement de moins en moins malhabile des messages. Sans doute est-ce la logique de tout apprentissage réel, qu’il s’agisse de socialisation diffuse ou d’acculturation, mais la communication pédagogique n’est-elle pas confiée précisément à des techniciens de l’apprentissage qui ont pour fonction spécifique de travailler continûment et méthodiquement à réduire au minimum le malentendu sur le code ? » [Bourdieu & Passeron, 1965, p. 15]
 Pour un itinéraire-chant vers…
Pour un itinéraire-chant vers…