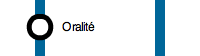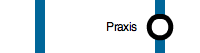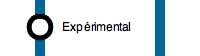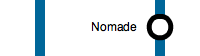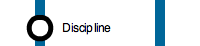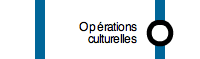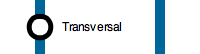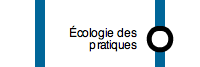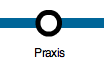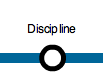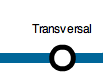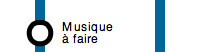Access to the English translation: Collective Invention
Invention musicale collective
dans le cadre de la diversité des cultures
Jean-Charles François
Sommaire :
1. Introduction
2. Formes alternatives aux œuvres d’art définitives
3. Improvisation
4. Processus artistiques ou seulement interactions humaines ?
5. Protocoles
6. Conclusion
Introduction
Le monde dans lequel nous vivons peut être défini comme celui de la coexistence d’une grande diversité de pratiques et de cultures. C’est ainsi qu’il est difficile aujourd’hui de penser en termes de monde moderne occidental, de philosophie orientale, de tradition africaine ou autres étiquettes trop faciles à utiliser pour nous orienter dans le chaos ambiant. On est en présence d’une infinité de réseaux et on appartient sans doute très souvent à plusieurs réseaux à la fois. Il s’agit par conséquent de penser les pratiques musicales en termes de problèmes écologiques. Une pratique peut en tuer une autre. Une pratique peut être directement en rapport avec une autre et pourtant elles peuvent toutes les deux garder leur particularité et affirmer leurs différences. Une pratique peut dépendre pour sa survie d’une autre pratique souvent antagoniste. L’écologie des pratiques (voir Stengers 1996, chapitre 3), ou comment faire face à un monde multiculturel potentiellement violent, est devenue une question en lien profond avec le futur de notre planète.
La recherche à laquelle j’ai activement participé entre 1990 et 2007 a consisté à inventer des dispositifs de médiation active entre des groupes de musiciens affirmant leurs différences à travers des pratiques culturelles ou des styles de musique. Cette recherche a été menée dans le cadre de l’élaboration des programmes d’études au Cefedem AuRA à Lyon – un lieu de formation des professeurs de l’enseignement spécialisé de la musique – en directe collaboration avec Eddy Schepens et toute l’équipe pédagogique et administrative de cette institution. À partir de l’année 2000, des étudiants provenant de quatre terrains d’action ont été appelé à travailler ensemble dans une même promotion menant au Diplôme d’État de professeur de musique : musiques actuelles amplifiées, jazz, musiques traditionnelles et musique classique. Le programme d’études a été basés sur deux impératifs distincts : a) chaque genre musical devait être reconnu comme autonome dans ses spécificités pratiques et théoriques ; et b) chaque genre musical devait collaborer avec tous les autres dans des projets artistiques et pédagogiques spécifiques. Nous nous sommes ensuite confrontés au problème de savoir comment faire face à la différence de culture qui existe entre une tradition d’enseignement formalisée à l’extrême mais avec peu de présentations publiques, et des traditions qui sont basées sur des formes atypiques ou informelles d’apprentissage directement liées à des interactions avec un public. Le problème qu’il a fallu ensuite résoudre peut être formulé comme suit : le secteur classique tend à développer une identité basée sur l’instrument ou la production vocale dans une posture où il s’agit d’être prêt à jouer toutes formes de musiques (à condition qu’elles soient écrites sur une partition) ; les autres genres musicaux ont tendance à exiger de leurs membres une forte identité basée sur le style de musique en tant que tel accompagnée d’une approche technique uniquement basée sur ce qui est nécessaire à exprimer cette identité. Notre tâche a consisté à trouver des solutions capables d’inclure tous les ingrédients de cette triple équation. Deux concepts ont pu émerger : a) le programme d’études serait centré sur les projets des étudiants et non plus sur une série de cours et la définition de leur contenu (bien qu’ils ont continué à exister) ; b) les projets devraient être basés sur le principe d’un contrat liant les étudiants à un certain nombre de contraintes déterminées par l’institution et sur lequel l’évaluation serait fondée. Une publication, Enseigner la Musique a rendu compte de nombreux aspects de cette recherche et sur la pédagogie de la musique (voir par exemple François et al. 2007).
En prenant en compte comme modèle ce concept de rencontres interculturelles, des situations expérimentales ont été développées à Lyon par le collectif PaaLabRes (« Pratiques Artistiques en Actes, Laboratoire de RechercheS ») à partir de 2011. Plusieurs projets ont pu être développés :
- Un petit groupe de musiciens improvisateurs s’est réuni pour travailler sur des protocoles en vue de développer des matériaux en commun dans le contexte d’invention collective[1]. Ces protocoles ont été expérimentés et discutés par ce petit groupe, puis appliqués dans un certain nombre d’ateliers d’improvisation s’adressant à des publics très différents : professionnels, amateurs, débutants, étudiants, musiciens et danseurs appartenant à différentes esthétiques ou traditions (2011-2015).
- Entre 2015 et 2017, des rencontres ont été organisées au Ramdam (Centre d’arts) près de Lyon entre la danse (membres de la Compagnie Maguy Marin entre autres) et la musique (membres du collectif PaaLabRes) sur cinq week-end de travail autour de l’idée de développer des matériaux communs dans des perspectives d’improvisation collective.
- Dans le cadre de la publications de deux premières éditions de ce site « paalabre.org », une réflexion a été menée sur la recherche artistique par rapport à la diversité des pratiques artistiques, des expressions esthétiques et des contextes allant notamment de la pédagogie aux présentations sur scène, du monde professionnel et de celui beaucoup plus informel de ceux qu’on n’arrive pas à classifier. (Voir dans la première édition de l’espace numérique paalabres.org, la station « débat » sur la ligne recherche-artistique).
2. Formes alternatives aux œuvres d’art définitives
Les situations d’improvisation peuvent être perçues comme une bonne manière d’aborder les problèmes liés aux rencontres hétérogènes, non pas en se focalisant sur des valeurs esthétiques, mais plutôt sur les processus démocratiques que cette situation semble promouvoir : chaque participant est complètement responsable de sa production et de sa manière d’interagir avec autrui, et aussi avec les divers moyens de production mis à disposition.
La définition de l’improvisation, dans le cadre des pratiques artistiques de l’occident – dans ses formes les plus « libres » – est souvent proposée comme une alternative à la musique écrite qui a dominé pendant au moins deux siècles la musique savante européenne. L’improvisation face au structuralisme des années 1950-60 a eu tendance à proposer une simple inversion du modèle jusqu’ici dominant :
- L’interprète, considéré jusqu’alors comme n’étant pas un élément majeur participant à la création d’œuvres, devient par le biais de l’improvisation complètement responsable de sa propre création, en évitant de créer des œuvres définitives.
- La pratique d’écrire des signes sur une partition et de les respecter dans l’interprétation va être remplacée par l’absence de toute notation visuelle et la prévalence de la communication orale.
- Il n’y aura plus d’œuvres fixées définitivement dans l’histoire, mais des processus qui se modifient continuellement à l’infini.
- La lente réflexion, menée dans l’espace privé par le compositeur lors de l’élaboration d’une pièce donnée, va être remplacée par un acte instantané, dans l’inspiration du moment, sur la scène et en présence du public.
- À la place de compositions se définissant de plus en plus comme des objets autonomes articulant leur propre langage et tour de main particulier, l’improvisation libre tendra à se diriger vers le « non-idiomatique » (voir Bailey 1992, p. xi-xii)[2] ou vers le « tout-idiomatique » (la capacité d’emprunter des matériaux provenant de tous les domaines culturels).
Et ainsi de suite, tous les termes étant inversés.
Mais pour que cette inversion puisse devenir réalité, des éléments de stabilité doivent rester en place : la présence d’artistes professionnels ou considérés comme tels se produisant sur une scène devant un public constitué de mélomanes éduqués. La stabilité historique de musiciens interprètes, jouant dans des concerts publics, héritée dans une très grande mesure du XIXe siècle, va de pair avec ce que Howard Becker a appelé le « package » (ou lot) : une situation hégémonique qui contrôle d’une manière globale toutes les actions dans un domaine donné avec des conditions économiques particulières, la définition des rôles professionnels et la présence d’institutions d’enseignement idoines (voir Becker 2007, p. 90). L’inversion des termes apparaît être là pour garantir que certaines attitudes esthétiques puissent rester telles quelles : par exemple, le concept de la musique « non-idiomatique » peut être considéré comme prolongeant et renforçant la conception moderniste d’un renouvellement constant des sonorités ou de leurs combinaisons s’inscrivant dans des objets musicaux construisant une histoire. On ne sait pas quel idiome va résulter du travail du compositeur, mais l’idéal est d’arriver à un idiome personnel. L’improvisateur doit venir sur scène sans à-priori idiomatique, mais le résultat sera idiomatique seulement pour la durée du concert. L’idéal de la « table rase » persiste dans l’idée que chaque improvisation doit pouvoir s’éloigner des sentiers battus.
L’improvisation envisagée à la lumière des concepts « paalabriens » de nomade et de transversal ne peut pas se limiter à l’idée qu’il s’agit là d’une alternative à la sédentarité des êtres humains personnifiés par le milieu de la musique classique occidentale. Les pratiques nomades et transversales ne peuvent pas non plus prétendre se présenter comme une alternative aux formes artistiques institutionnelles, à travers les mouvements indéterminés de leur errance sans fin. Les nomades (transversaux) ont plutôt la tâche de se confronter à la complexité des pratiques se situant entre les formes de communication orales et écrites, entre la production des timbres et leur articulation syntactique, entre la spontanéité des gestes et leur prédétermination, entre l’interactivité à l’intérieur d’un groupe et l’élaboration d’une contribution personnelle originale.
3. Improvisation
Un des aspects le plus important de l’improvisation – en tant qu’élément distinct de la musique écrite sur partitions ou de la chorégraphie précisément fixée – c’est la responsabilité partagée entre plusieurs participants pour créer une production collective. Toutefois, le contenu exact de cette créativité collective dans la réalité des improvisations semble peu clair. Dans l’improvisation, l’accent est mis sur la production sur scène et en public non planifiée à l’avance, et sur l’acte éphémère qui ne va se passer qu’une seule fois. L’idéal de l’improvisation semble dépendre de l’absence de préparation avant le déroulement de l’acte en tant que tel. Pourtant, la réalité de l’acte d’improvisation ne peut se dérouler si les participants ne sont pas tous prêts individuellement à le faire. La prestation sur scène peut ne pas être préparée dans les détails de son déroulement, mais d’une façon générale, elle ne peut pas non plus être réussie sans la présence d’une préparation intense. Voilà une situation bien paradoxale.
Deux modèles de pratique de l’improvisation peuvent être définis, et il faut bien se souvenir que les modèles théoriques ne sont là que pour différencier des points de référence permettant à une réflexion de se développer, mais qu’ils ne correspondent jamais à une réalité beaucoup plus complexe. Dans le premier modèle, les improvisateurs doivent se préparer individuellement de manière intensive pendant de longues années, afin de pouvoir assumer une voix personnelle, une manière unique de produire des actes sonores ou gestuels. Cette voix personnelle ou manière de jouer doit être inscrite dans la mémoire – inscrite dans le corps – dans une collection la plus large possible de répertoires. C’est là la principale condition de l’acte créatif de l’improvisation : les éléments d’invention ne sont pas inscrit sur un support indépendant – comme la partition – mais ils sont directement incarné dans les capacités de jeu de l’improvisateur. Les participants se rencontrent sur la scène en tant qu’individus séparés pour produire quelque chose ensemble de manière non prévue à l’avance. La production sur scène sera la superposition de discours personnels, mais si les participants peuvent anticiper sur ce que les partenaires vont pouvoir produire (surtout s’ils ont déjà joué ensemble ou assisté à leurs prestations respectives) ils vont être capables de construire ensemble, dans le cadre de cette impréparation, un univers original de sonorités et/ou de gestes. L’accent mis sur la préparation individuelle semble tout même favoriser un réseau assez homogène d’improvisateurs. Ce réseau est géographiquement très large et impose, sans avoir à les spécifier, les conditions d’accès par une série de règles implicites et non écrites. L’accent principal de ce modèle est centré sur la prestation en public sur scène et les enjeux sont placés très haut pour que la rencontre entre les actes gestuels ou sonores des unes et des autres soient de grande qualité, en incluant aussi les attitudes et les réactions du public.
L’autre modèle alternatif met l’accent sur la co-construction collective d’un univers déterminé indépendamment de toute présentation sur scène ou d’autres types d’événement. Cela implique qu’un temps important doit être trouvé pour élaborer un répertoire de matériaux (sonores ou autres) appartenant à un groupe permanent de personnes. Un nombre suffisant de sessions de travail en commun doit avoir lieu en présence de tous les membres d’un groupe donné. Ce second modèle n’a pas beaucoup d’intérêt si les membres du groupe proviennent d’un milieu social et artistique homogène, notamment s’ils ont acquis un statut professionnel par le passage dans les mêmes institutions d’enseignement et les mêmes dispositifs de qualifications. S’ils ne sont pas différents dans un certain nombre d’aspects, il semble que le premier modèle soit plus à même d’assurer sans trop de difficulté la construction collective d’un univers artistique donné lors des prestations sur scène. Mais s’ils sont différents, et surtout s’ils sont très différents au point d’être plutôt antagonistes, l’idée de construire ensemble un matériau commun n’est pas une simple tâche. D’une part, les différences entre les participants doit être maintenue, elles doivent être pleinement mutuellement respectées. D’autre part, construire quelque chose ensemble va exiger de chaque participant d’être capable de laisser derrière soi les comportements habituels et traditionnels. C’est une première situation paradoxale. Mais il y a immédiatement un deuxième paradoxe qui vient encore compliquer les choses : d’une part le matériau qui est développé collectivement doit être plus élaboré que la simple superposition de discours parallèles pour pouvoir être qualifié de co-construction ; et d’autre part, le matériau ne doit pas non plus se figer dans une structuration qui équivaudrait à fixer les choses comme dans un composition écrite, le matériau doit pouvoir rester ouvert à des manipulations et des variations à réaliser dans le moment présent de l’improvisation. Les participants doivent pouvoir rester libres de leurs interactions dans l’esprit du moment. Ce second modèle n’exclut pas les prestations en public mais n’est pas limité à cette obligation. Il est centré sur des processus collectifs et peut se dérouler dans différents contextes d’interactions sociales.
Les défis auxquels on a à faire face dans le second modèle sont directement liés aux débats autour des moyens à convoquer pour faire tomber les murs. Il n’est pas suffisant de rassembler des personnes d’origines ou de cultures différentes dans un même lieu pour que des relations plus profondes puissent se développer. Il n’est pas non plus suffisant d’inventer de nouvelles méthodologies appropriées à une situation donnée pour que par miracle la coexistence pacifique puisse s’installer. Pour faire face à la complexité, on a besoin de développer des situations dans lesquelles un certain nombre d’ingrédients doivent être présents : a) chaque participant doit avoir une connaissance de ce que chacun des autres représente ; b) chaque participant est obligé de respecter des règles élaborées en commun ; c) chaque participant pourtant doit pouvoir retenir une importante marge d’initiative personnelle pour exprimer sa différence ; d) il y a des moments où une forme de leadership peut émerger, mais dans son ensemble le contexte doit rester dans les limites d’un processus démocratique. Toute cette complexité démontre les vertus d’un bricolage pragmatique guidé par ce « dispositif » de principes et de contraintes.
Comme l’a démontré le sociologue et pianiste de jazz David Sudnow lorsqu’il a décrit son propre processus d’apprentissage de l’improvisation dans le jazz, les modèles sonores et visuels, bien qu’ils soient des éléments essentiels dans la définition des objectifs à atteindre, ne sont pas suffisant pour produire des résultats probants par le biais de simples imitations :
Quand mon professeur m’a dit, « maintenant que vous êtes capable de jouer ces thèmes, essayez d’improviser des mélodies avec la main droite », et quand je suis rentré à la maison et que j’ai écouté mes disques de jazz, c’était comme si la tâche à accomplir était de rentrer chez soi et de se mettre à parler français. Il y avait ce français qui défilait dans un flot rapide de sons étranges, dans un tourbillon rapide, des styles à l’intérieur de styles dans le cours du jeu de n’importe quel musicien. (Sudnow 2001, p. 17)
Un certain degré de bricolage est nécessaire pour permettre aux participants d’arriver à réaliser leurs objectifs en réalisant leurs propres détours hors de la logique du professeur.
L’idée de dispositif associé à celle de bricolage correspond à la définition du dictionnaire : « Ensemble de mesures prises, de moyens mis en œuvre pour une intervention précise » (Larousse en ligne). On peut aussi se référer à la définition donnée par Michel Foucault comme « un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements d’architectures, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propos philosophiques, moraux, philanthropiques, du dit aussi bien que du non-dit… » (Foucault 1977, voir aussi la station timbre dans la première édition de paalabres.org).
En appliquant cette idée à la co-production de matériaux sonores ou gestuels dans les domaines artistiques, les éléments institutionnels de cette définition sont bien sûr présents, mais l’accent est mis ici sur les réseaux d’éléments créés par les actions réalisées au quotidien, qui sont contextualisées par des personnes qui sont présentes et des matériaux mis à disposition. Les moyens sont ainsi définis ici comme concernant en même temps des personnes, leur statut social et hiérarchique au sein d’une communauté artistique donnée, les matériaux, instruments et techniques mis à disposition, les espaces dans lesquels les actions ont lieu, les interactions particulières – formelles ou non – entre les participants, entre les participants et les matériaux ou techniques, et les interactions avec le monde extérieur au groupe. Les dispositifs sont plus ou moins formalisés par des chartes, des protocoles d’action, des partitions ou images graphiques, des conditions d’appartenance au groupe, des processus d’évaluation (formels ou informels), des procédures d’apprentissage et de recherche. Dans une très grande mesure, les dispositifs sont régulés quotidiennement de manière orale, dans des contextes qui peuvent se modifier substantiellement par rapport aux circonstances, et à travers des interactions qui par leur instabilité peuvent produire des résultats très différents.
4. Processus artistiques ou seulement interactions humaines ?
L’idée de « dispositif » à la fois empêche que les actes artistiques soient simplement limités à des objets autonomes bien identifiés et elle élargit considérablement le champ des activités artistiques. Le réseau qui continuellement se forme, s’informe et se déforme lui-même ne peut pas se limiter à se concentrer sur un seul objectif de production de matériaux artistiques en vue de la satisfaction du public. Les processus ne sont plus définis à partir de sphères de spécialisation prédéfinies. Le terme d’improvisation ne se limite plus de manière stricte à une série de principes sacrés de liberté absolue et de spontanéité ou au contraire de respect d’une quelconque tradition. L’improvisation peut incorporer en son sein des activités qui impliquent une variété de supports – y compris écrits sur papier – pour arriver à des résultats s’inscrivant dans des contextes particuliers. La pureté des prises de positions tranchées et définitives ne peut plus être ce qui doit dicter tous les comportements possibles. Cela ne veut pas dire que les idéaux sont effacés et que les valeurs qu’on veut placer en exergue de la réalité des pratiques ont perdu leur importance primordiale.
La confrontation des pratiques artistiques nomades et transversales aux impératifs des institutions peut s’exprimer dans plusieurs domaines : l’improvisation, la recherche artistique, l’enseignement artistique, l’élaboration de programmes d’études, le renouveau des pratiques traditionnelles, etc. De plus en plus d’artistes se trouvent dans une situation dans laquelle leur pratique en termes strictement artistiques est considérablement élargie par ce qu’on appelle la « médiation » (voir Hennion 1993 et 1995) : activités pédagogiques, éducation populaire, participation du public, interactions sociales, hybridité des domaines artistiques, etc. L’immersion des activités artistiques dans les domaines du social, de l’éducation, des technologies, et du politique implique l’utilisation d’outils de recherche et de collaboration avec la recherche formelle en tant que nécessité dans l’élaboration des objets ou processus artistiques (voir Coessens 2009, et la station the artistic turn de la première éditon de paalabres.org). Les pratiques de recherche dans les domaines artistiques ont pour une grande part absolument besoin de la légitimité et de l’évaluation des instances universitaires, mais il est tout aussi important de reconnaître qu’elles doivent être considérées comme faisant partie d’une « science excentrique » (voir Deleuze et Guatarri, 1980, pp. 446-464), qui change considérablement le sens qu’on peut mettre dans le terme de recherche. Ce que les artistes peuvent apporter à la recherche concerne le questionnement contenu dans leurs pratiques mêmes : l’effacement de la séparation entre les acteurs et les observateurs, entre la manière scientifique de publier les résultats d’une recherche et d’autres formes informelles de présentation, entre les actes artistiques et la réflexion à leur sujet.
Une réponse nomadique et transversale peut se trouver le long d’un cheminement entre la liberté des actes créatifs et l’imposition stricte des règles canoniques de la tradition. Dans ce contexte l’acte créatif ne peut plus être envisagé comme la simple expression individuelle affirmant sa liberté par rapport à une fiction d’universalité. La constitution d’un collectif particulier, définissant au fur et à mesure ses propres règles, doit jouer, dans un frottement instable, à l’encontre des velléités imaginatives individuelles. Mettre une personne en position de recherche consisterait à ancrer l’acte créatif dans la formulation par un collectif d’un processus problématique ; la liberté absolue de création est maintenant liée à des interactions collectives et à ce qui est mis en jeu dans ce processus, sans se limiter aux règles strictes d’un modèle donné. L’acte créatif ne serait plus considéré comme un objet en soi absolu et l’accent serait mis sur les nombreuses médiations qui le déterminent comme un contexte particulier à la fois esthétique et éthique : la convergence à un certain moment d’un certain nombre de participants dans une forme de projet. Les nœuds de cette convergence doivent être expliqués non pas en termes de résultat particulier souhaité, mais en termes de constitution d’une sorte de tableau de la complexité problématique de la situation à son origine : un système de contraintes qui traite de l’interaction entre les matériaux, les espaces, les institutions, les divers participants, les ressources disponibles, les références, etc. D’après Isabelle Stengers, l’idée de contrainte, qu’il faut distinguer des « conditions », n’est pas une alternative qui est imposée de l’extérieur, ni une façon d’instituer une légitimité, mais la contrainte ne doit être satisfaite que d’une manière indéterminée et ouverte sur beaucoup de possibilités. La signification est déterminée a posteriori à la fin du processus (Stengers 1996, p. 74). Les contraintes doivent être prises en compte, mais ne définissent pas des voies à prendre lors de la réalisation du processus. Les systèmes de contraintes fonctionnent le mieux quand des personnes différentes de champs de spécialisation différents sont appelées à développer quelque chose ensemble.
5. Protocoles
Nous avons nommés « protocoles » des processus de recherche collective qui se passent avant une improvisation et qui vont en colorer le contenu, puis accumuler dans la mémoire collective un répertoire d’actions déterminées. Le détail de ce répertoire d’actions n’est pas fixé, et il n’est forcément décidé qu’un répertoire donné doive être convoqué lors d’une improvisation. La définition du terme de protocole est bien évidemment ambiguë et pour beaucoup semblera aller complètement à l’encontre d’une éthique de l’improvisation. Le terme est lié à des connotations de circonstances officielles, voire aristocratiques, où des comportements considérés comme acceptables ou respectables sont complètement déterminés : il s’agit de modes de conduites socialement reconnus. Protocole est aussi utilisé dans le monde médical pour décrire des séries d’actes de soins à suivre (sans omissions) dans des cas précis. Ce n’est pas dans le sens de ces contextes que nous utilisons le terme.
La définition de protocole est ici liée à des instructions écrites ou orales données à des participants au début d’une séance d’improvisation collective déterminant des règles de relations entre individus ou bien de définition d’un matériau particulier, sonore, gestuel ou autre. Elle correspond à peu près à celle du Larousse (en ligne) : « Usages conformes aux relations entre particuliers dans la vie sociale. » et « Ensemble des règles, questions, etc., définissant une opération complexe ». Les participants doivent accepter que pendant un temps limité, des règles d’interactions dans le groupe soient fixées en vue de construire quelque chose en commun ou en vue de comprendre le point de vue d’autrui, d’entrer dans un jeu avec l’autre. Une fois expérimenté, quand des situations ont pu être construites, le protocole en lui-même doit être oublié pour faire place à des interactions beaucoup moins liées à des règles de comportement, en retrouvant l’esprit de l’improvisation non planifiée. L’idéal, dans le cadre de l’élaboration des protocoles, est d’arriver à un accord collectif sur le contenu, sur la formulation des règles. En fait ce n’est que rarement le cas dans l’expérience réelle, car les gens on tendance à comprendre les règles de manière différente. Un protocole est le plus souvent proposés par une personne en particulier, l’importance étant de faire tourner parmi les autres personnes présentes la possibilité d’en proposer d’autres, et aussi de pouvoir donner la possibilité aux autres personnes d’élaborer des variations autour du protocole présenté.
La contradiction qui existe entre la préparation intensive que les improvisateurs s’imposent à eux-mêmes individuellement et l’improvisation sur scène qui se fait « sans préparation se retrouve maintenant au niveau collectif : une préparation intensive du groupe d’improvisateurs doit avoir lieu collectivement avant qu’il soit possible d’improviser d’une manière spontanée en reprenant les éléments du répertoire accumulé, mais sans qu’il y ait une planification du détail de ce qui va se passer. Si les membres du collectif ont développé des matériaux en commun, ils peuvent maintenant plus librement les convoquer selon les contextes qui se présentent lors de l’improvisation.
C’est ainsi qu’on est en présence d’une alternance entre d’une part des moments formalisés de développement du répertoire et d’autre part des improvisations qui sont soit basées sur ce qu’on vient de travailler ou bien plus librement sur la totalité des possibilités données par le répertoire et aussi par ce qui lui est extérieur (rencontres fortuites entre productions individuelles). L’objectif est donc bien de mettre les participants dans de réelles situations d’improvisation où l’on peut déterminer son propre cheminement et dans lesquelles idéalement tous les participants sont dans des rôles spécifiques d’égale importance.
On peut catégoriser les différents types de protocoles ou de procédures, mais il faut se garder d’en dresser le catalogue détaillé, dans ce qui ressemblerait à un manuel. Les protocoles doivent de fait toujours être inventés ou réinventés dans chaque situation particulière. En effet la composition des groupes en terme d’hétérogénéité des domaines artistiques en présence, des niveaux de capacités techniques (ou autres), d’âge, de milieu social, d’origine géographique, des cultures différentes, d’objectifs particuliers par rapport à la situation du groupe, etc., doit à chaque fois déterminer ce que le protocole propose de faire et donc son contenu contextuel.
Voici quelques catégories de protocoles possibles parmi celles que nous avons explorées :
- Coexistence de propositions. Chaque participant peut définir une sonorité et/ou un geste particuliers. Chaque participant doit maintenir sa propre production élaborée tout au long d’une improvisation. L’improvisation ne concerne donc que la temporalité et le niveau des interventions personnelles en superpositions ou juxtapositions. L’interaction se passe au niveau d’une coexistence des diverses propositions dans des combinaisons variées choisies au moment de la performance improvisée. Des variations peuvent être introduites dans les propositions personnelles.
- Sonorités collectives élaborées à partir d’un modèle. Des timbres sont proposés individuellement pour être reproduits tant bien que mal par la totalité du groupe pour pouvoir créer une sonorité collective donnée.
- Co-construction de matériaux. Des petits groupes (4 ou 5) peuvent avoir la mission de développer une sonorité collective cohérente. Le travail s’envisage au niveau oral, mais chaque groupe peut choisir sa méthode d’élaboration, y compris par l’utilisation de notations sur papier. Puis de l’enseigner à d’autres groupes de la manière de leur choix.
- Constructions de structures rythmiques (boucles, cycles). La situation caractéristique de ce genre de protocole est le groupe disposé en cercle, chaque participant à son tour dans le cercle produisant un son, ou un geste, court improvisé, tout ceci dans une forme de hoquet musical. Généralement la production des sons ou des gestes qui tournent en boucle dans le cercle est basée sur une pulsation régulière. Les variations sont introduites par des silences dans le déroulement régulier, des superpositions de cycles de longueurs qui peuvent varier, d’irrégularités rythmiques, etc.
- Nuages, textures, sonorités et/ou mouvements gestuels collectifs – individus noyés dans la masse. Sur le modèle développé par un certain nombre de compositeur de la seconde moitié du vingtième siècle tels que Ligeti et Xenakis, des nuages ou textures sonores (cela s’applique aussi bien aux gestes et mouvements corporels) peuvent être développées à partir d’une sonorité donnée distribuée de manière hasardeuse dans le temps par un nombre suffisant de personnes les produisant. Le collectif produit une sonorité globale (ou mouvements corporels) dans laquelle les productions individuelles sont fondues dans la masse. L’improvisation consiste la plupart du temps à faire évoluer la sonorité globale ou les mouvements corporels de façon collective vers d’autres qualités sonores.
- Situations d’interactions sociales. Les sonorités ou les gestes ne sont pas définis, mais la manière d’interagir entre participants l’est. Premièrement il y a la situation qui consiste à passer du silence à des mouvements gestuels et corporels (ou à une sonorité) collectivement déterminés, comme dans les situations d’échauffement ou de phases de début d’improvisation dans lesquelles le jeu effectif improvisé ne commence que quand tous les participants se sont accordés dans tous les sens du mot accord : a) celui qui consiste à ce que les instruments ou les corps soient accordés b) celui qui concerne le test que fait le collectif de l’acoustique et la disposition spatiale d’une salle pour se sentir ensemble dans un environnement particulier, c) celui qui concerne le fait que les participants se sont mis d’accord pour faire socialement la même activité. C’est par exemple ce que l’on appelle le prélude dans la musique classique européenne, l’alãp dans la musique indienne classique du nord de l’Inde, un processus d’introduction progressive dans un univers sonore plus ou moins déterminé, ou à déterminer collectivement. Deuxièmement il peut s’agir d’interdictions de faire une ou plusieurs actions dans le cours de l’improvisation. Troisièmement il peut s’agir de déterminer des règles de temps de jeu des participants ou d’une structuration particulière du déroulement temporel de l’improvisation. Finalement on peut déterminer des comportements, mais pas les sonorités ou gestes que les comportements vont produire.
- Des objets étrangers à un domaine artistique, par exemple qui n’ont pas de fonction de produire des sons dans le cas de la musique, peuvent être introduits pour être manipulés par le collectif et déterminer indirectement la nature des sonorités ou gestes qui vont accompagner cette manipulation. L’exemple qui vient à l’esprit de manière immédiate est celui de l’illustration sonore de films muets. Mais il y a une infinité d’objets possibles à utiliser dans cette situation. L’attention des participants se porte principalement sur la manipulation de l’objet emprunté à un autre domaine et non sur la production particulière de ce qu’exige la discipline habituelle.
6. Conclusion
Les deux concepts de dispositif et de système de contraintes semblent être une façon intéressante de définir ce que pourrait être la recherche artistique, en particulier dans le contexte de projets de création collective dans des groupes non homogènes : créations collectives improvisées, actes artistiques s’inscrivant dans des contextes socio-politiques, relations formelles/informelles aux institutions, questions concernant la transmission des connaissances et des savoir-faire, diverses manières d’interagir entre des êtres humains, entre des humains et des machines, entre des humains et non-humains. Ces perspectives élargissement considérablement le champ d’application des actes qu’on peut qualifier d’artistiques : l’élaboration de programmes dans le cadre d’institutions d’enseignement, projets de recherche interdisciplinaires, ateliers divers (voir François et al. 2007) deviennent alors de situations artistiques à part entière qui se situent en dehors de l’exclusivité des prestations publiques sur scène.
Nous sommes aujourd’hui confrontés à un monde électronique d’une extraordinaire diversité de pratiques artistiques et en même temps à une multiplication des réseaux socialement homogènes. Ces pratiques tendent à développer de fortes identités et des hyperspécialisations. Cela nous oblige de manière urgente à travailler sur la rencontre des cultures qui tendent à s’ignorer mutuellement. Dans des espaces informels aussi bien que formels, à l’intérieur de groupes socialement hétérogènes, il convient d’encourager des manières de développer des créations collectives sur la base de principes d’une démocratie directe. Le monde des technologies électroniques permet de plus en plus l’accès de tous à des pratiques de création et de recherche, à des niveaux divers et sans avoir à passer par les parcours balisés des institutions. Cela nous obligent à débattre des façons dans lesquelles ces activités peuvent être ou non accompagnées par des artistes travaillant dans des espaces formels ou informels. La nature indéterminée de ces obligations – non pas en terme d’objectifs, mais de mises en pratique effectives – nous ramène de nouveau à l’idée des actes artistiques nomades et transversaux.
1. Ont participé à ce projet : Laurent Grappe, Jean-Charles François, Karine Hahn, Gilles Laval, Pascal Pariaud et Gérald Venturi.
2. Derek Bailey définit les termes de « idiomatique » et de « non-idiomatique » comme relevant d’une question d’identité à un domaine culturel particulier, et non pas tellement en termes de contenu de langage musical : « Non idiomatic improvisation has other concerns and is more usually found in so-called ‘free’ improvisation and, while it can be highly stylised, is not usually tied to representing an idiomatic identity. » (1992, p. xii)
Bibliographie
Bailey, Derek. 1992. Improvisation, its nature and practice in music. Londres: The British Library National Sound Archive. [en français : 1999. L’improvisation : sa nature et sa pratique dans la musique. Paris : Outre Mesure, Coll. Contrepoints. Trad. par Isabelle Leymarie]
Becker, Howard. 2007. « Le pouvoir de l’inertie », Enseigner la Musique N°9/10, Lyon : Cefedem AuRA – CNSMD de Lyon, pp. 87-95. (cette traduction en français est tirée de Propos sur l’Art, pp. 59-72, Paris : L’Harmatan, 1999, trad. Axel Nesme.
Coessens, Kathleen, Darla Crispin and Anne Douglas. 2009. The Artistic Turn, A Manifesto. Gand : Orpheus Institute, distribué par Leuven University Press.
Deleuze, Gilles et Felix Guattari. 1980. Mille Plateaux. Paris : Editions de Minuit.
François, Jean-Charles, Eddy Schepens, Karine Hahn, et Dominique Clément. 2007. « Processus contractuels dans les projets de réalisation musicale des étudiants au Cefedem Rhône-Alpes », Enseigner la Musique N°9/10, Cefedem Rhône-Alpes, CNSMD de Lyon, pp. 173-194.
François, Jean-Charles. 2015a. “Improvisation, Orality, and Writing Revisited”, Perspectives of New Music, Volume 53, Number 2 (Summer 2015), pp. 67-144. Publié en français dans la première édition de paalabres.org, station timbre sous le titre « Revisiter la question du timbre ».
Foucault, Michel. 1977. « Entrevue. Le jeu de Michel Foucault », Ornicar, N°10.
Hennion, Antoine. 1993. La Passion musicale, Une sociologie de la médiation. Paris : Editions Métailié, 1993.
Hennion, Antoine. 1995. « La médiation au cœur du refoulé », Enseigner la Musique N°1. Cefedem Rhône-Alpes et CNSMD de Lyon, pp. 5-12.
PaaLabRes, collectif. 2016. Station « débat », débat organisé par le collectif PaaLabRes et le Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes en 2015.
Stengers, Isabelle. 1996. Cosmopolitiques 1 : La guerre des sciences. Paris : La Découverte / Les empêcheurs de penser en rond.
Stengers, Isabelle. 1997. Cosmopolitiques 7 : Pour en finir avec la tolérance, chapter 6, « Nomades et sédentaires ? ». Paris : La Découverte / Empêcheurs de penser en rond.
Sudnow, David. 2001. Ways of the Hand, A Rewritten Account. Cambridge, Mass. : MIT.